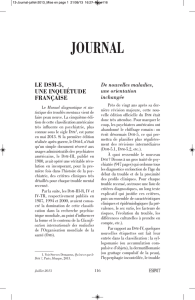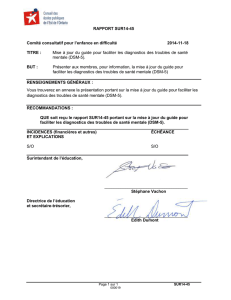LeTemps_2012-11_diagnostic_maladie-mentale

© Le Temps; 20 novembre 2012, Sciences & Environnement
Bataille aux frontières de la santé mentale
Le nouveau manuel américain de diagnostique doit sortir au printemps prochain. Des
spécialistes débattent de ses conséquences
Des millions de personnes pourraient sombrer dans la folie d’un seul coup. Parce qu’après tout, qu’est-ce que la santé
mentale? C’est une question de définition. Et la définition est sur le point de changer. La cinquième révision du
Manuel diagnostique et statistique américains des troubles mentaux (DSM) – la bible du domaine – devrait être
publiée en mai 2013. Les critiques accusent l’Association de psychiatrie américaine (APA), éditrice du manuel, de
convertir les heurts du quotidien en maladie. Transformant le deuil prolongé d’un proche en «épisode dépressif
majeur», ou les accès de colère infantile répétés en «désordre de dérégulation dit d’humeur explosive». Invités par
l’Association suisse du journalisme scientifique à Balsthal (SO), plusieurs spécialistes de ce sujet épineux se sont
interrogés, la semaine dernière, sur le bien-fondé de ces révisions et sur leurs conséquences.
Allen Frances, professeur émérite de psychiatrie à la Duke University de Durham, en Caroline du Nord (Etats-Unis), et
membre de la task force des DSM-3, 3R et 4, s’alarme devant l’inflation des diagnostics. «Une étude récente indique
que 83% des enfants américains remplissent les critères liés à un diagnostic du DSM-4 avant d’avoir 21 ans», illustre-t-
il. Rétrospectivement, il estime qu’il aurait mieux valu en rester au DSM-3, datant de 1980: «Avec le DSM-4, en 1994,
nous avons créé, ou du moins contribué à créer plusieurs épidémies.» Il cite l’autisme, dont les cas ont été multipliés
par vingt après une modification de la définition, mais aussi, aux Etats-Unis, à cause de l’établissement d’un lien entre
le diagnostic et le droit à des services scolaires spécialisés. Ou encore, le doublement des cas de troubles bipolaires
chez l’adulte, où l’effet de la nouvelle définition s’est combiné avec un marketing particulièrement intense de
l’industrie pharmaceutique.
C’est ce dernier point qui préoccupe le plus Christropher Lane, historien des idées à la Northwestern University de
Chicago, et auteur de plusieurs livres critiques sur le DSM: «En 1997, l’administration Clinton et le Congrès ont décidé
que les Etats-Unis rejoindraient la Nouvelle-Zélande dans le club des seules nations industriellement avancées à
permettre la publicité pour des produits pharmaceutiques directement auprès du consommateur – un scénario qui a,
sans surprise, mené à la diffusion des conditions psychiatriques que ces produits étaient justement censés traiter.»
Allen Frances ajoute, à ce propos, qu’un patient qui se rend chez le docteur en demandant un médicament en
particulier possède 17 fois plus de chances de l’obtenir. Aux Etats-Unis, le marché des neuroleptiques pèse 16
milliards de dollars par année, celui des antidépresseurs 11 milliards.
Christopher Lane critique aussi l’influence qu’exerce l’industrie sur les spécialistes du domaine, notamment via le
financement de leurs recherches, ou par le subventionnement de la participation des chercheurs à certains congrès.
La task force du DSM-5 a cherché à limiter cette influence, en stipulant qu’aucun de ses membres ne doit avoir de lien
financier dépassant 10 000 dollars par année avec les compagnies pharmaceutiques.
Allen Frances défend ses anciens collègues: «Si influence il y a, elle est subliminale. Je connais ces gens, ils sont
intègres. Ils prennent des décisions terribles, mais ils le font honnêtement. Ils pensent qu’ils font ce qu’il y a de mieux.
Ils ne mesurent juste pas les conséquences. Même de petits changements peuvent affecter des millions de personnes.
Si, en étant très conservateurs lors de la quatrième révision, nous avons créé toutes ces épidémies, cela sera bien pire
après la cinquième, qui est bien plus aventureuse. Le DSM-5 va médicaliser les stress, soucis et déceptions de la vie de
tous les jours.»
L’extension des diagnostics n’est toutefois pas toujours une mauvaise chose, notamment si cela permet de traiter des
personnes qui en ont besoin, mais se trouvaient auparavant au-dessous du seuil défini, estime Wulf Rössler,
professeur de psychiatrie sociale et clinique à l’Université de Zurich. Mais l’enseignant met en garde contre la
stigmatisation qui accompagne le diagnostic: «Avant, vous êtes peut-être quelqu’un de bizarre, mais après, vous êtes
malade mentalement, et cela change votre vie pour toujours.»
Allen Frances insiste, pour sa part, sur le poids des effets secondaires de traitements administrés sans fondement.
C’est l’apparition du «psychosis risk syndrome» dans le nouveau manuel – soit un diagnostic anticipant, chez un jeune,
le possible développement de troubles psychotiques – qui l’a fait redescendre dans l’arène, alors qu’il profitait
tranquillement de sa retraite sur la côte californienne. «J’étais à un cocktail chez un vieil ami qui dirige les travaux du
DSM-5 sur la schizophrénie, et je l’entends dire combien cette idée est bonne, comment elle va être utile pour
prendre en charge les patients plus tôt. Mais il ne pensait qu’à la manière dont lui pourrait s’en servir, à bon escient,
pas à comment ce diagnostic pourrait être mal utilisé par d’autres.» Le feu nourri de critiques, lié au risque de
médicalisation de personnes n’ayant pas besoin de traitement, a finalement eu raison de ce nouveau syndrome, qui a
été retiré du projet du texte au printemps dernier.
Si chaque nouvelle version du manuel engendre tant de problèmes, pourquoi persister à le réviser? Parmi les
spécialistes présents à Balsthal, aucun ne voit de raison valable. Norman Sartorius, ancien directeur de la division
santé mentale de l’Organisation mondiale de la santé, a participé aussi bien aux travaux sur le DSM qu’à son pendant

international, la Classification internationale statistique des maladies (ICD), qui englobe l’ensemble des pathologies.
«Cela prend environ 20 ans pour qu’une classification soit pleinement utilisée. C’est pourquoi il ne faudrait faire de
révision que lorsqu’il y a des changements significatifs. Si, par exemple, on découvrait que la schizophrénie et le
diabète ont des origines communes.» A son avis, il serait plus judicieux de procéder à des ajustements graduels. Un
point de vue partagé par Allen Frances, pour qui les révisions sont en grande partie motivées par le fait que chaque
nouvelle édition est un best-seller: «L’APA a des besoins budgétaires. Si le DSM-5 n’est pas un succès, elle sera en
déficit.»
Werner Strik, directeur de l’Hôpital psychiatrique de Berne, est le plus optimiste. Dans les mains d’un bon psychiatre,
le DSM-5 sera peut-être un bon outil, espère-t-il. Il estime en outre que si, sur le long terme, le nouveau manuel aura
un pouvoir normateur au niveau international, son emprise sur le grand public suisse devrait être atténuée par la
méfiance des Helvètes vis-à-vis des diagnostics psychiatriques, des psychotropes et des psychiatres en général.
1
/
2
100%