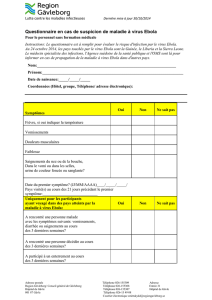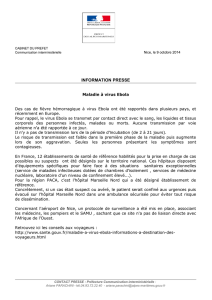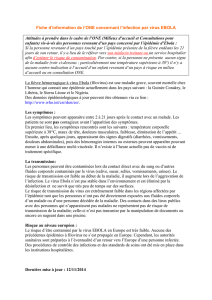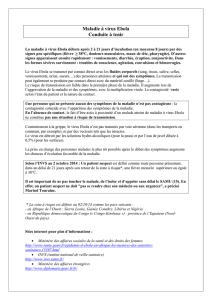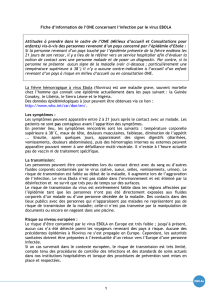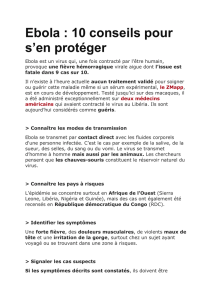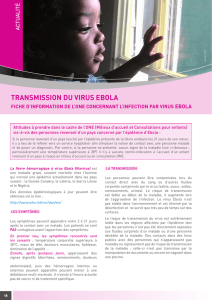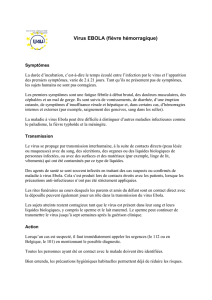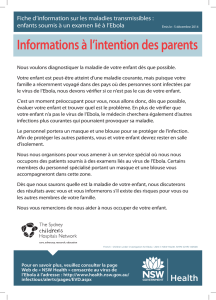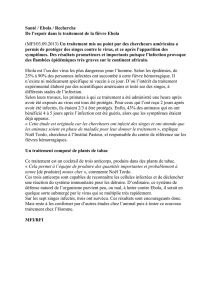Télécharger

Le virus Ebola est responsable de fortes fièvres et d'hémorragies internes souvent
mortelles pour l'homme. Le taux de létalité se situe entre 30 et 90% selon les épidémies.
Le réservoir naturel du virus serait la chauve-souris. Le virus Ebola a été découvert en
1976, lors des deux flambées épidémiques au Soudan et en République démocratique du
Congo. Depuis, une vingtaine de flambées épidémiques sont apparues en Afrique
Centrale. En décembre 2013, le virus a atteint l’Afrique de l’Ouest, région qui était jusqu’à
présent épargnée par la maladie. Il y provoque actuellement la plus grande épidémie
connue à ce jour. Aujourd’hui, il n’existe ni traitement ni vaccin homologué par les
autorités de santé.
Cause
Les chauves-souris frugivores sont probablement les hôtes naturels du virus Ebola. Le virus ne les
rend pas malades mais il devient pathogène lors de l’infection d’autres animaux sauvages de la forêt
tropicale (singes…). L’homme se contamine en manipulant ces animaux (viande de brousse,
dépeçage,…). Le virus se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine.
Il se transmet entre les humains par contact direct avec le sang et avec des liquides biologiques de
personnes infectées, ou par contacts indirects d’environnements contaminés par ces liquides. Le
risque de transmission est nul pendant la période d’incubation, modéré dans les premières heures qui
suivent l’apparition des symptômes et intense lorsque la maladie est installée. En revanche, les
patients ayant réussi à guérir de la maladie ne sont plus infectieux. Il convient simplement de prendre
des précautions car le sperme pourrait continuer de transmettre le virus jusqu’à sept semaines après
la guérison clinique.
Les épidémies sont provoquées par les transmissions secondaires interhumaines. Celles-ci peuvent
être facilitées si les précautions sont insuffisantes lors du soin des malades. Les rites funéraires au
cours desquels les proches du défunt sont en contact direct avec la dépouille augmentent aussi
fortement le risque de transmission du virus Ebola.
Pour stopper l’épidémie et la contagion interhumaine, certaines précautions anti-infectieuses doivent
être suivies : se laver régulièrement les mains, isoler les malades, éviter tout contact de la peau et des
muqueuses avec les liquides infectés. Pour cela, des barrières physiques sont indispensables : gants,
masques, lunettes, combinaison, bottes, etc.
Symptômes
La maladie à virus Ebola est une maladie virale aiguë sévère se caractérisant initialement par des
symptômes non spécifiques, de type pseudo grippaux : apparition brutale d’une fièvre supérieure à
38°C, une faiblesse intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge.
Ces symptômes sont suivis de vomissements, de diarrhées, d’éruptions cutanées, d’une atteinte rénale
et hépatique et dans certains cas, d’hémorragies internes et externes. La durée d’incubation, c'est-à-
dire le temps écoulé entre l’infection et l’apparition des symptômes, varie de 2 à 21 jours, mais est le
plus souvent comprise entre 5 et 12 jours.
Seuls les tests en laboratoire permettent de confirmer le diagnostic. L’analyse des échantillons est
exécutée dans des conditions de confinement extrêmement rigoureuses.
Epidémiologie
Le virus Ebola a été observé pour la première fois en 1976, lors de deux flambées simultanées au
Soudan (151 morts) et en République démocratique du Congo (280 morts). Il a été baptisé « Ebola »,
du nom d’une rivière coulant dans ce dernier pays.
Le virus Ebola appartient à la famille des Filoviridae (filovirus) qui compte cinq espèces distinctes :
Bundibugyo (BDBV), Zaïre (EBOV), Reston (RESTV), Soudan (SUDV), Forêt de Taï (TAFV). Les
souches Ebola Bundibugyo, Zaïre et Soudan ont été responsables d’une vingtaine de flambées de la
maladie en Afrique Centrale, dans des villages isolés, à proximité des forêts. Les principales flambées
ont eu lieu en :
1995 : 254 morts en République démocratique du Congo,
2000 : 224 morts en Uganda,
2003 : 128 morts au Congo,
2007 : 187 morts en République démocratique du Congo.

Jusque là, le virus avait provoqué 1590 morts.
En mars 2014, une nouvelle flambée de l’Ebolavirus Zaïre a été identifiée en Guinée forestière, puis
s’est étendue aux pays voisins, le Libéria et la Sierra Leone, atteignant des zones urbanisées. Le virus
a ensuite été transmis par voie aérienne au Nigéria et par voie routière au Sénégal. Début septembre
2014, on dénombre environ 4000 cas d’infection dont 2000 morts, ce qui correspond à un taux de
létalité de 50%. Il s’agit de la plus importante épidémie connue à ce jour.
Le traitement
Les personnes atteintes ont besoin de soins intensifs, traitant uniquement les symptômes (fièvre,
douleur, déshydratation). Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement, ni vaccin homologués par les
autorités de santé.
A l’Institut Pasteur
L’Institut Pasteur et le Réseau International des Instituts Pasteur offrent leur assistance
au plan d’aide international en matière d’appui au diagnostic et de surveillance
épidémiologique, mis en œuvre en collaboration avec le ministère de la santé guinéen.
Plusieurs équipes de l’Institut Pasteur sont notamment impliquées dans le cadre de leur
mandat de Centre collaborateur de l’OMS pour les fièvres hémorragiques virales et les
arbovirus. De l’identification du virus Ebola en Guinée en mars 2014 jusqu’au projet d’un
nouvel Institut Pasteur à Conakry, qui ouvrira ses portes en 2016, plusieurs structures
sont impliquées en première ligne dans la lutte contre le virus.
EN AFRIQUE
Un laboratoire P4 mobile en Guinée
Un laboratoire P4 mobile a été déployé dès le début de l’épidémie en Guinée pour apporter sur le
terrain une aide à la réalisation du diagnostic. Ce laboratoire a été développé dans le cadre d’un projet
européen “EMP4″ dont le laboratoire P4 Jean Mérieux-Inserm, à Lyon, est le partenaire français.
Celui-ci abrite le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales, rattaché à l’unité de
biologie des infections virales émergentes de l’Institut Pasteur, dirigée par Sylvain Baize. C’est cette
équipe qui a analysé les premiers échantillons prélevés en Guinée, et qui a établi le premier diagnostic
positif.
Le premier laboratoire africain de diagnostic à Conakry (Guinée)
L’Institut Pasteur de Dakar, qui abrite le Centre collaborateur de l’OMS pour les arbovirus et les fièvres
hémorragiques virales, a été sollicité en mars 2014 par l’OMS et le gouvernement guinéen, pour
apporter son concours à l’enquête sur l’épidémie. L’Institut Pasteur de Dakar est ainsi la première
structure africaine à avoir installé un laboratoire en Guinée (Conakry) et à avoir confirmé des cas
suspects.
Ce laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar s’est ensuite déployé, avec trois virologistes et des
experts de l’Institut Pasteur de Paris ainsi que du matériel, à l’hôpital Donka à Conakry où se trouve le
centre de traitement des patients. Il apporte son aide dans la gestion des cas, l’enquête
épidémiologique et l’identification des cas contact par le diagnostic des cas suspects à Conakry et
dans les autres foyers en Guinée. Le laboratoire de l’IPD a identifié le premier cas confirmé de fièvre
Ebola à Conakry et au Libéria. Les équipes de l’Institut Pasteur et de l’Institut Pasteur de Dakar ont
aussi formé des techniciens guinéens au diagnostic du virus Ebola et aux méthodes de prélèvement
chez les patients.
A l’Institut Pasteur de Dakar (Sénégal)

A Dakar, en première ligne de la lutte contre le virus Ebola et en parallèle de son implication en
Guinée, l’Institut Pasteur s’est très fortement mobilisé dès le début de l’épidémie : l’équipe du Dr
Amadou Sall a pris en charge l’analyse des échantillons de cas suspects venant d’Angola, de Gambie,
du Mali et du Sénégal.
EN FRANCE
Le Centre National de Référence des Fièvres Hémorragiques Virales (Lyon)
Le laboratoire P4 Jean Mérieux-Inserm de Lyon a été très fortement mobilisé dès le début de
l’épidémie. Cette structure abrite le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales,
rattaché à l’unité de biologie des infections virales émergentes de l’Institut Pasteur, dirigée par Sylvain
Baize.
Cette équipe a analysé les premiers échantillons prélevés en Guinée, et a établi un diagnostic positif.
Des échantillons sanguins prélevés chez 20 patients ont également été analysés par les chercheurs.
Des tests ont été menés afin d'établir une carte d'identité spécifique du virus.
Cette équipe est en première ligne de lutte contre le virus Ebola. Outre l’analyse des échantillons à
Lyon et de la surveillance des cas suspects sur le territoire français, elle participe depuis fin novembre
2014 à l’activité du centre de diagnostic de Macenta.
En France, le Centre National de Référence des Fièvres Hémorragiques Virales, intégré au sein de
l’unité de Biologie des infections virales émergentes de l’Institut Pasteur à Lyon, dirigée par Sylvain
Baize, est désigné par le Ministère de la Santé. Il est chargé en liaison étroite avec l’Institut national
de Veille Sanitaire (InVS) de contribuer au diagnostic et d’assurer la surveillance épidémiologique des
fièvres hémorragiques virales.
Le CNR a pour missions :
- l’expertise microbiologique et le conseil auprès des professionnels de santé, et des laboratoires,
-- l’analyse des prélèvements suspects : gestion des prélèvements à leur arrivée sur le
site, identification et caractérisation des souches au sein du laboratoire de haute sécurité P4,
- la communication des résultats obtenus,
- la surveillance épidémiologique en France et à l’international,
- l’alerte des autorités compétentes de santé publique,
- le développement de nouveaux réactifs in vitro et in vivo : prise en compte des nouvelles
émergences virales et développement de nouvelles techniques pour les virus déjà connus,
- la recherche appliquée liée aux activités du CNR.
La Cellule d'Intervention Biologique d'Urgence (CIBU) (Institut Pasteur à Paris)
Dans le cadre de l’épidémie d’Ebola sévissant depuis début 2014 en Afrique de l’Ouest, la CIBU,
dirigée par Jean-Claude Manuguerra, a contribué à l’activité de diagnostic des échantillons prélevés en
Guinée, en collaboration avec l’équipe du CNR de Lyon. En parallèle, cette structure assure la
formation des scientifiques volontaires envoyés au sein du centre de Macenta pour assurer l’activité de
diagnostic. Des membres de l’équipe doivent eux-mêmes se rendre sur place pour participer à
l’activité.
La CIBU a pour mission de :
- répondre aux urgences microbiologiques 7/7 jours et 24/24 heures,
- détecter et identifier dans l’urgence des agents infectieux couverts par les plans de santé publique,
et les agents de classe 4 en lien avec le laboratoire P4 de Lyon,
- mener une recherche appliquée de développement de techniques innovantes permettant
l’identification rapide d’agents inconnus,
- mettre à profit son expertise à l’international en cas d’urgence représentant une menace pour la
sécurité sanitaire en France,
- informer sans délai l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) en cas de détection de tout
phénomène inhabituel susceptible d’avoir un impact sur la santé publique.

La CIBU dispose d’un laboratoire confiné de haute sécurité afin de manipuler les prélèvements.
Le Centre Collaborateur de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour les Fièvres
Hémorragiques Virales et les Arbovirus (CCOMS-FHV/Arbo)
Dirigée par Noël Tordo, cette équipe développe des activités de recherche et d’expertise. Le CCOMS-
FHV/Arbo fait partie d’un réseau international d’une dizaine de laboratoires experts équivalents. Dans
le cadre de ses missions effectuées sous la tutelle de l’OMS, il développe les activités suivantes :
- production et distribution à l’échelle nationale et internationale de matériels biologiques de référence
(souches virales, réactifs pour le diagnostic…),
- développement de nouveaux outils et de méthodes innovantes pour le diagnostic des virus à l’origine
de fièvres hémorragiques,
- développement et maintien d’une capacité d’intervention sur le terrain en cas d’épidémie,
- surveillance des animaux réservoirs et des vecteurs des virus de fièvres hémorragiques,
- organisation de formations théoriques et pratiques pour les professionnels en charge de la
surveillance et du contrôle des fièvres hémorragiques virales sur le terrain.
Les projets de recherche à l’Institut Pasteur à Paris
Un vaccin sûr et efficace contre le virus Ebola
Au sein de son unité Génomique virale et vaccination, Frédéric Tangy et son équipe développe, en
collaboration avec l’unité de Sylvain Baize (Biologie des infections virales émergentes) un projet
vaccinal contre le virus Ebola. L’approche des chercheurs repose sur la technologie de l’actuel vaccin
pédiatrique contre la rougeole, un des plus sûrs et des plus efficaces disponibles aujourd’hui. Depuis
40 ans, celui-ci a en effet été administré à plusieurs milliards d'enfants dans le cadre des campagnes
de vaccination de l’OMS. Il présente également l’avantage de pouvoir être produit à grande échelle,
rapidement et à un coût raisonnable. Le candidat vaccin des chercheurs de l’Institut Pasteur est
élaboré à partir du vaccin rougeole, dans lequel est introduit un déterminant du virus Ebola. Il
vaccinerait ainsi à la fois contre la rougeole et contre Ebola, et pourrait être administré aux adultes,
mais également aux enfants. Les chercheurs testent actuellement trois combinaisons différentes de ce
modèle vaccinal. Ils espèrent pouvoir démarrer les essais cliniques très prochainement.
Améliorer le diagnostic
Aujourd'hui, le processus de diagnostic Ebola prend en moyenne deux à trois jours, et nécessite des
équipements sophistiqués et du personnel hautement qualifié. Le virus n’est en outre détectable qu’à
l’apparition des premiers symptômes. Réduire le temps et les risques associés à la procédure de
diagnostic actuel est aujourd’hui essentiel pour permettre de mieux prendre en charge les malades et
augmenter chances de guérison.
A l’Institut Pasteur, deux programmes de recherche sont consacrés à la mise au point de tests de
diagnostic rapides, peu chers, et facilement utilisables sur le terrain ou par les hôpitaux. Le premier
est un test de diagnostic de terrain. Il sera testé dès janvier 2015. Le second, dont l’utilisation
nécessitera l’intervention d’un personnel de santé, est destiné aux hôpitaux. Ultra-sensible, il sera
capable de détecter la présence du virus dans les échantillons avant même l’apparition des
symptômes.
Un traitement évolutif accessible au plus grand nombre
Les équipes de Pierre Charneau (unité de Virologie moléculaire et vaccinologie) et de Patrick England
(plate-forme de Biophysique moléculaire) se penchent sur la mise au point d’un vaccin thérapeutique

anti-Ebola. Celui-ci est capable d’agir en prévention de la maladie, mais également comme un
traitement post-exposition, au même titre qu’un médicament. Il pourrait ainsi être destiné aux
personnes déjà infectées par le virus, mais également aux personnel médical travaillant avec des
patients. Les quelques traitements existants actuellement contre l’infection Ebola sont pas disponibles
en raison de leur rareté, de leurs coûts élevés et du retard de leur production. Le candidat-vaccin
proposé par les équipes de l’Institut Pasteur s’est montré efficace à une dose très faible et faible coût.
La technologie sur laquelle il s’appuie repose sur l’utilisation de vecteurs lentiviraux. Ces derniers sont
des virus inactivés, capables d’introduire de façon stable un ADN antigénique dans les cellules de
l’organisme. Le candidat-vaccin ainsi élaboré est capable d’induire une réponse immunitaire de
protection en quelques jours, après une injection unique. En stimulant très tôt et très fortement les
défenses immunitaires de l’organisme, il lui permet ainsi de prendre de vitesse le virus. La conception
de ce vaccin et son optimisation en vue des tests chez des modèles animaux pourraient être réalisées
dans les prochains mois. Les essais sur le terrain pourront alors ensuite débuter.
Mieux comprendre le virus
Pour mettre au point de meilleures stratégies de traitement et concevoir des vaccins efficaces, il est
essentiel comprendre la physiologie de l’infection par le virus Ebola. Anavaj Sakuntabhai, chef de
l’unité Génétique fonctionnelle des maladies infectieuses, mène dans ce cadre un projet visant à
séquencer le génome du virus. Les scientifiques vont ainsi analyser près de 600 échantillons
provenant de patients guinéens, conservés à l'Institut Pasteur de Dakar (Sénégal). L’objectif de ces
recherches est notamment d’améliorer la connaissance de la réaction immunitaire de l’homme face au
virus, et notamment de comprendre pourquoi certaines personnes ne survivent pas à l’infection, alors
que d’autres parviennent à la combattre. Les chercheurs espèrent également que ces travaux fournir
des données sur la manière dont le virus évolue et se transmet, d’individu en individu, pour pister sa
propagation.
--
Illustration : Virus Ebola (famille des
Filoviridae
). Virus filamenteux (le plus long que l'on connaisse).
--
Décembre 2014
Les équipes de l’Institut Pasteur mobilisées sur le virus Ebola
Centre national de référence des Fièvres Hémorragiques Virales,
dirigé par Sylvain Baize
Cellule d’intervention biologique d’urgence,
dirigée par Jean-Claude Manuguerra
 6
6
1
/
6
100%