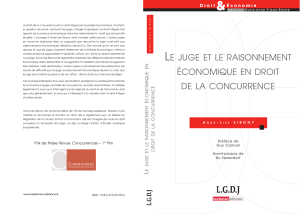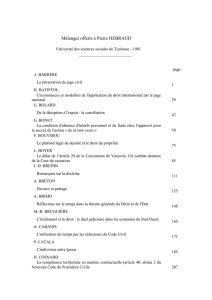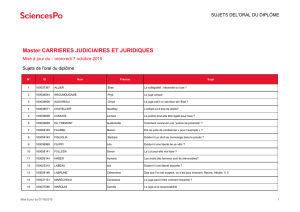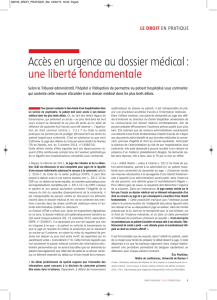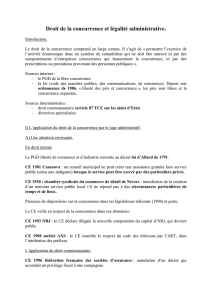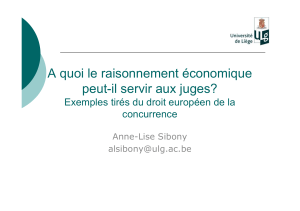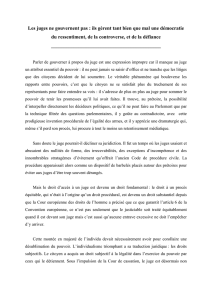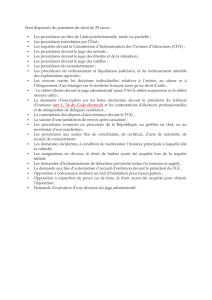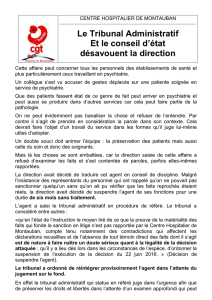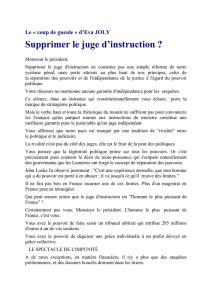Chapitre 3 : quelques éléments sur la production de droit législatif et

1
ÉCONOMIE DU DROIT
Séance 1 – jeudi 4 octobre 2012
Sophie.harnay@u-paris10.fr
-> On travaillera sur un « marché » du droit.
Bibliographie :
McKaay et Stephan Rousseau (2008) ANALYSE ECONOMIQUE DU DROIT, Dalloz (Thémis)
Anthony Ogus et M. Faure, ECONOMIE DU DROIT : LE CAS FRANÇAIS. Édition Panthéon Assas.
Thierry Kirat, ECONOMIE DU DROIT, Repère, édition la découverte
Bruno Deffains, E. Langlais, ANALYSE ECONOMIQUE DU DROIT, 2010
Harnay, Marciano, POSNER : L’ANALYSE ECONOMIQUE DU DROIT, Michalon.
Samuel Mercuro, Steeve Medema, 1997, ECONOMICS AND THE LAW.
Schäfer et Ott, 2004. THE ECONOMIC ANALYSIS OF CIVIL LAW.
Évaluation :
2h
deux questions : une question générale (réflexion, transversale, requérant des
connaissances d’économie du droit voire plus large en éco ou en droit),
-> problématique + un plan, une vraie introduction, une petite conclusion
+ une question plus courte de cours.
CHAPITRE 1 - PRESENTATION ET CONCEPTS
FONDAMENTAUX DE L’ECONOMIE DU DROIT
Définition – « Law and economics » ou « économie du droit ». Utilisation des outils et
de la méthodologie de la science économique pour analyser les phénomènes juridiques.
Sujet d’analyse :
- La nature et l’origine du système juridique existant.
- Ce sont les effets de la structure juridique sur l’efficacité allocative (= efficacité de
l’économie). Ex : regarder si les règles de responsabilité en vigueur incitent les agents à
prendre des décisions efficaces.
- Les conditions nécessaires au développement et à l’émergence de structures
juridiques efficaces
- L’application/mise en œuvre de la structure juridique
Traditionnellement on considère que l’économie du droit est née dans les années 50-60
au sein de l’université de Chicago. Les pères fondateurs sont notamment :
* Henry MANNE
* Ronald COASE
* G. CALABRESI
* R. POSNER
Ces deux derniers sont des praticiens ce qui traduit la démarche pragmatique initiale
dans l’économie du droit.

2
Vraie montée en puissance de l’économie du droit à partir des années 1970 -> c’est un
mouvement de pensée assez récent.
On va s’intéresser dans ce cours ce qui ressort de l’école de Chicago, et ses
prolongements. On s’intéressera aussi par la force des choses au système de Common Law
en raison de l’origine essentiellement anglo-saxonne de l’économie du droit.
1. LA METHODE ECONOMIQUE ET LE DROIT
1.1. Le concept de rareté
La rareté justifie le recours à la science économique. En effet pendant longtemps on a
considéré que l’économie étudiait tout ce qui avait un rapport avec la richesse.
J.B. Say (1803) : l’économie étudie la manière dont se
forment, se distribuent et se consomment les richesses.
Cette définition implique une série de choix qui nous conduit à une 2nde définition :
l’économie est la science des choix. Sachant que la science économique va être préoccupée
par l’utilisation des ressources dans une situation de rareté. La rareté faisant qu’un choix
prive de la possibilité d’en faire un autre.
Lionel Robbins, (1932) : l’analyse économique étudie la
façon dont les individus ou la société emploient les ressources
rares à des usages alternatifs en vue de satisfaire leurs besoins.
Cela va conduire à une 1ère opposition entre
- les biens libres -> bien disponible en abondance, pour lequel le marché et le prix
n’ont pas de signification.
- les biens privés (≈ biens économiques) -> bien non disponible de façon limitée donc
qui est soumis à une contrainte de rareté.
Idée du coût d’opportunité : coût de sacrifice, satisfaction à laquelle on renonce en
effectuant un choix plutôt qu’un autre. C’est la valeur du bien ou service de l’essai, ou un
coût de renonciation ou un coût de sacrifice.
L’économie du droit va appliquer ces définitions de l’économie à des domaines qui
n’appartiennent pas traditionnellement à l’économie.
1.2. Une extension progressive du champ de
l’investigation économique
ROBBINS lui-même souligne que sa définition n’exclue aucun domaine de l’activité
humaine en tant que tel. Dès lors que ces activités impliquent un arbitrage entre différentes
alternatives dans un contexte de rareté.
Tout type de comportement humain appartient au domaine des généralisations
économiques et il n’y a donc pas de limites à l’objet de la science économique.

3
Cette idée va être reprise une trentaine d’années plus tard : Gary BECKER (prix
Nobel). Dans son discours Nobel en 1992 va dire la même chose que ROBBINS. Alors qu’il
est de l’école de Chicago.
Gary BECKER (1992) — Toute question qui pose un problème
d’allocation de ressource et de choix dans une situation de
rareté caractérisée par l’affrontement de finalités
concurrentielles relève de l’économie.
Cela va justifier, pour BECKER, d’utiliser l’analyse économique pour étudier les
comportements hors marché / non-marchand.
Ça va justifier « l’impérialisme économique ».
À partir des années 1960, BECKER va s’attacher à analyser l’ensemble des sciences
sociales en utilisant le prisme micro-économique (en particulier, la sociologie).
Il va s’attacher à étudier des comportements humains qui jusqu’alors n’étaient
étudiés que par la sociologie, sous l’angle économique.
BECKER est connu pour ses travaux sur l’économie de l’éducation. Par ailleurs il est
à l’origine de la notion de capital humain.
BECKER nous explique que l’éducation est un investissement au même titre qu’un
investissement en machines ou en équipements. Qu’il est donc possible d’une analyse
micro-économique. Et que les individus vont choisir un niveau d’investissement en
éducation optimal en comparant les gains et bénéfices actualisés de cet investissement
dans le temps.
BECKER analyse ce qui concerne la famille. Il va proposer une analyse de la famille
comme une PME. Famille = PME. En particulier, la fonction de production de la famille c’est
des enfants.
BECKER est également à l’origine de l’économie du crime. -> Le choix de s’engager
dans une activité criminelle c’est une décision économique : on va comparer des avantages
et des coûts. On compare le gain qu’on retire d’un crime, p. ex. le vol, qu’on balance avec le
coût qui est calculé par le risque d’être arrêté. Le coût est une probabilité, et aussi en
fonction de la peine prévue pour un tel crime.
Cette économie a donné lieu à la théorie économique de la dissuasion.
Ce n’est pas quelque chose de détacher du réel. Cette théorie va vraiment être à la base
d’un certain nombre de politiques judiciaires.
À retenir : BECKER ouvre la voie à l’étude par l’économie de comportements jusqu’alors
non marchands, non traités par l’économie mais par d’autres sciences sociales. Il a ouvert la
voie à une grande littérature économique : la théorie du langage, l’économie de la religion,
l’économie des interactions sociales, l’économie du terrorisme, liberté d’expression,
comportements d’adoption (marché d’enfants), dons d’organe.
1.3. L’économie du droit comme théorie des choix
rationnels : le droit est un système d’incitations
Tous les comportements étudiés vont tomber sous l’hypothèse économique de
rationalité.
Pour les économistes, le droit = système d’incitations.

4
1.3.1. L’hypothèse d’individualisme méthodologique
et de rationalité individuelle : l’homo œconomicus
Individualisme méthodologique : l’individu = unité de base pertinente pour l’analyse.
≠ Des analyses de type holiste : elles mettent en avant la société et les institutions à
l’échelle de l’analyse.
Selon l’individualisme méthodologique, les phénomènes macro dans une société
peuvent se réduire à/ou être expliqués par les choix individuels. Cette hypothèse permet de
recourir à la notion d’homo œconomicus caractérisé par une rationalité individuelle qui va
constituer l’hypothèse comportementale principale de l’analyse économique du droit.
L’homo œconomicus est un être rationnel : il met en œuvre des moyens pour atteindre
des fins.
La rationalité économique signifie que les individus cherchent toujours le maximum de
satisfaction et donc exploitent toujours toute occasion d’améliorer leur situation.
Un individu est dit rationnel lorsqu’il choisit un comportement optimal par rapport au
but qu’il cherche à atteindre. Ces buts étant clairement identifiés par l’individu.
Toute action, par suite est le résultat d’un calcul. En d’autres termes, c’est donc le
résultat d’une analyse coût-avantage par laquelle un individu évalue et compare les gains et
coûts associés à une action, une décision, ou un comportement. Il choisit donc la décision
ou le comportement relatif du coût ou de l’avantage.
En d’autres termes on est en présence d’une rationalité optimisatrice.
On va la qualifier parfois de rationalité substantive.
Elle opère sous contrainte de ressources. Donc finalement le postulat de rationalité va
avoir une double signification.
Tout comportement humain va être étudié comme la maximisation d’un objectif sous
contrainte. La solution de ce problème va donner un équilibre individuel.
L’équilibre est défini comme la situation telle qu’aucune force n’est mise en œuvre
pour modifier la situation dans un sens ou dans un autre.
Séance 2 – jeudi 11 octobre 2012
1.3.2. Le droit comme système d’incitation
Rq : modèle néoclassique, conditions de la CPP, notamment l’information parfaite.
L’économie du droit considère qu’il existe un marché du droit. Sur ce marché, il y a
des offreurs et des consommateurs de règles juridiques. Sur ce marché, les règles vont
finalement associer des « prix » à certains types de comportement. En faisant varier les
règles, on va pouvoir orienter les comportements des agents en faisant indirectement varier
les prix associés à ces comportements. Ex : si une règle devient plus sévère (-> elle rend plus
coûteux un certain comportement), l’offre de ce comportement par les agents va diminuer.
À contrario si la règle devient plus laxiste, l’offre de ce comportement va augmenter.
C’est une analogie imparfaite, en particulier l’utilisation de la notion de prix est
sujette à caution. Par conséquent le droit est conçu comme un système d’incitations qui
vont encourager ou dissuader certains comportements.

5
Théorie économique de la dissuasion (« Crime and Punishment : an economic
approach », Gary Becker, JPE, 1968 + George Stigler, « Theory of public enforcement »)
Toutes les hypothèses de la microéconomie peuvent s’appliquer à son
comportement pour le criminel. Cela signifie que le criminel va faire une analyse coût-
avantage pour s’engager dans une activité criminelle.
C= p. f.
C : coût
P : probabilité d’être prix
F : « fine » -> amende pris au sens large, ça peut être une amende monétaire ou non
monétaire
Mon analyse coût-avantage donnera la chose suivante : lorsque l’espérance de gains du
comportement illégal est supérieur au coût éventuel de la sanction alors on s’engage dans
ce comportement illégal.
Si on veut augmenter le niveau de dissuasion, on peut soit augmenter la probabilité de
repérer les criminels, ou le choix d’augmenter la sanction qu’ils encourent. Dans les deux
cas ces deux politiques conduiront à l’augmentation du coût du comportement illégal pour
le criminel.
Niveau de dissuasion : D* -> socialement optimal souhaité par la société.
Becker : il est probablement préférable d’augmenter le niveau de la sanction encourue
parce que manipuler « f » est moins couteux pour la société que d’augmenter « p ».
Le niveau optimal de dissuasion, du point de vue social, on peut le définir comme Rm=Cm.
On retrouve chez Becker un point d’optimum caractérisé par une condition de 1ère ordre
semblable à la micro-économie classique.
En conséquence il n’est pas rationnel pour les autorités publiques d’augmenter à
l’infini leur effort de dissuasion : les moyens consacrés à la dissuasion. Il existe
symétriquement un niveau de tolérance optimal. Cela implique que dans certains cas
certaines fraudes sont impunies et doivent le rester parce qu’elles sont trop coûteuses à
sanctionner au regard du bénéfice qu’elles représentent.
La tolérance est justifiée non par laxisme, bonté d’âme ou idéologie mais par le calcul
économique. Il convient de prendre en compte certains bénéfices que ces comportements
rapportent à la société.
La forme de la politique de dissuasion :
C’est globalement moins couteux pour la société d’augmenter l’amende que
d’augmenter la probabilité (p). Néanmoins l’augmentation du niveau de la sanction se
heurte au principe de la dissuasion marginale. C’est dire qu’en fait plus une sanction est
déjà élevée, plus l’augmentation de cette sanction va produire un effet de plus en plus
faible.
Il faut observer une gradation dans les peines pour que celles-ci demeurent
effectivement dissuasives. En d’autres termes, il serait inefficace de sanctionner un délit de
faible ampleur par une sanction importante puisqu’une telle sanction risquerait d’entraîner
de la part des agents la substitution de comportements plus graves, socialement plus
nuisibles aux petits délits.
Le principe de dissuasion marginale : il faut qu’on grade les sanctions de façon
marginale entre les différentes peines pour les faires coïncider aux types de comportements
qu’on souhaite réprimer en tenant compte des délits qu’on souhaite réprimer.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%