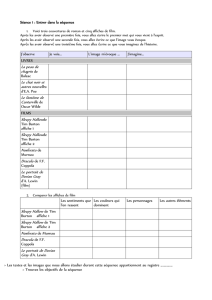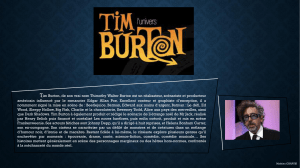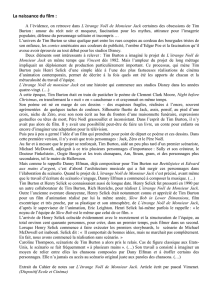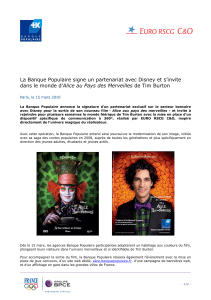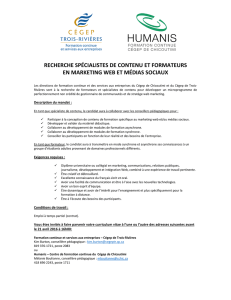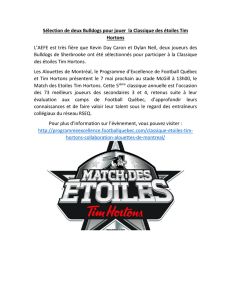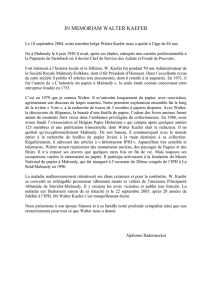À qui sont ces grands yeux tristes

À qui sont ces grands yeux tristes ?
Quand il réalisa Ed Wood, sublime portrait d’un artiste à l’exécrable production, il
y a plus de vingt ans, Tim Burton était au sommet de son art. Depuis, d’Alice en
Dark Shadows, on a vu le cinéma de Burton lui filer entre les doigts. Avec Big
Eyes, le réalisateur remet sur le métier le motif d’Ed Wood.
Il lui manque l’assurance souveraine qui était la sienne quand il mettait en scène les tribulations
du «pire réalisateur de l’histoire du cinéma», mais il faut convenir que le sujet de Big Eyes –
«l’œuvre d’un tâcheron dépourvu de goût» (pour reprendre les termes du critique du New York
Times en 1964) a au moins le mérite de pousser Tim Burton à sortir des ornières dans
lesquelles il s’était enfoncé. Le résultat est un film qui bouillonne d’une vitalité retrouvée, quitte
à dépenser en pure perte une partie de cette énergie.
Le destin des époux Keane, Walter et Margaret, est celui d’une double imposture. Au milieu des
années 1950, on vit apparaître aux murs d’une boîte de jazz de San Francisco des images
d’enfants tristes aux yeux démesurés («big eyes»). Le succès fut aussi vif que celui des clowns
tristes qui proliféraient alors en France. D’autant plus vif que le signataire des tableaux, Walter
Keane, était un génie de la publicité. Dans le sillage de ce quadragénaire séduisant, on
entrevoyait une petite femme blonde, Margaret, qui se disait également peintre, mais dont la
production restait hors de la vue du public.
Séducteur mercantile
Un divorce (en 1965) et un procès (en 1970) plus tard, l’imposture était dévoilée: les enfants
tristes étaient sortis de l’imagination de Margaret, et non des souvenirs européens d’après-
guerre de Walter qui, de toute façon, n’avait passé que quelques jours en Europe. Le fossé qui
sépare le destin des Keane de celui d’Ed Wood saute aux yeux : Ed Wood ne trompait que lui-
même, il était le seul à se prendre pour un cinéaste de génie; Walter Keane, aussi dépourvu de
talent artistique qu’il fût, parvint à imposer au public une peinture qui – si elle était méprisée par
l’establishment des galeristes et des critiques – lui rapporta des millions de dollars.

Et surtout, Ed Wood était seul, comme tous les grands héros de Tim Burton – Beetlejuice,
Batman, Edward aux mains d’argent. Les Keane forment un couple, et deux, c’est beaucoup
pour Burton. De Walter, le cinéaste se débrouille avec virtuosité. Il a confié le rôle de l’escroc à
Christoph Waltz, le plus démonstratif des acteurs. L’Autrichien en fait une caricature de
séducteur mercantile qui évoque un peu Pépé le Putois, le tombeur malodorant des cartoons de
Chuck Jones.
Quand il s’agit de mettre en scène les efforts frénétiques de Walter Keane pour devenir riche
sans effort, dans les rues aux couleurs acides de San Francisco (image bariolée du chef
opérateur Bruno Delbonnel) sur une musique presque hystérique (Danny Elfman, qui d’autre ?),
Big Eyes est un film profondément satisfaisant, même s’il n’ajoute pas grand-chose à la gloire
de son auteur.
Barbe-Bleue alcoolique
Quand il faut plonger dans la psyché de Margaret (Amy Adams), Tim Burton perd tout à coup
de son assurance. Il faut dire que le personnage est déconcertant : assez courageuse pour
plaquer son mari à une époque où le geste encourait la réprobation, elle se laisse cloîtrer par
son nouveau compagnon, peignant des jours entiers dans un réduit saturé de vapeurs de
térébenthine ; cette créatrice qui a inventé une nouvelle forme de représentation (certes
affligeante) finit par trouver son salut dans les rangs des Témoins de Jéhovah. C’est avec leur
soutien qu’elle se risque à revendiquer la maternité des enfants tristes.
Tim Burton s’empêtre dans ces contradictions, qui s’épanouiraient sans doute plus aisément
sous le regard de Paul Thomas Anderson. L’auteur des Noces funèbres ne trouve son compte
que dans le paroxysme, et les meilleures séquences du film sont celles qui montrent l’agonie du
couple Keane, pendant laquelle Walter se transforme en une espèce de Barbe-Bleue alcoolique
tandis que Margaret prend le dérèglement de sa vie pour de la folie.
Cette injection d’une bonne dose d’horreur gothique dans l’hédonisme californien produit des
effets spectaculaires. A ce moment, Tim Burton retrouve sa maîtrise de la démesure. Mais cette
emprise est fugace, et le metteur en scène est bientôt -désarmé par les rebondissements que la
réalité d’une histoire invraisemblable lui a imposés. Thomas Sotinel
© Le Monde
17 mars 2015
1
/
2
100%