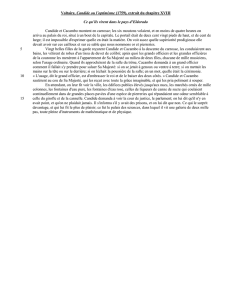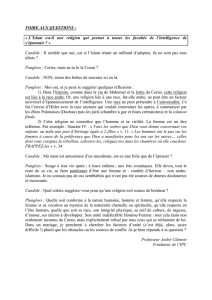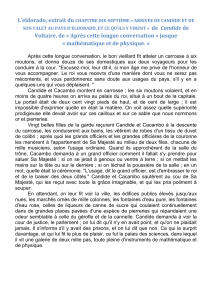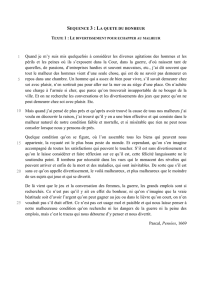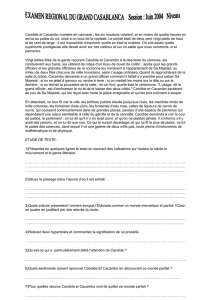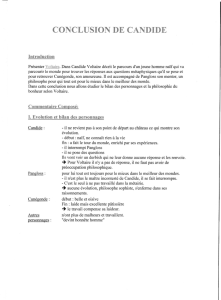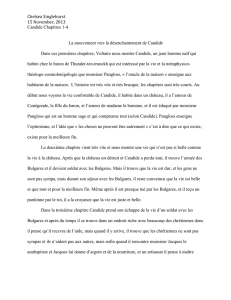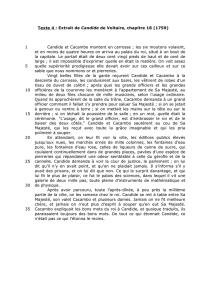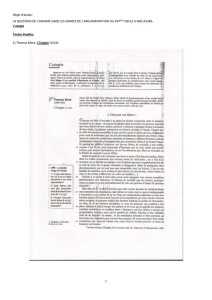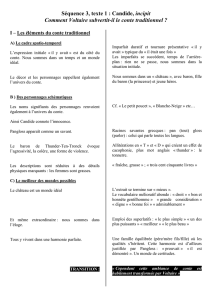Montesquieu, De l`esprit des lois, livre XV, chapitre V, De l

Montesquieu, Lettres persanes, lettre 46
Usbek à Rhédi, à Venise.
Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion ; mais il me semble qu'ils combattent
en même temps à qui l'observera le moins.
Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même meilleurs citoyens, et c'est ce
qui me touche: car, dans quelque religion qu'on vive, l'observation des lois, l'amour pour les
hommes, la piété envers les parents, sont toujours les premiers actes de religion.
En effet, le premier objet d'un homme religieux ne doit-il pas être de plaire à la divinité, qui a
établi la religion qu'il professe? Mais le moyen le plus sûr pour y parvenir est sans doute
d'observer les règles de la société et les devoirs de l'humanité; car, en quelque religion qu'on
vive, dès qu'on en suppose une, il faut bien que l'on suppose aussi que Dieu aime les hommes,
puisqu'il établit une religion pour les rendre heureux ; que s'il aime les hommes, on est assuré
de lui plaire en les aimant aussi, c'est-à-dire en exerçant envers eux tous les devoirs de la
charité et de l'humanité, et en ne violant point les lois sous lesquelles ils vivent.
Par là, on est bien plus sûr de plaire à Dieu qu'en observant telle ou telle cérémonie: car les
cérémonies n'ont point un degré de bonté par elles-mêmes ; elles ne sont bonnes qu'avec égard
et dans la supposition que Dieu les a commandées. Mais c'est la matière d'une grande
discussion: on peut facilement s'y tromper ; car il faut choisir les cérémonies d'une religion
entre celles de deux mille.
Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière: "Seigneur, je n'entends rien dans les
disputes que l'on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais vous servir selon votre volonté; mais
chaque homme que je consulte veut que je vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire
ma prière, je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle
posture je dois me mettre: l'un dit que je dois vous prier debout ; l'autre veut que je sois assis ;
l'autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est pas tout: il y en a qui prétendent
que je dois me laver tous les matins avec de l'eau froide ; d'autres soutiennent que vous me
regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m'arriva
l'autre jour de manger un lapin dans un caravansérail. Trois hommes qui étaient auprès de là
me firent trembler: ils me soutinrent tous trois que je vous avais grièvement offensé ; l'un,
parce que cet animal était immonde ; l'autre, parce qu'il était étouffé ; l'autre enfin, parce qu'il
n'était pas poisson. Un brachmane qui passait par là, et que je pris pour juge, me dit: " Ils ont
tort: car apparemment vous n'avez pas tué vous-même cet animal. - Si fait, lui dis-je. - Ah!
vous avez commis une action abominable, et que Dieu ne vous pardonnera jamais, me dit-il
d'une voix sévère. Que savez-vous si l'âme de votre père n'était pas passée dans cette bête? "
Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embarras inconcevable: je ne puis remuer la
tête que je ne sois menacé de vous offenser; cependant je voudrais vous plaire et employer à
cela la vie que je tiens de vous. Je ne sais si je me trompe ; mais je crois que le meilleur
moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où vous m'avez fait naître,
et en bon père dans la famille que vous m'avez donnée."
De Paris, le 8 de la lune de Chahban 1713.

Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XV, chapitre V, De l’esclavage des Nègres
Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves,
voici ce que je dirais :
Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en
esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.
Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par
des esclaves.
Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si
écrasé, qu'il est presque impossible de les plaindre.
On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une
âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.
Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de
l'humanité, que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les
noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une manière plus marquée.
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui chez les
Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, était d'une si grande
conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient
entre les mains.
Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas
d'un collier de verre que de l'or, qui chez des nations policées, est d'une si grande
conséquence.
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce
que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne
sommes pas nous-mêmes chrétiens.
Des petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains : car, si
elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes
d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale
en faveur de la miséricorde et de la pitié.

Article Autorité Politique, rédigé par Diderot.
Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un
présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il
jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle ;
mais la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l'état de nature elle finirait aussitôt
que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre
origine que la nature. Qu'on examine bien et on la fera toujours remonter à l'une de ces
deux sources : ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le
consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et à
qui ils ont déféré l'autorité.
La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant
que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent ; en sorte
que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts, et qu'ils secouent le joug, ils le
font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi
qui a fait l'autorité la défait alors ; c'est la loi du plus fort.
Quelquefois l'autorité qui s'établit par la violence change de nature ; c'est lorsqu'elle
continue et se maintient du consentement exprès de ceux qu'on a soumis ; mais elle
rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler ; et celui qui se l'était arrogée
devenant alors prince cesse d'être tyran.
La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des
conditions qui en rendent l'usage légitime utile à la société, avantageux à la république,
et qui la fixent et la restreignent entre des limites ; car l'homme ne peut ni ne doit se
donner entièrement et sans réserve à un autre homme, parce qu'il a un maître supérieur
au-dessus de tout, à qui il appartient tout entier. C'est Dieu dont le pouvoir est toujours
immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais de ses droits
et ne les communique point. Il permet pour le bien commun et le maintien de la société
que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un
d'eux ; mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et
sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas les droits du créateur. Toute autre
soumission est le véritable d'idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant
une image n'est qu'une cérémonie extérieure, dont le vrai Dieu qui demande le coeur et
l'esprit ne se soucie guère, et qu'il abandonne à l'institution des hommes pour en faire,
comme il leur conviendra, des marques d'un culte civil et politique, ou d'un culte de
religion. Ainsi ce ne sont pas ces cérémonies en elles-mêmes, mais l'esprit de leur
établissement qui en rend la pratique innocente ou criminelle. Un Anglais n'a point de
scrupule à servir le roi le genou en terre ; le cérémonial ne signifie que ce qu'on a
voulu qu'il signifiât, mais livrer son coeur, son esprit et sa conduite sans aucune
réserve à la volonté et au caprice d'une pure créature, en faire l'unique et dernier motif
de ses actions, c'est assurément un crime de lèse-majesté divine au premier chef...

Rousseau, Confessions, incipit
Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont
l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes
semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet
homme ce sera moi.
Moi seul. Je sens mon cour et je connais les hommes. Je ne
suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus ; j'ose croire être
fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas
mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien fait ou mal
fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont
on ne peut juger qu'après m'avoir lu.
Que la trompette du Jugement dernier sonne quand elle
voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le
souverain juge. Je dirais hautement : "Voilà ce que j'ai fait, ce
que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la
même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon,
et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce
n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon
défaut de mémoire ; j'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir
pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré
tel que je fus ; méprisable et vil quand je l'ai été, bon,
généreux, sublime, quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon intérieur
tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel rassemble autour de
moi l'innombrable foule de mes semblables ; qu'ils écoutent
mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils
rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son
tour son cour aux pieds de son trône avec la même sincérité ;
et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose : Je fus meilleur que cet
homme-là.

Rousseau, Confessions, Livre I, L’épisode du peigne
J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis
sécher à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il
s'en trouva un dont tout un côté de dents était brisé. A qui s'en prendre de ce dégât? personne
autre que moi n'était entré dans la chambre. On m'interroge: je nie d'avoir touché le peigne.
M. et mademoiselle Lambercier se réunissent, m'exhortent, me pressent, me menacent: je
persiste avec opiniâtreté; mais la conviction était trop forte, elle l'emporta sur toutes mes
protestations, quoique ce fût la première fois qu'on m'eût trouvé tant d'audace à mentir. La
chose fut prise au sérieux; elle méritait de l'être. La méchanceté, le mensonge, l'obstination,
parurent également dignes de punition; mais pour le coup ce ne fut pas par mademoiselle
Lambercier qu'elle me fut infligée. On écrivit à mon oncle Bernard : il vint. Mon pauvre
cousin était chargé d'un autre délit non moins grave; nous fûmes enveloppés dans la même
exécution. Elle fut terrible. Quand, cherchant le remède dans le mal même, on eut voulu pour
jamais amortir mes sens dépravés, on n'aurait pu mieux s'y prendre. Aussi me laissèrent-ils en
repos pour longtemps.
On ne put m'arracher l'aveu qu'on exigeait. Repris à plusieurs fois et mis dans l'état le plus
affreux, je fus inébranlable. J'aurais souffert la mort, et j'y étais résolu. Il fallut que la force
même cédât au diabolique entêtement d'un enfant; car on n'appela pas autrement ma
constance. Enfin je sortis de cette cruelle épreuve en pièces, mais triomphant.
Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être puni
derechef pour le même fait; hé bien! je déclare à la face du ciel que j'en étais innocent, que je
n'avais ni cassé ni touché le peigne, que je n'avais pas approché de la plaque, et que je n'y
avais pas même songé. Qu'on ne me demande pas comment le dégât se fit, je l'ignore et ne le
puis comprendre; ce que je sais très certainement, c'est que j'en étais innocent.
Qu'on se figure un caractère timide et docile dans la vie ordinaire, mais ardent, fier,
indomptable dans les passions; un enfant toujours gouverné par la voix de la raison, toujours
traité avec douceur, équité, complaisance, qui n'avait pas même l'idée de l'injustice, et qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%