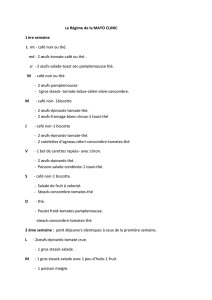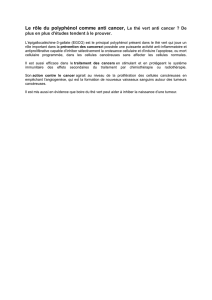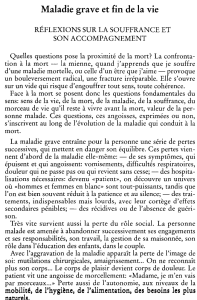fiche de lecture

1
DUPUIS Alexandre
N°Etudiant : 20401997
FICHE DE LECTURE
Le Livre du thé de Kakuzo Okakura
1) L’auteur :
Kakuzo Okakura, né en 1862 et mort en 1913, est un fervent défenseur des
traditions et des mœurs japonaises. C’est pourquoi il évoque régulièrement dans cette
œuvre ce qui oppose l’Orient à l’Occident, notamment dû à une certaine
incompréhension. Il a écrit Les Idéaux de l’Orient en 1903, Le Réveil du Japon en
1905 et Le Livre du thé en 1906. Toutes ces œuvres ont été écrites et publiées en
anglais et donc à l’intention de l’Occident.
2) Le résumé :
L’œuvre est composée de sept chapitres, qui sont sept parties bien distinctes ayant
chacune leur propre thème, mais qui ont tous rapport au thé.
Le premier chapitre se nomme La coupe de l’humanité. Il raconte l’histoire du thé,
où comment, avant de devenir une distraction élégante, il était utilisé en tant que
remède et ce, jusqu’au 8e siècle. Cette évolution des mœurs face à ce breuvage doré
est expliquée par le théisme, ou philosophie du thé. Ce théisme, qui possède également
ses philosophes du thé, est un culte de l’Imparfait. Et l’isolement du Japon face au
monde, a fait que cette philosophie s’est propagée dans tout le pays. Le thé s’est
également répandu en Occident, mais sans cette philosophie qui accentue
l’incompréhension de l’Occident face à l’Orient et qui pousse à voir le Japon comme
un pays barbare.
Le deuxième chapitre traite Des écoles de thé, qui dispensent les diverses méthodes
d’apprécier le thé et donc de le préparer. Le thé est comparé à l’art, et comprend
plusieurs évolutions au cour de l’histoire avec trois étapes principales : le thé bouilli
(gâteau de thé que l’on faisait bouillir), le thé battu (poudre de thé que l’on battait) et
le thé infusé (feuille de thé que l’on laissait infuser). Ces trois étapes sont
respectivement attribuées aux dynasties Tang, Song et Ming, qui étaient elles aussi
respectivement désignées comme les écoles classique, romantique et naturaliste du thé.
Au Japon, la préparation du thé ce fait sous la forme d’une cérémonie empreinte de
zen et le théisme y est qualifié de taoïsme déguisé.
Le troisième chapitre se nomme Taoïsme et zen. En effet la cérémonie du thé est un
développement naturel du rituel zen, et Lao-tseu, le fondateur du taoïsme, est
fortement lié à l’histoire du thé. L’intérêt que présente le taoïsme et le zen réside
surtout dans les idées touchant la vie et l’art qui sont incorporées dans le théisme. Le
taoïsme a fourni la base des idéaux esthétiques et le zen les a rendus pratiques.

2
Le quatrième chapitre parle de La chambre de thé. C’est une pièce qui est
généralement séparée physiquement de la maison. Elle est construite selon des règles
bien précises imposées par les maîtres de thé. C’est dans cette pièce que le maître
reçoit ses invités pour servir le thé. Tout n’y est que sobriété et humilité et cela est dû
notamment à la décoration où aucune couleur ne prend le dessus sur une autre, et à la
petite porte d’entrée qui force l’hôte (quelque soit son rang) à s’abaisser (en signe
d’humilité) pour entrer.
Le cinquième chapitre se nomme Du sens de l’art. Cette partie s’appuie notamment
sur un conte taoïste : La Harpe apprivoisée. La phrase le chef-d’œuvre est en nous et
nous sommes dans le chef-d’œuvre, résume bien ce conte. Il est écrit également que les
personnes ont un regard différent vis-à-vis de l’art et que rare sont les personnes qui
savent l’apprécier à sa juste valeur. De plus Kakuzo Okakura pense qu’à notre époque,
nous condamnons notre propre art en ne sachant regarder nos propres possibilités, et
que par conséquent nous couront à la stérilité de notre art.
Le sixième chapitre se nomme Les fleurs. L’auteur parle de la beauté des fleurs et
de la relation intime que l’on a avec elles : nous mangeons, nous buvons, nous
chantons, nous dansons, nous flirtons avec elles, nous nous marions et nous baptisons
avec des fleurs. Puis il se met à la place des fleurs pour dire la souffrance et le non
respect que les humains leurs infligent. Il compare le fait de les couper et de les
arracher à leur milieu naturel à de la torture. Notre amour pour la beauté des fleurs
passe donc par la destruction de la nature. Kakuzo Okakura détermine alors deux types
d’hommes : louons l’homme qui s’adonne à la culture des plantes ; homme au pot de
fleurs est infiniment plus humain que l’homme aux ciseaux. Celui qui cultive les
plantes en prend soin et les respectes. C’est ce que l’on retrouve dans l’arrangement
floral japonais que l’on aperçoit notamment dans les chambres de thé.
Et le septième chapitre à pour thème Les maîtres de thé. Ces derniers ont beaucoup
apporté à l’art. Ils ont par ailleurs influencé l’architecture et ce, pour ce qui est des
chambres de thé, mais aussi des jardins, des palais et des monastères. Outre
l’architecture, des maîtres de thé auraient également conçu les couleurs et les dessins
de certaines étoffes. Il faut savoir que pour eux, la coupe et la couleur des vêtements,
l’équilibre du corps, la façon de marcher, tout peut servir à la manifestation d’une
personnalité artistique. Mais leur influence s’est portée sur un grand nombre de
domaines, de sorte que de nos jours, on ressente encore ce qu’ils ont apporté dans le
passé.
3) Analyse d’une partie de l’œuvre (par rapport au cours) :
Analysons le passage se situant à la fin du deuxième chapitre Les écoles de thé :
« Nulle couleur ne venait troubler la tonalité de la pièce, nul bruit ne détruisait le
rythme des choses, nul geste ne gênait l’harmonie, nul mot ne rompait l’unité des
alentours, tous les mouvements s’accomplissaient simplement et naturellement – tels
étaient les buts de la cérémonie du thé. Il est assez étrange qu’elle ait eu tant de succès.
Une philosophie subtile y habite. Le théisme était le taoïsme déguisé. »

3
Si l’on analyse la première phrase, on retrouve le concept de non-agir (むい : 無為).
Ce concept implique que l’on s’abstient de toute action qui pourrait troubler
l’harmonie naturelle. En laissant faire toute chose, on arrive à la voie. Cette notion se
retrouve dans certains arts martiaux (par exemple : le judo). Il existe en réalité deux
notions :
- la notion de paradoxe où toute réalité est perçue de manière paradoxale (yin/yang)
- la notion de nature où une action ne peut être efficace que si elle va dans le sens
naturel
Et c’est bien ces notions que l’on retrouve dans la cérémonie du thé.
Or tout cela permet d’atteindre la voie (le tao : みち : 道), ce qui concorde bien avec la
dernière phrase de l’extrait : « Le théisme était le taoïsme déguisé. »
1
/
3
100%

![A2 NOUS FERONS LE TOUR DE LA TERRE défi[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/007746995_1-3f77e34f6b406c3b72deb0fbf7734b43-300x300.png)