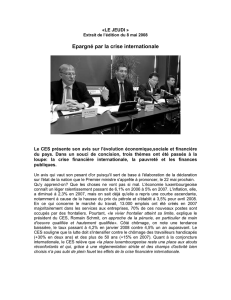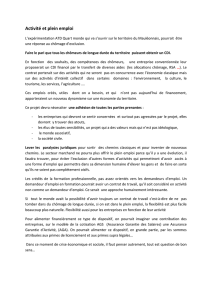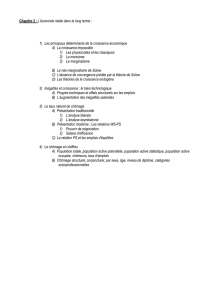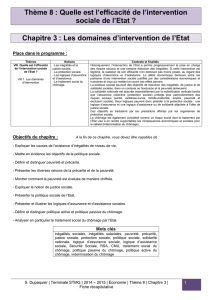Section 2 : Lien social et exclusion

L
L’
’E
Ex
xc
cl
lu
us
si
io
on
n,
,
l
l’
’é
ét
ta
at
t
d
de
es
s
s
sa
av
vo
oi
ir
rs
s
Sous la direction de Serge Paugam
Il n’existe pas d’exclusion dans l’absolu, car on ne peut être exclu de tout ! Cependant toute
organisation sociale, de la famille à la nation en passant par l’entreprise, implique l’inclusion des
uns et l’exclusion des autres, fonctionne selon un processus d’inclusion/exclusion. Quelles formes
ont pris aujourd’hui ces processus ?
I
I)
)
Q
Qu
u’
’e
es
st
t-
-c
ce
e
q
qu
ue
e
l
l’
’e
ex
xc
cl
lu
us
si
io
on
n
?
?
A) Intégration et exclusion dans les sociétés modernes
1
1) L’intégration/exclusion pendant les Trente Glorieuses et sa remise en cause
Pendant le « miracle » des Trente Glorieuses, l’intégration sociale a été assurée par le
développement économique, le travail pour tous (développement du salariat),
l’enrichissement collectif et même l’embourgeoisement. Chacun, y compris les
d’immigrés, estimait que ses enfants se feraient une place confortable dans la société,
meilleure que la sienne, ce qui leur faisait éventuellement accepter des conditions de
travail et de vie difficiles.
L’État-providence octroyait des ressources à ceux qui étaient provisoirement ou
définitivement hors du marché du travail : les mécanismes de redistribution
fonctionnaient comme des instruments de lutte contre le processus d’exclusion.
Aujourd’hui
- Pour certains, l’installation de nombreuses populations d’origine étrangère
constituerait un défi à l’État-nation et risquerait de remettre en cause l’intégration
sociale : risque de dissolution de la nation traditionnelle. Pour d’autres sociologues,
il s’agit de construire une « nouvelle citoyenneté », qui reposerait sur un
communautarisme de type anglo-saxon.
- Par ailleurs, le sentiment que le chômage ne disparaîtra pas conduit à s’interroger sur
les formes que peut prendre l’intégration sociale ; on accuse l’État-providence de ne
redistribuer les richesses qu’à l’intérieur des classes moyennes. Le pacte social des
Trente Glorieuses est donc remis en question.
2) L’intégration/exclusion politique
L’intégration politique se manifeste par la citoyenneté, qui donne le droit de voter, de
participer à la vie politique, d’être élu, d’occuper des emplois dans l’administration. Les
non-citoyens peuvent le devenir par acquisition de la nationalité française. Il est donc
possible d’intégrer une communauté politique, alors qu’il est impossible d’intégrer une
ethnie, un peuple (on ne peut pas devenir corse ou arabe, alors qu’on peut devenir
français).
Par ailleurs, dans les démocraties, les non-citoyens bénéficient des mêmes droits civils,
économiques et sociaux.
Il n’y a donc pas d’ « exclus » ou « d’inclus » a priori, il y a de nombreuses façons de
s’inclure et de nombreux processus qui conduisent à l’exclusion. On peut seulement
supposer que des personnes ont une probabilité différente de connaître un processus qui
les exclueront de la vie professionnelle, collective et relationnelle, jusqu’à la
marginalisation. Le risque le plus fort concerne celles qui cumulent les handicaps
sociaux (familles modestes et désunies, échec scolaire, absence de formation, chômage),
1
D’après Dominique Schnapper

mais même ce cumul ne conduit pas forcément à une rupture totale de tous les liens
sociaux, et cette rupture peut ne pas être définitive.
3) L’intégration/exclusion économique et sociale
La participation concrète des individus à la vie collective s’organise autour de deux
axes : emploi et protection sociale d’une part, relations sociales (famille, amis…),
politique (citoyenneté) et civile (associations, syndicats…) d’autre part.
Ces deux axes ne sont pas indépendants : il est plus difficile pour un individu
familialement isolé d’obtenir un emploi, et inversement, le chômage remet en question le
statut d’un père de famille et d’un mari, les liens amicaux.
Or, le premier axe s’est dégradé avec la fin du plein-emploi, la multiplication des
emplois précaires et le second avec l’affaiblissement des solidarités familiales. Les
risques d’apparition d’un processus d’exclusion se sont donc accrus.
4) La contradiction des politiques sociales
La politique d’intégration de l’État-providence apparaît débordée par l’ampleur des
problèmes à résoudre et le manque de moyens financiers. En même temps qu’elle permet
de disposer de quelques ressources (RMI), elle dévalorise et stigmatise ceux qu’elle
soutient en leur renvoyant une image d’ « assistés » et en soulignant leur échec.
Dans des sociétés globalement riches, des « miettes » permettent aux plus pauvres de ne
pas mourir de faim, mais elles n’empêchent pas d’éprouver un sentiment de frustration et
de privation relatives. Etre pauvre dans une société riche et ouverte, c’est vécu comme
un échec, une incapacité personnelle.
B) L’exclusion face au droit
1) De la Sécurité sociale aux minima sociaux
Les premiers minima sociaux sont instaurés à partir de 1930 et ont couvert progressivement
l’ensemble des risques (invalidité, vieillesse, famille, maladie). Leur généralisation et leur
amélioration ont permis de faire largement reculer la pauvreté liée à l’état (âge ou handicap)
dans les 70’s. Un risque n’est toutefois pas couvert : celui du chômage. Ce n’est qu’en 1988
avec le RMI, que sera institué un minimum social destiné à ceux qui, qu’elle qu’en soit la
raison, ne peuvent tirer du travail des ressources suffisantes.
2) L’insertion : le dédale des obligations croisées
Existe-t-il un droit à l’insertion ? Jusqu’à présent, l’objectif d’insertion a été défini par
rapport à l’accès à un revenu tiré du travail et la Constitution prévoit bien un droit au
travail : (« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi »).
Cependant le développement d’un chômage massif a montré que l’accès à l’emploi était
plus facile pour certains que pour d’autres.
Des mesures de discrimination positives ont été prises pour corriger les inégalités
d’accès : les handicapés (avec prise en charge par l’État d’une partie des coûts
salariaux), puis les jeunes peu qualifiés, les chômeurs de longue durée.
L’institution du RMI change les données du problème puisqu’il est attribué à tous
(condition de ressources) échange de l’aide sociale.
En période de chômage massif, le droit au travail reste purement théorique, et la société
se trouve confrontée à un dilemme : abandonner l’objectif constitutionnel de droit au

travail pour tous et le remplacer par un droit à un revenu minimum pour tous ; ou bien
faire en sorte que le travail pour tous reste un objectif raisonnablement atteignable.
I
II
I)
)
L
Le
es
s
t
tr
ra
aj
je
ec
ct
to
oi
ir
re
es
s
d
de
e
l
l’
’e
ex
xc
cl
lu
us
si
io
on
n
A) Socialisation et processus d’exclusion
Le terme d’exclusion est assez vague car il amalgame des situations très différentes. Les
caractéristiques communes sont l’absence durable d’emploi et la perte de relations sociales. D’une
certaine manière, l’exclusion est produite par des institutions diverses : école, entreprise, famille,
ville…
1) Les mécanismes de production de l’exclusion
Le système productif joue un rôle essentiel, car il génère un « chômage d’exclusion »
(chômage de longue durée). Une véritable discrimination à l’embauche s’est instaurée
pour tous ceux qui ne disposent pas des critères de « compétence » de la nouvelle norme
d’emploi : autonomie, initiative, responsabilité. La possession d’un diplôme agit comme
un premier filtre, mais la capacité à anticiper les attentes de l’employeur et à montrer sa
conformité avec celles-ci est essentielle. Or, cette capacité est créée par toute
l’ « histoire » individuelle, par le réseau de relations. Ceux qui ont eu des difficultés de
socialisation et aucune relation efficace sont généralement éliminés soit par non-
embauche, soit par licenciement.
Au cours des 80’s, la sélectivité à l’embauche s’est accrue aussi bien dans les entreprises
que dans les administrations : montée des emplois précaires, augmentation des
licenciements et des départs en pré-retraite. Le chômage de plus d’un an frappe en
priorité les personnes considérées comme les moins « employables » : travailleurs âgés,
jeunes sans diplôme, bas niveaux de qualification.
Cependant, la non-intégration dans le travail ne suffit pas à définir l’exclusion : celle-ci
s’accompagne aussi d’une non-insertion dans la sociabilité socio-familiale, une
dissolution du lien social (que Robert Castel appelle une désaffiliation). Ainsi, 75% des
RMIstes déclarent vivre seuls, 18% des femmes seules avec enfants touchent le RMI.
L’exclusion est donc aussi liée à la baisse de la nuptialité, à l’augmentation des divorces
et des ménages constitués d’une personne seule (en particulier âgée).
2) L’exclusion comme processus biographique
Depuis le début des 70’s des enquêtes ont suivi l’histoire individuelle de personnes, en
particulier les jeunes sortant de l’école et les chômeurs inscrits à l’ANPE. Des trajectoires
d’exclusion ont pu ainsi être repérées.
Concernant les chômeurs de longue durée au début des 90’s, les variables essentielles sont
dans l’ordre l’âge (+ de 45 ans ou – de 30), l’état-civil (mères de famille), l’absence de
diplôme, l’ancienneté du chômage (plus longtemps on est au chômage, moins on a de
chances de retrouver un emploi) ; les autres variables (nationalité, CSP, habitat) jouent plus
faiblement.
3) Synthèse
L’exclusion renvoie en fait aux processus de socialisation et à ses transformations : à la fois
la socialisation primaire (famille, parcours scolaire, acquisition d’un statut social) et
secondaire ((intégration au monde professionnel et reconnaissance d’une valeur sociale).
Elle est le résultat d’un double processus : structurel (transformations de l’accès au monde

du travail) d’une part, biographique et relationnel d’autre part, qui ont des liens mais aussi
une certaine autonomie.
B) De l’école à l’emploi : les parcours précaires
Les jeunes sont un groupe à risques car ils sont massivement victimes de la pénurie d’emplois, qui
les conduit de l’école au RMI voire à une marginalisation sociale encore plus nette. Cependant, ils
ne constituent pas un groupe homogène (grande différence entre les bacheliers et les autres).
1) Qu’est-ce que la précarité ?
On peut la définir comme l’absence d’un emploi stable, durable, avec un employeur unique,
à temps plein, avec un salaire ≥ SMIC, avec protection sociale. Le chômage, en soi, ne peut
suffire à définir la précarité : il existe un chômage de « file d’attente », avant insertion dans
un emploi régulier. Inversement, tout emploi ne signifie pas absence de précarité : les
emplois atypiques, la succession de CDD par exemple, est bien une situation de précarité
dans la mesure où la personne doit subir des périodes de chômage répétées qui la prive
temporairement de revenu et la contraigne d’accepter un autre CDD : il existe un cercle
vicieux de la précarité, le fait d’avoir accepté un emploi précaire auparavant risque
d’imposer d’en accepter un suivant. Avoir pris trop vite un emploi atypique peut paraître
suspect aux employeurs suivants, mais il est difficile pour certains jeunes de les refuser dans
la mesure où ils n’ont pas d’autres propositions… Mais il existe aussi des périodes de
précarité dans des carrières qui ne sont pas, dans l’ensemble, précaires.
La précarité se définit donc plutôt comme une succession de situations. Quand la succession
de situations de mauvaise qualité entraîne le sentiment que c’est le jeune lui-même qui est de
« mauvaise qualité », alors existe le risque d’un itinéraire irréversible de l’échec.
2) Les parcours observés
Au milieu des 70’s, sur 100 jeunes sortant de l’enseignement secondaire, 50% avaient un
emploi typique moins de neufs mois après ; dans les 90’s, 30%.
Sur les jeunes sortis de l’enseignement secondaire en juin 1989, 15% ont un CDI en
décembre, et il faut attendre décembre 1993 pour atteindre 50% ; 20% sont au chômage ;
19% ont un emploi atypique (10% d’inactifs).
3) Une stabilisation lente
Seuls 3% des jeunes sortant de l’école (entre 1989 et 1994) peuvent espérer trouver un
emploi l’été qui suit et le garder pendant 5 ans (ou plus) ; la durée moyenne d’accès à un
emploi est de quatre mois, deux ans pour atteindre un CDI ; 35% des jeunes n’ont jamais
obtenu un CDI au bout de 5 ans. Or le début du parcours professionnel est déterminant pour
la suite. Très rapidement les qualités et qualifications initiales vont perdre de leur
importance au profit du cursus professionnel : le fait de cumuler les petits boulots ou de
rester trop longtemps sans emploi devient alors un handicap définitif. La carte de visite
essentielle est au départ le diplôme, le rang de sortie, la spécialité de formation, qui permet
d’obtenir une première expérience ; dès lors, le nouvel employeur n’accordera plus une
grande importance au diplôme, mais à cette première expérience.
4) Les dispositifs d’aide à l’insertion sociale et professionnelle
Que fait l’État pour faciliter la transition école/entreprise ?. Les premiers dispositifs
apparaissent dans les années 80’s (contrats d’adaptation ou de qualification) et 90’s

(contrats emploi solidarité). En tout, plus d’une dizaine de dispositifs existent, basés sur
la baisse du coût du travail (baisse d’impôt ou prime pour l’employeur) et l’amélioration
de la formation.
Le recours à ces dispositifs est très précoce et concerne tous les niveaux de diplôme ou
de formation inférieurs au bac ; 70% de ces filles et 55% de ces garçons ont connu au
moins un de ces dispositifs
L’accès à ces dispositifs est lui-même sélectif : ce sont les plus employables de ces
jeunes (diplômés du BEP, spécialité demandée) qui en bénéficient le plus et qui vont par
la suite s’insérer rapidement. Les moins employables retournent au chômage à la fin du
dispositif ou accèdent aux dispositifs les moins efficaces (TUC, CES) qui les insèrent
moins rapidement et moins durablement. Plus le dispositif a été suivi tôt après l’école,
plus il est efficace.
A niveau de formation équivalent, les jeunes qui sont passés par des « mesures jeunes »
se retrouvent avec des salaires moins importants que ceux qui n’y sont pas passés : tout
se passe comme si passer par un dispositif d’aide les rendait moins exigeants.
En conclusion, certains dispositifs aident à s’insérer, d’autres au contraire stigmatisent
les jeunes et font baisser leurs prétentions salariales. Ces dispositifs sont hiérarchisés de
la même façon que les parcours scolaires (ceux ayant le meilleur capital scolaire ont
accès aux meilleurs dispositifs d’insertion).
C) Trajectoires de chômeurs de longue durée
1) Les déterminants du chômage de longue durée
On distingue généralement les déterminants « démographiques » (sexe, âge, nationalité,
situation familiale) et socio-économiques (formation, qualification, carrière) ; mais
d’autres déterminants existent : ancienneté préalable de chômage, conjoncture
économique globale ou locale.
Le risque de chômage de longue durée est inégalement réparti (âge, sexe, nationalité,
qualification). En moyenne, les personnes devenues chômeurs suite à un licenciement le
restent plus longtemps que celles en fin de contrat temporaire ; idem pour celles qui
vivent chez leurs parents ou dont la mère est inactive. La conjoncture économique
générale ne semble pas influencer le taux de sortie du chômage de longue durée (alors
qu’elle joue fortement sur le taux de sortie des autres). Il agit donc bien comme une
trappe, sauf reprise économique particulièrement forte.
On constate que plus le temps passé au chômage s’accroît, plus la probabilité d’en sortir
s’amenuise. Deux types d’analyse tentent d’expliquer le phénomène :
- pour les unes, il y a perte progressive d’aptitudes, découragement, sélectivité des
employeurs potentiels, cette durée affecte le capital humain ;
- pour les autres, cette baisse de probabilité s’explique mécaniquement par le fait que
les plus employables sortent les premiers du chômage, ne restent alors au chômage
de longue durée que les moins employables d’entre eux.
2) Les modes de sortie du chômage de longue durée
Le plus important est l’inactivité (les + âgés, les moins qualifiés) ; pour les jeunes, il
s’agit de contrats aidés, mais qui débouchent à leur tour sur une période de chômage : il
y a donc en ce qui les concerne un lien fort entre chômage récurrent et chômage de
longue durée, ils sortent du chômage de longue durée par le chômage récurrent.
Les jeunes préalablement en CDI retrouvent plus fréquemment un CDI, alors que les
jeunes préalablement en CDD retrouvent plus fréquemment un CDD. Il y a donc une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%