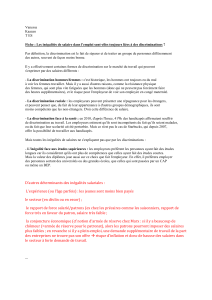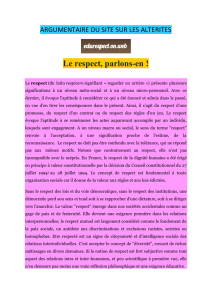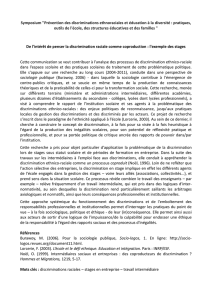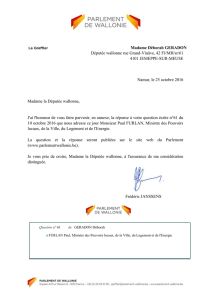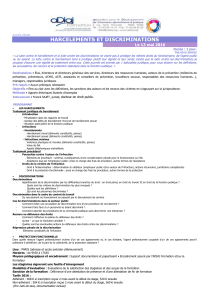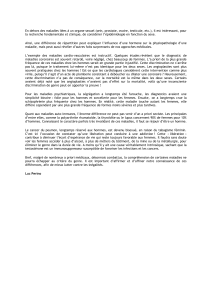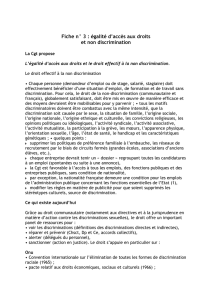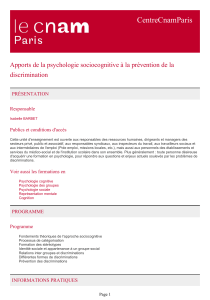Introduction - Réseau Terra

TERRA - Ed it i o ns, Co l l ection « E tudes » :
Programme Frontières – ANR
Note de recherche n°1
LA NOTION DE DISCRIMINATION DANS LES DEBATS ET L’ACTION PUBLICS :
LECTURE DE QUATORZE ANNEES DE LITTERATURE GRISE FRANÇAISE
(1992-2005)
Alexandre Tandé
Doctorant en science politique
(Université Paris 1 & Université Libre de Bruxelles)
Etude réalisée dans le cadre du programme
Les nouvelles frontières de la société française
(responsable : Didier Fassin)
soutenu par l’Agence nationale de la recherche
Cette étude a été conduite en collaboration avec
Didier Fassin, Sarah Mazouz et Olivier Noël
Iris, UMR CNRS-Inserm-EHESS-UP13
Paris, janvier 2008

________________________________________________
Ce texte de TERRA-Editions, Collection « Etudes » (http://terra.rezo.net/rubrique109.html) est sous copyright de son auteur et licence
"Creative Commons" ; pour le citer : A. Tandé, « La notion de discrimination dans les débats et l’action publics : lecture de quatorze années
de littérature grise française, (1992-2005) » Co-édition de l’IRIS, du Pgr FRONTIERES (ANR) et de TERRA-Editions., Coll. "Etudes"
(http://terra.rezo.net/article698.html), janvier 2008, 192 pages
2
INTRODUCTION 5
I. ACTEURS 8
I.1. Les « populations étrangères », « immigrées » et « issues de l’immigration » 8
I.1.1 Termes 8
Nommer par référence à la migration 8
Nommer par référence à la nationalité 11
Nommer par référence à l’ethnicité 12
Nommer par référence à la race 15
Nommer par référence à l’origine 16
Nommer par référence à la minorité 17
Nommer par référence au groupe ou à la communauté 17
Nommer par référence à la couleur et au patronyme 18
I.1.2 Thèmes et actions 19
Le thème de l’emploi 19
Le thème du logement 21
Les thèmes de l’éducation, de la scolarité et de la formation 22
Les thèmes de la citoyenneté et de la naturalisation 23
Le thème de l’appartenance communautaire 23
Le thème des pratiques culturelles 24
Le thème de la fécondité 25
Le thème de l’accès aux droits 25
Le thème des pratiques linguistiques 26
Le thème de l’image médiatique 26
Le thème de la mesure statistique 26
Le thème des pratiques religieuses 27
Le thème du militantisme syndical 27
I.2. L’État et les pouvoirs publics 28
I.2.1 Institutions intervenant dans le domaine de l’emploi 28
I.2.2 Institutions intervenant dans le domaine du logement 30
I.2.3 Institutions intervenant dans le domaine de l’éducation 32
I.2.4 Les enjeux migratoires, d’intégration et de non-discrimination 33
I.2.5 Institutions intervenant dans le domaine de la police 39
I.2.6 Institutions intervenant dans le domaine de la mesure statistique 39
I.3. Les entreprises 40
I.4. Autres acteurs 42
II. MODES DE PROBLEMATISATION 43
II.1. L’intégration 43
II.2. La discrimination 45
II.3. Le racisme 53
II.4. Autres modes de problématisation 55
III. PROPOSITIONS 58

________________________________________________
Ce texte de TERRA-Editions, Collection « Etudes » (http://terra.rezo.net/rubrique109.html) est sous copyright de son auteur et licence
"Creative Commons" ; pour le citer : A. Tandé, « La notion de discrimination dans les débats et l’action publics : lecture de quatorze années
de littérature grise française, (1992-2005) » Co-édition de l’IRIS, du Pgr FRONTIERES (ANR) et de TERRA-Editions., Coll. "Etudes"
(http://terra.rezo.net/article698.html), janvier 2008, 192 pages
3
III.1 Propositions dans le domaine de l’emploi 58
III.2 Propositions dans le domaine du logement 60
III.3 Propositions dans le domaine de l’éducation 60
III.4 Propositions sur les enjeux migratoires, d’intégration et de non-discrimination 61
III.5 Propositions dans le domaine de la justice 63
III.6 Propositions dans le domaine de la police 64
III.7 Propositions dans le domaine de la mesure statistique 65
III.8 Propositions dans le domaine religieux 65
III.9 Autres propositions et principes d’actions 66
IV. FICHES 67
Haut Conseil à l’Intégration, La connaissance de l’immigration et de l’intégration, rapport au Premier
ministre, La Documentation Française, décembre 1992. 67
JOIN-LAMBERT Marie-Thérèse, LEMOINE Michel, Enquête sur l’insertion des jeunes immigrés dans
l’entreprise, Inspection Générale des Affaires Sociales, janvier 1992. 72
TRIBALAT Michèle (dir), Enquête Mobilité Géographique et Insertion Sociale, Institut National d’Études
Démographiques, 1992. 75
FRÉAUD Anne-Marie, « L’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des jeunes d’origine étrangère à
Cergy-Pontoise », Migrations Études, janvier 1993. 81
PAPADOPOULOU Despina, « La situation au regard de l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi
des jeunes d’origine étrangère », Migrations Études, juillet-août 1993. 81
Observatoire des Mutations et des Migrations Internationales de la Région Nord-Pas de Calais, « La
situation au regard de l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des jeunes d’origine étrangère »,
Migrations Études, juillet-août 1993. 81
DE RUDDER Véronique, TRIPIER Maryse, VOURC’H François, La prévention du racisme dans
l’entreprise en France, rapport d’étude pour la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions
de Vie et de Travail, Unité de Recherches Migrations et Société, 1994. 86
Haut Conseil à l’Intégration, Liens culturels et intégration, rapport au Premier ministre, juin 1995. 89
MÉKACHERA Hamlaoui, GAEREMYNCK Jean, Pour une relance de la politique de l’intégration,
rapport de la Délégation à l’Intégration, novembre 1996. 93
NOËL Olivier, Les représentations et stratégies des intermédiaires sur le bassin d’emploi de Nîmes. Jeunes
issus de familles immigrées : accès à l’entreprise et processus de discrimination, Institut Social et Coopératif
de Recherche Appliquée, Notes et études, 1997. 97
DHUME Fabrice, Les « discriminations raciales » dans l’accès à l’emploi des jeunes en Alsace. État des
lieux exploratoire, Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, novembre 1997. 101
BATAILLE Philippe, Le racisme au travail, Éditions La Découverte, 1997. 106
DE RUDDER Véronique, POIRET Christian, VOURC’H François, La prévention de la discrimination
raciale, de la xénophobie et la promotion de l’égalité de traitement dans l’entreprise. Une étude de cas en

________________________________________________
Ce texte de TERRA-Editions, Collection « Etudes » (http://terra.rezo.net/rubrique109.html) est sous copyright de son auteur et licence
"Creative Commons" ; pour le citer : A. Tandé, « La notion de discrimination dans les débats et l’action publics : lecture de quatorze années
de littérature grise française, (1992-2005) » Co-édition de l’IRIS, du Pgr FRONTIERES (ANR) et de TERRA-Editions., Coll. "Etudes"
(http://terra.rezo.net/article698.html), janvier 2008, 192 pages
4
France, rapport pour la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail,
Unité de Recherches Migrations et Société, mars 1997. 113
Haut Conseil à l’Intégration, Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d’égalité, rapport
au Premier ministre, La Documentation française, 1998. 118
BELORGEY Jean-Michel, Lutter contre les discriminations, rapport à Madame la Ministre de l’Emploi et
de la Solidarité, mars 1999. 122
Groupe d’Étude et de Lutte contre les Discriminations, Une forme méconnue de discrimination : les
emplois fermés aux étrangers (secteur privé, entreprises publiques, fonctions publiques), Note n°1, mars
2000. 127
Groupe d’Étude et de Lutte contre les Discriminations, Le recours au droit dans la lutte contre les
discriminations : la question de la preuve, Note n°2, mars 2000. 130
Groupe d’Étude et de Lutte contre les Discriminations, Les discriminations raciales et ethniques dans
l’accès au logement social, Note n°3, 2001. 135
Haut Conseil à l’Intégration, Le contrat et l’intégration, rapport au Premier ministre, La Documentation
française, 2003. 141
Cour des Comptes, L’accueil des immigrants et l’intégration des populations issues de l’immigration.
Rapport public, Les Éditions des Jounaux Officiels, novembre 2004. 148
VERSINI Dominique, Rapport sur la diversité dans la fonction publique, rapport au ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’État, décembre 2004. 152
BLIVET Laurent, Ni quotas ni indifférence. L’entreprise et l’égalité positive, Institut Montaigne, octobre
2004. 157
BÉBÉAR Claude, Des entreprises aux couleurs de la France. Minorités visibles : relever le défi de l’accès à
l’emploi et de l’intégration dans l’entreprise, rapport au Premier ministre, Institut Montaigne, novembre
2004. 161
SABEG Yazid, MÉHAIGNERIE Laurence, Les oubliés de l’égalité des chances. Participation, pluralité,
assimilation… ou repli ?, Institut Montaigne, janvier 2004. 164
STASI Bernard, Vers la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, rapport au
Premier ministre, février 2004. 168
AMADIEU, Jean-François, Discriminations à l’embauche. De l’envoi du CV à l’entretien, Observatoire des
Discriminations, Adia, avril 2005. 173
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, Rapport annuel 2005, avril 2006. 175
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 179
Rapports et travaux analysés dans le corpus 179
Autres références 180

________________________________________________
Ce texte de TERRA-Editions, Collection « Etudes » (http://terra.rezo.net/rubrique109.html) est sous copyright de son auteur et licence
"Creative Commons" ; pour le citer : A. Tandé, « La notion de discrimination dans les débats et l’action publics : lecture de quatorze années
de littérature grise française, (1992-2005) » Co-édition de l’IRIS, du Pgr FRONTIERES (ANR) et de TERRA-Editions., Coll. "Etudes"
(http://terra.rezo.net/article698.html), janvier 2008, 192 pages
5
Introduction
1
Que disent les discours publics qui portent sur la notion de discrimination ethnique et raciale,
et comment cette notion s’est-elle développée dans les débats publics et dans l’action publique en
France depuis le début des années 1990 ? Ce sont ces deux questions, formulées au début du
programme « Frontières », qui guident la présente recherche. Répondre à la première question, celle
du contenu, constitue en quelque sorte un préalable pour avancer sur la seconde, celle des conditions
d’émergence. Une première étape a consisté à recenser les travaux et les rapports jugés les plus
significatifs du point de vue de l’histoire récente de la notion, à la fois sur les plans scientifique et
administratif, en privilégiant ce qu’il est convenu d’appeler la « littérature grise ». Compte tenu du très
grand nombre de documents publics qui traitent des phénomènes discriminatoires, il n’était pas
question de viser l’exhaustivité. En revanche, la recherche porte sur un large éventail de discours.
Chacun des vingt-sept rapports a fait l’objet d’une fiche informative et critique, qui doit permettre au
lecteur de se faire une idée générale du texte, et d’envisager dans un second temps une analyse plus
précise de celui-ci. On trouvera ici la synthèse de l’ensemble de ces fiches, classée selon les
principaux éléments qui ont été recensés : les acteurs, les notions et les recommandations
opérationnelles.
Pour rendre compte du contenu et des évolutions récentes des discours publics sur la notion de
discrimination, on souhaite proposer une lecture critique de documents de « littérature grise » qui
évoquent la notion et les pratiques de discriminations ethniques et raciales en France entre 1992 et
2005. Il n’existe pas de définition canonique de ce que recouvrent les termes de « littérature grise ».
On peut toutefois distinguer celle-ci de la littérature proprement dite, et aussi des travaux de
philosophie, des essais ou des tribunes de presse. Cette expression renvoie à une relative
confidentialité, le statut des documents ainsi nommés évoluant entre le secret et le grand public. Il faut
aussi mentionner une relative technicité, et le fait que ces documents soient d’abord à usage
professionnel. Ils sont le plus souvent produits par et/ou pour des institutions, publiques ou privées, et
servent des finalités qui peuvent être scientifiques ou pleinement opérationnelles. Un exemple
caractéristique de cette « littérature » est ainsi le rapport d’expertise. En ce qui concerne cette
recherche, le corpus comprend des documents qui évoquent tous, d’une manière ou d’une autre,
l’existence de discriminations fondées sur des critères ethniques et/ou raciaux. Au total, vingt-sept
documents ont été réunis, dont on peut souligner la diversité des auteurs : il s’agit d’institutions
publiques (Haut Conseil à l’Intégration, Groupe d’Etude et de Lutte contre les Discriminations,
Inspection Générale des Affaires Sociales, Conseil d’État, Cour des Comptes, Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité) et de hauts responsables politico-administratifs (Jean-
Michel Belorgey, Bernard Stasi, Dominique Versini) ; de chercheurs et d’équipes de recherche
(Michèle Tribalat, Patrick Simon (INED), Maryse Tripier, François Vourc’h, Véronique De Rudder
(URMIS), Philippe Bataille (CADIS) ; d’acteurs privés à but lucratif ou non lucratif (Olivier Noël
(ISCRA), Fabrice Dhume (ORIV Alsace), Claude Bébéar, Laurent Blivet, Yazid Sabeg, Laurence
Méhaignerie (Institut Montaigne)). La cohérence de ce corpus réside dans la volonté d’étudier la
notion de discrimination ethnique et raciale dans le débat et l’action publics, en présentant un large
éventail des discours : il ne s’agit pas d’étudier les évolutions au sein d’un même institution ou pour
un même type d’acteurs, ce qui aurait conduit à rassembler de manière systématique certains travaux
1
Cette recherche s’inscrit dans l’axe « Espace public et politiques publiques » du programme de recherche
« Frontières », qui a bénéficié d’un financement de l’Agence Nationale de la Recherche. L’objectif de cet axe
est de comprendre comment se construisent les débats publics et les politiques publiques en France dans le
domaine de l’accueil et de l’intégration des populations étrangères. Il s’agit notamment d’analyser les notions et
les arguments produits, en prêtant une attention particulière aux évolutions des modes de problématisation. Un
groupe de travail consacré spécifiquement à la notion de discrimination dans les discours publics a assuré
l’encadrement de cette recherche. Il a réuni Didier Fassin (Professeur à l’Université Paris 13 et Directeur
d’études à l’EHESS, Directeur de l'Iris), Olivier Noël (Chercheur-coopérant à l'ISCRA et responsable du pôle
ISCRA-Méditerranée.), Sarah Mazouz (Doctorante à l’ENS) et Alexandre Tandé (Doctorant à l’Université Paris
1 et à l’Université Libre de Bruxelles, auteur de la recherche).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
1
/
181
100%