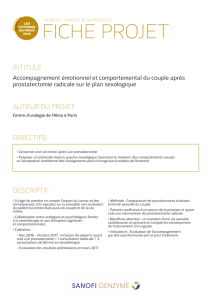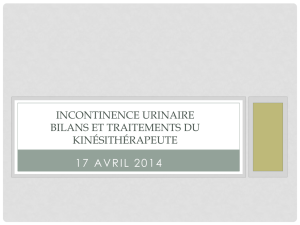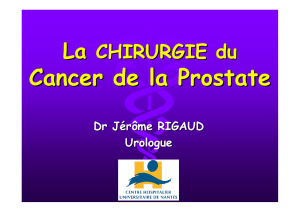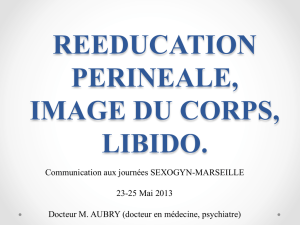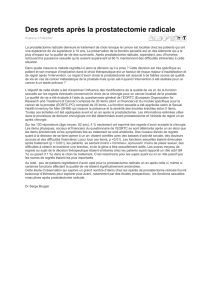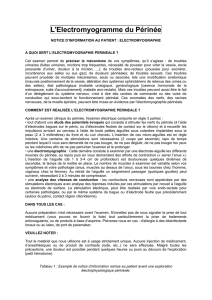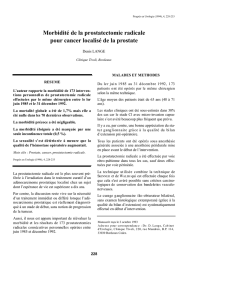Prostatectomie radicale : comparaison de la voie

RESUME
La prostatectomie radicale par voie périnéale,
décrite au début du siècle pour le traitement du
cancer prostatique est actuellement re c o n s i d é-
rée à la suite du développement de techniques
chirurgicales permettant la dissection des gan-
glions iliaques externes sous-veineux par une
voie d’abord réduite. Vi n g t - q u a t re patients
(groupe 1 ) ont subi une prostatectomie par voie
périnéale et 16 (groupe 2) par voie rétro -
pubienne. Le choix de la voie d’abord a été lais-
sé à l’opérateur. Nous avons comparé de maniè-
re rétrospective les deux groupes. Tous les
patients avaient un cancer prostatique histologi-
quement prouvé et cliniquement limité à la
p rostate. La durée de l’intervention, la surve-
nue de complications, la différence entre hémo-
globinémie pré et post-opératoire, le nombre de
patients transfusés et la quantité de culots san-
guins transfusés, la continence urinaire à tro i s
mois et les résultats de l’examen anatomo-
pathologique ont été étudiés. Trois patients opé-
rés par voie périnéale et un patient opéré par
voie rétro-pubienne ont eu une plaie rectale per-
o p é r a t o i re. Le nombre de patients transfusés
(12,5% dans le groupe 1 et 37,5% dans le grou-
pe 2) était significativement diff é rent de même
que la diff é rence entre hémoglobinémie pré et
post-opératoire pour les patients non transfusés
(2,9 g/100 ml en moyenne dans le groupe 1 et 4,6
g/100 ml dans le groupe 2). Il n’y avait pas de
d i ff é rence significative entre les deux gro u p e s
quant à l’envahissement capsulaire ou séminal.
Au total, seuls 16 patients sur 40 avaient une
tumeur réellement intra-prostatique, soit une
sous-estimation du stade du cancer dans 60%
des cas. Bien que le nombre de patients dont la
continence était imparfaite soit plus élevé dans
le groupe 1, la diff é r ence observée n’est pas
significative. La voie périnéale permet de réali-
ser la prostatectomie dans des conditions carci-
nologiques comparables à la voie rétropubienne
en réduisant la perte sanguine per- o p é r a t o i re .
La fréquence des complications per-opératoires
devrait décroître avec la pratique et l’habitude
de l’anatomie périnéale.
Mots clés : Prostatectomie radicale, cancer prostatique,
voie périnéale, coeliochirurgie.
Progrès en Urologie (1994), 4, 33-39.
INTRODUCTION
La prostatectomie radicale par voie périnéale a été
décrite au début du siècle pour le traitement du
cancer prostatique [9]. Cette voie, qui permet un
abord anatomique direct et donc moins traumati-
sant pour le patient a l’avantage de dispenser de la
ligature du plexus de Santorini et devrait théori-
quement permettre de réduire la perte sanguine. La
nécessité de connaître l’état anatomo-pathologique
des ganglions iliaques externes sous-veineux, afin
de préciser les indications de cette intervention à
visée curatrice, en a réduit la pratique au profit de
la voie rétro-pubienne. Le développement récent
de techniques chirurgicales permettant la dissec-
tion des ganglions iliaques externes sous-veineux
par une voie d’abord réduite a permis de reconsi-
dérer la voie périnéale pour le traitement du cancer
prostatique. Afin d’évaluer les avantages et les
Manuscrit reçu le 15 novembre 1993
Adresse pour correspondance : Dr. J . D . Doublet, Service
d'Urologie, Hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris.
Progrès en Urologie (1994), 4, 33-39
33
Prostatectomie radicale : comparaison de la voie périnéale et
de la voie rétropubienne (40 patients). Résultats préliminaires
Jean-Dominique DOUBLET, Louis LAGRANGE, Calin CIOFU,
Philippe THIBAULT, Bernard GATTEGNO
Service d'Urologie, Hôpital Tenon, Paris
ARTICLES ORIGINAUX

inconvénients de cette voie d’abord, nous avons
comparé de manière rétrospective deux groupes de
patients opérés par l’une ou l’autre voie, après
curage ganglionnaire par voie “minimale".
MATERIEL ET METHODES
Quarante patients ont subi une prostatectomie radi-
cale après curage lymphatique par cœliochirurg i e
(39 patients) ou par pelvioscopie simplifiée [3] (un
patient) pour un cancer prostatique entre novembre
1991 et juillet 1993. Vingt-quatre patients (groupe
1) ont subi une prostatectomie par voie périnéale et
16 (groupe 2) par voie rétro-pubienne. Le choix de
la voie d’abord n’a pas été randomisé. Tous les
patients avaient un cancer prostatique histologique-
ment prouvé par biopsie transrectale echo-guidée
ou par résection endoscopique préalable.
L’âge moyen des patients, leurs caractéristiques
morphologiques, le grade selon Gleason et le stade
clinique pré-opératoire du cancer prostatique, la
valeur moyenne du PSA sérique (n≤ 3 ng/ml) des
patients des deux groupes sont résumés sur le
Tableau 1. On a considéré que les patients étaient
obèses quand leur poids corporel excédait de plus
de 15% le poids idéal en kilos calculé d’après la
taille en centimètres selon la formule de Lorentz
(poids idéal = taille-100-0,25 x [taille-150]). Tous
les patients avaient subi un examen tomo-densito-
métrique abdomino-pelvien (TDM) et une scinti-
graphie osseuse. Toutes les scintigraphies osseuses
étaient considérées commes normales.
Antécédents prostatiques
Un patient avait été traité par radiothérapie externe
cinq ans auparavant pour adénocarcinome prostatique
et présentait une récidive. Treize patients avaient subi
une résection endoscopique de prostate et un patient
avait subi une adénomectomie chirurg i c a l e .
Les deux groupes étaient comparables pour les
paramètres étudiés.
La prostatectomie radicale a été pratiquée lors de
la même anesthésie que le curage ganglionnaire
pour quatre patients (après examen extemporané
des ganglions). Les 36 autres patients ont subi la
prostatectomie radicale lors d’une seconde anes-
thésie, après examen histologique complet de
l’ensemble des ganglions. Les patients n’ont pas
reçu de préparation intestinale .
Critères d’évaluation
La durée de l’intervention, la survenue de compli-
cations, la différence entre hémoglobinémie pré et
post-opératoire, le nombre de patients transfusés et
le nombre de culots sanguins transfusés, la conti-
nence urinaire à trois mois (évaluée par le chirur-
gien, par examen clinique et interrogatoire) et les
résultats de l’examen anatomo-pathologique ont
été étudiés dans les deux groupes.
RESULTATS
Les résultats dans les deux groupes de patients sont
résumés dans les Tableaux 2, 3 et 4.
Complications per et post-opératoires
Plaies rectales per-opératoires
Trois patients opérés par voie périnéale ont eu une
plaie rectale per-opératoire, qui a été suturée en
deux plans, sans colostomie et a guéri sans compli-
cation. Un patient opéré par voie rétro-pubienne a
eu une plaie rectale qui a nécessité une suture en
un plan et une colostomie de dérivation, la fistule
34
Tableau 1. Caractéristiques des patients.
Groupe 1 Groupe 2
24 patients 16 patients
Age moyen (extrêmes) 68 (63-75) 66 (59-72)
Patients obèses 13 (54%) 5 (31%)
Patients ayant des antécédents
d'adénomectomie (endo. ou chir.) 10 (42%) 3 (19%)
Stade clinique
A 12 6
B1 10 7
B2 1 3
C 1 0
PSA sérique moyen -ng/ml
(extrêmes) 22,5 (0,6-137) 26 (4-80)
Score de Gleason médian
(extrêmes) 6 (4-8) 6 (4-87)

uro-digestive diagnostiquée lors de la cystographie
au 12 ème jour a guéri après prolongation du son-
dage pendant 30 jours.
Complications urétérales
Un uretère a été sectionné lors d’une prostatecto-
mie par voie périnéale, et a été réimplanté par cette
voie, sans complication ultérieure. Un patient
opéré par voie périnéale a eu une obstruction uré-
térale bilatérale (compression par la suture uréthro-
vésicale), qui a nécessité une réintervention immé-
diate pour réfection de la suture uréthro-vésicale,
par voie périnéale, sans complication ultérieure. Il
n’y avait pas de lésion des uretères eux-mêmes.
Infections urinaires
Onze patients avaient un examen cyto-bactériolo-
gique des urines post-opératoire positif, sept dans
le groupe 1 et quatre dans le groupe 2, sans signes
cliniques.
Nous n’avons observé de complications au niveau
de l’incision dans aucun des deux groupes.
Les antécédents de curage cœlioscopique n’ont pas
entraîné de morbidité spécifique lors des prostatec-
tomie radicale par voie rétro-pubienne, et nous
n’avons pas constaté d’allongement du temps opé-
ratoire de la prostatectomie radicale.
Saignement per- o p é r a t o i re et transfusion san-
guine (Tableau 2)
Le nombre de patients transfusés (3 sur 24 dans le
groupe 1 et 6 sur 16 dans le groupe 2 était signifi-
cativement différent ( p=0,03 -Chi 2).
La différence entre hémoglobinémie pré et post-
opératoire pour les patients non transfusés (2,9
g/100 ml en moyenne dans le groupe 1 et 4,6
g/100 ml dans le groupe 2) était significativement
différente (p=0,0036 test t de Student).
Résultats anatomo-pathologiques (Tableau 3)
Il n’y avait pas de différence significative entre les
deux groupes quant à l’envahissement capsulaire
ou séminal. Au total, seuls 16 patients sur 40
avaient une tumeur réellement intra-capsulaire,
soit une sous-estimation du stade du cancer dans
60% des cas. La valeur de l’antigène spécifique de
prostate sérique (PSA) n’était pas liée à l’envahis-
sement capsulaire (p=0,16- test t de Student), mais
il existait une relation entre la valeur du PSA et
l’envahissement séminal (p=0,045- test t de
Student). Pour les patients dont la tumeur était
intra-capsulaire, la valeur moyenne du PSA était
de 15 ng/ml (intervalle 0,6 à 62 ng/ml), et pour les
patients dont la tumeur envahissait les vésicules
séminales, elle était de 33 ng/ml (intervalle 2 à 137
ng/ml). L’absence d’encrage systématique des
pièces opératoires n’a pas permis une analyse
exhaustive des marges chirurgicales.
Continence au troisième mois post-opératoire
(Tableau 4)
Bien que le nombre de patients dont la continence
était imparfaite était plus élevé dans le groupe 1, la
35
Tableau 2. Résultats post-opératoires.
Groupe 1 Groupe 2
Durée intervention moyenne ± d.s. 143 ± 41 154 ± 67 *
(extrêmes) mn. (90-212)
(90-360)
Plaies rectales 3 (12,5%) 1 (6,2%) *
Patients transfusés 3 (12,5%) 6 (37,5%) **
Nombre moyen d'unités
transfusées par patient transfusé 5,3 3,8 *
Différence hémoglobinémie pré et
post-opératoire
(patients non transfusés) 2,6 ± 1,4 4,5 ± 1,7 ***
* Différence non significative
** p=0,033
*** p=0,0036
Tableau 3. Résultats anatomo-pathologiques.
Groupe 1 Groupe 2
(n=24) (n=16)
n envahissement capsulaire 15 (63%) 7 (44%)
n envahissement séminal 9 (37%) 5 (31%)
Tableau 4. Résultats sur la continence à 3 mois.
Groupe 1 Groupe 2
(n=24) (n=16)
Continence parfaite 11 (52%) 10 (71%)
Incontinence d'effort 7 (33%) 4 (29%)
Fuites non permanentes 1 (5%) 0
Incontinence 2 (10%) 0

différence observée n’etait pas significative. Un des
patients opéré par voie périnéale, incontinent au
troisième mois, avait subi une prostatectomie de
sauvetage après échec de la radiothérapie; il était
encore atteint d’une incontinence d’effort sévère
après 6 mois.
L’autre patient incontinent à trois mois était conti-
nent à 6 mois.
DISCUSSION
Caractéristiques de la population des deux
groupes
La comparaison des caractéristiques des patients et
des tumeurs n’a pas permis de mettre en évidence
de différence statistiquement significative entre les
deux groupes pour les paramètres étudiés. Le choix
de la voie d’abord n’a pas été randomisé, et a repo-
sé sur les habitudes des opérateurs. Les patients du
groupe 2 ont été opérés par une technique que nous
employons depuis plusieurs années. En revanche,
nous avons commencé à utiliser la voie périnéale
pour les patients qui font l’objet de cet étude.
Complications
Les complications per et post-opératoires des deux
voies d’abord ont été comparées de manière rétros-
pective par FR A Z I E R et coll [4] dans une série de
173 patients porteurs de cancer prostatique stade A
ou B. Cent vingt deux patients ont été opérés par
voie périnéale et 51 par voie rétro-pubienne. L’inci-
dence des complications per et post-opératoires
était similaire dans les deux groupes. Parmi les
patients opérés par voie périnéale, une fistule uré-
thro-rectale est apparue trois semaines après l’inter-
vention, mais il n’y a eu aucune plaie rectale per-
opératoire dans la série. Dans notre série, la plus
grande fréquence des plaies rectales dans le groupe
1 reflète en partie l’existence d’une période
d’apprentissage de la chirurgie par voie périnéale.
L’incidence des complications chez les patients de
notre série ayant subi une adénomectomie préalable
n’était pas supérieure à celle constatée chez les
autres patients. Ceci avait déja été montré par
ELDER et coll. [2]. Dans une série de 692 patients
opérés par voie rétro-pubienne rapportée par IG E L
[5], il y a eu neuf plaies rectales (1,3%), six fois
traitées par suture simple et trois fois par suture et
colostomie. Cette complication n’est donc pas
exceptionnelle et ne semble pas dépendre de la voie
d’abord. En cas de plaie rectale, la voie périnéale
offre une excellente exposition pour la suture, et la
faible surface des espaces disséqués contribue à
limiter les phénomènes septiques.
Influence de la voie opératoire sur le saignement
per-opératoire
La différence observée quant à la perte sanguine et
à la nécessité d’une transfusion avait déjà été
constatée par FRAZIER et coll. [4]. Les patients opé-
rés par voie périnéale avaient en moyenne perdu
565 cc de sang (de 150 à 1850) et reçu 0 culot
(médiane) contre 2000 cc (de 600 à 10 000 cc) et 3
culots (médiane) pour les patients opérés par voie
rétropubienne.
RAINWATER et coll. [7] ont calculé la perte sanguine
moyenne chez 316 patients opérés par voie retro-
pubienne avec ligature du plexus de Santorini;
celle-ci était de 1020 cc (de 100 à 4320 cc). Dans la
série de 692 patients rapportée par IG E L [5], 50%
des patients ont reçu au moins deux culots et 26%
au moins trois culots, pour une perte sanguine
moyenne de 1018 cc (50 à 7000 cc). Ceci confirme
que le risque hémorragique et transfusionnel est
élevé lors de la prostatectomie radicale par voie
rétro-pubienne.
Valeur carcinologique de l’exérèse prostatique
selon la voie d'abord.
La comparaison des résultats anatomo-patholo-
giques obtenus par les deux voies d’abord dans la
série de FRAZIER et coll [4] a montré qu’il n’y avait
pas de différence significative concernant la fré-
quence de l’envahissement capsulaire, séminal,
vésical ou uréthral, ni la fréquence des marg e s
positives. Au total, 47% des patients opérés avaient
un envahissement capsulaire, ce qui est comparable
aux 60% observés dans notre série. CATA L O N A e t
coll. [1] ont rapporté une série de 250 patients por-
teurs de cancers prostatique de stade clinique infé-
rieur ou égal à T2b parmi lesquels 100 patients
(40%) avaient en fait un stade pathologique supé-
rieur avec envahissement séminal ou capsulaire. Il
ne semble donc pas y avoir de différence quant à la
qualité carcinologique de la prostatectomie en
fonction de la voie d’abord.
Influence de la voie d’abord sur la continence
Dans la série rapportée par FRAZIER [4], le taux de
36

patients souffrant d’incontinence urinaire d’eff o r t
est de 4% dans chaque groupe, mais le délai post-
opératoire n’est pas précisé. Plusieurs auteurs ont
analysé la continence urinaire après prostatectomie
radicale par voie rétropubienne.
Dans une série de 192 patients, 98% des patients
étaient continents à 6 mois [1]. Dans une série de
399 patients suivis à intervalles réguliers, 47% des
patients étaient continents à 3 mois, 75% à 6 mois,
82% à 9 mois, 89% à 1 an et 92% à 2 ans [8]. Les
antécédents d’adénomectomie n’influaient pas sur
ce résultat. Dans la série de 692 patients rapportée
par IGEL [5], 50% des patients étaient continents à
6 mois, 42% avaient une incontinence urinaire
d ’ e ffort et 8% étaient incontinents. Avec un recul
supérieur non précisé, 34 patients (5%) restaient
incontinents et 140 (21%) avaient une incontinence
d ’ e ffort. Dans une série de 60 patients rapportée
par KLEIN [6], 88% étaient continents, 10% avaient
une incontinence urinaire d’effort et 2% étaient
totalement incontinents à 4 mois. L’appréciation de
la continence définitive nécessite donc du recul,
mais le taux d’incontinence post-opératoire préco-
ce après prostatectomie radicale par voie rétro-
pubienne n’est pas négligeable. Les résultats obte-
nus dans notre série de patients devront donc être
précisés avec un recul supérieur, mais se compa-
rent avec ceux obtenus par d’autres équipes.
CONCLUSION
Le curage par cœliochirurgie préalable a permis de
réactualiser la voie périnéale. Celle-ci permet de
réaliser la prostatectomie dans des conditions car-
cinologiques comparables à la voie retropubienne
en réduisant la perte sanguine per-opératoire. La
fréquence des complications per- o p é r a t o i r e s
devrait décroitre avec la pratique et l’habitude de
l’anatomie périnéale. Notre prochain objectif est de
comparer ces deux voies d’abord de manière pros-
pective.
REFERENCES
1. CATALONA W.J., BIGG S.W. Nerve-sparing radical prosta-
tectomy: evaluation of results after 250 patients. J. U r o l . ,
1990,143, 538-544 .
2. ELDER J.S., GIBBONS R.P., CORREA R.J.,Jr, BRANNEN
G.E. Morbidity of radical perineal prostatectomy following
transurethral resection of the prostate. J. Urol., 1984, 132,
55-57.
3. FRANCANNET P., BOI TEUX J.P., BERETVAS M.,
GIRAUD B. Technique et résultats du curage ganglionnaire
par lymphadenoscopie pelvienne. Ann. Urol. (Paris) 1988,
22, 369-72 .
4. FRAZIER H.A., ROBERTSON J.E., PAULSON D.F.
Radical prostatectomy: pros and cons of perineal versus
retropubic approach. J. Urol., 1992, 147: 888-90.
5. IGEL T.D., BARRETT D.M., SEGURA J.W., BENSON
R.C.Jr, RIFE C.C. Perioperative and postoperative compli-
cations from bilateral pelvic lymphadenectomy and radical
retropubic prostatectomy. J. Urol., 1987, 137, 1189-1191.
6. KLEIN E.A. Early continence after radical prostatectomy. J.
Urol, 1992, 148,92-95.
7. RAINWATER L.M., SEGURA J.W. Technical considera-
tions in radical retopubic prostatectomy: blood loss after
ligation of dorsal venous complex. J. Urol., 1990, 143,
1163-1165.
8. STEINER M.S., MORTON R.A., WALSH P.C. Impact of
anatomical radical prostatectomy on urinary continence. J.
Urol., 1991, 145, 512-515.
9. YOUNG H.H. The early diagnosis and radical cure of carci-
noma of the prostate: being a study of 40 cases and presen-
tation of a radical operation which was carried out in four
cases. Bull. Johns Hopkins Hosp, 1905,16:315.
____________________
SUMMARY
Comparison of transperineal and re t ropubic radical
prostatectomy in a series of 40 patients. Preliminary
results.
Transperineal radical pro s t a t e c t o m y, described at the
beginning of the century for the treatment of pro s t a t i c
c a n c e r, is currently being reappraised following the
development of surgical techniques allowing the dissec -
tion of subvenous external iliac nodes via a limited inci -
sion. Twenty four patients (group 1) underwent transpe -
rineal prostatectomy and 16 (group 2) underwent retro -
pubic pro s t a t e c t o m y. The choice of surgical appro a c h
was left to the operator. We retrospectively compared the
two groups. All patients had histologically proven pros -
tatic cancer, clinically confined to the prostate. The ope -
rating time, the development of complications, the preo -
perative-postoperative haemoglobin difference, the num -
ber of patients transfused ant the number of units trans -
fused, urinary continence at three months and the histo -
logical results were studied. Three patients operated via
the perineal approach and one patient operated via the
retropubic approach suffered an operative rectal injury.
The number of transfused patients (12.5% in group 1
37
 6
6
 7
7
1
/
7
100%