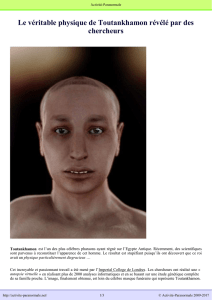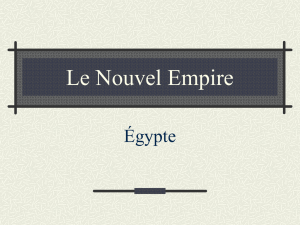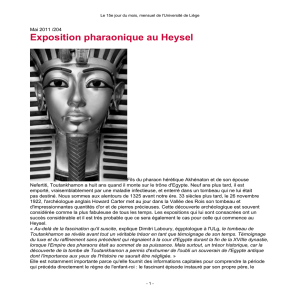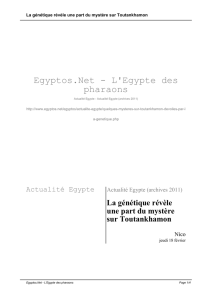Le problème amarnien

TOUTANKHAMON ET SA FAMILLE
Le problème amarnien
Ce que les spécialistes nomment “période amarnienne”, est la période allant du règne d’Akhenaton à
l’avènement d’Horemheb, soit une trentaine d’année et cinq souverains. Le terme amarnien vient de la ville
moderne d’el-Amarna, plus connu sous son nom ancien, Akhétaton, la capitale de l’Égypte durant une quinzaine
d’années. Depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 et la cachette amarnienne (KV55 dans la
Vallée des Rois), le problème amarnien ne cesse de nous interroger. Une question récurrente hante les
égyptologues : qui était Toutankhamon ? On ne connaît pas le nom de ses parents et de sérieux doutes planent
sur certains objets funéraires. L’énigme Toutankhamon n’est, finalement, qu’une interrogation parmi des
dizaines d’autres. Dans cette grande enquête, nous allons essayer de démêler la réalité historique et les
hypothèses. Notre connaissance de cette période, ou plus exactement, ce que nous croyons savoir, repose sur des
sources fragmentaires et des interprétations fragiles.
La fin du règne d'Amenhotep III : l’impossible compréhension
Amenhotep III représente l’apogée de la XVIIIe dynastie. Le pays est puissant, riche et en paix grâce à une
habile diplomatie où l’or égyptien est une arme terriblement efficace et recherchée par les États mésopotamiens.
Si on connaît ses nombreuses constructions, les dernières années du règne demeurent floues. On évoque souvent
l’existence d’un certain Thotmes, fils aîné du roi. Les preuves apportées pour prouver son existence sont peu
considérées. Claude Vandersleyen soutient la non existence de ceThotmes. Quoi qu’il en soit, Amenhotep III a
un fils de Tiyi, reine jouant un très grand politique, Amenhotep. Si on connaît avec certitude les parents du futur
Akhenaton, impossible de déterminer une date de naissance, peut-être entre l’an 10 et l’an 20. Il est possible que
le prince héritier ait passé une grande partie de son éducation et son enfance à Menphis et non à Thèbes. Son
nom a été retrouvé une seule fois dans le palais de Malqatta (voir Toutankhamon Magazine n°3). La première
grande énigme de la période amarnienne est l’existence, ou non, d’une co-régence entre Amenhotep III et
Amenhotep IV. Si tel est le cas, où la situer dans le règne ? On a pris l’habitude de fixer le début d’une possible
co-régence peu avant l’an 30, sans doute vers l’an 27 ou 28. Cela signifie qu’à la mort d’Amenhotep III (en l’an
38), Amenhotep IV était déjà dans la dixième ou onzième année de son règne, soit les deux tiers de son règne de
17 ans. Il change de nom vers l’an 6 et s’installe dans sa capitale, Akhetaton.
Un certain nombre d’égyptologues admet la co-régence en mettant en parallèle les fêtes sed (une sorte jubilé)
d’Amenhotep III (en l’an 30, 34 et 37) et les grands évènements d’Amenothep IV de l’an 1 à l’an 12. La
grandiose fête de l’an 12, apogée d’Akhenaton, serait alors la célébration de son règne personnel. Au-delà de
cette séduisante correspondance, à considérer avec prudence, il n’existe aucune preuve décisive confirmant ou
infirmant la co-régence. Quelle étrange situation. S’il existe des éléments prouvant la co-régence, rien qui soit
irréfutable. Les adversaires ne peuvent, eux non plus, apporter des preuves irréfutables. Personnellement, avec
certaines coïncidences et les éléments à charge, je penche pour une co-régence d’une dizaine d’années. Un des
enjeux de la co-régence est la détermination des parents de Toutankhamon. Car, avec la co-régence, on peut
admettre que Toutankhamon soit un fils d’Amenhotep III, né dans les toutes dernières années du règne, soit vers
l’an 37 ou 38. Par contre, si la corégence n’existe pas, Toutankhamon est sans aucun doute le fils d’Akhenaton,
né vers l’an 10 de ce souverain. Il existe plusieurs scènes montrant les couples Amenhotep III – Tiyi /
Akhenaton – Néfertiti ensemble. On a bien retrouvé un bloc gravé des cartouches des deux souverains à Athribis
mais, on ne situe pas son contexte historique. Les partisans de la co-régence tentent de s’appuyer sur des
exemples artistiques comme la tombe de Ramosé, présentant trois styles différents. Cette tombe contient
plusieurs exemples du style amarnien. Or, Ramosé meurt vers l’an 30 d’Amenhotep III. On ne voit pas comment,
le style amarnien aurait pu s’introduire dans la décoration, si la corégence n’avait pas eu lieu… La découverte de
la tombe d’Aper-el, vizir du Nord et successeur de Ramosé apporte de nouvelles sources, mais les fouilles n’en
sont qu’à leur début. Une autre source, très troublante, le papyrus P. Kahoun. Il raconte notamment le cas d’un
berger du nom de Nebméhy. L’affaire commence en l’an 27 d’Amenhotep III et se conclut par une nouvelle
visite en l’an 3 d’Akhenaton. Si on renie la co-régence, l’affaire s’étale sur environ treize ans. Seul problème, le
berger dit qu’il revient devant les mêmes personnes. Enfin, il semble que les archives d’Akhenaton fonctionnent
dans les dernières années d’Amenhotep III. Cette présentation du problème de la co-régence a été réduite à peu
de choses. On comprend mieux toute la complexité dans la transition entre les deux règnes.
Les débuts d’Amenhotep IV : le bouleversement artistique
Le règne atypique d’Akhenaton peut se diviser en plusieurs étapes :
- de l’an 1 à l’an 5 : les années thébaines,
- de l’an 6 à 12 : renforcement et apogée du règne à Amarna,
- de l’an 13 à 17 : crise et chute d’Akhenaton

Même si Amenhotep IV règne que cinq années à Thèbes (à Malqatta ?), il marque profondément le paysage et
les conceptions religieuses. Karnak fut un chantier très actif d’Amenhotep IV. Il y fit construire de grands
temples à l’architecture et à la décoration rompant avec les canons du Nouvel Empire. Ces temples étaient dédiés
à Aton. Ils s’élevaient à Karnak Est. Les monuments furent méthodiquement démontés et seuls quelques restes et
fondations sont encore sur place. Trois principaux temples sont plus ou moins connus pour leur emplacement et
leur fonction. Le premier, est le benben.Le benben est le symbole solaire par excellence, à la gloire du dieu Rê-
Harakhty. Le second temple est le Gempaaton, puis le Houtbenben. Deux autres temples ont été identifiés, le
Roudjmenou et le Ténimenou. D'autres édifices se sont révélés lors des fouilles. Mais la date de construction
reste incertaine. Certains spécialistes pensent que plusieurs temples auraient été fondés en l’an 2 d’Amenhotep
IV. Plusieurs révolutions artistiques secouent l’Égypte. Les temples ne sont pas construits avec de gros blocs
mais de petits blocs " standardisés " pesant une cinquantaine de kilos, les talatates. Ce sont eux que l’on
retrouvait par dizaine de milliers dans les pylônes de Karnak. Ce gigantesque puzzle est loin d’être reconstitué.
Or, la décoration et les textes peuvent nous aider à mieux comprendre Amenhotep IV. Pour réduire le temps de
construction, on adopte une nouvelle méthode pour graver la décoration, le relief en creux.
Quand et comment cet " art nouveau " a pu se développer ? Impossible d’y répondre. Il est vraisemblable que le
prince héritier avait déjà conçu l’idéologie amarnienne. Mais contrairement, à ce que l’on pense habituellement,
Amenhotep IV s’est fait représenter à plusieurs reprises en " graphie traditionnelle ". Dans d’autres vestiges, il
fait des offrandes à Amon. Il semble que le tout premier temple édifié par Amenhotep IV soit de conception
traditionnelle avec une décoration traditionnelle. La conception " amarnienne " apparaît rapidement dans le
règne. Le style amarnien apparaît rapidement. Il se caractérise avec le relief dans le creux. On creuse la pierre au
lieu de la détourer autour des reliefs. On abandonne la graphie d’Amenhotep III. On aboutit à des corps aux
aspects plus accentués avec des poses plus naturelles. La figuration masculine se féminise. On exagère certains
traits comme le ventre et les hanches. C’est des premières constructions que datent les étranges statues colossales
d’Amenhotep IV tellement caractéristiques. Les travaux de Redford, un des plus grands spécialistes des temples
de Karnak Est, ont pu découvrir des reliefs du couple royal mesurant plus de treize mètres de haut ! Certains
colosses sont asexués, difficile de savoir s’il s’agit d’Amenhotep ou de Néfertiti. Cette dernière est omniprésente
dans les temples de Karnak Est, elle l’est aussi par la suite à Amarna. L’autre caractéristique est le symbole du
soleil, le globe. Ce globe, dont les rayons se terminent par des mains, donne force et vie au roi et à la reine. La
révolution atonienne s’est forgée à Thèbes et n’est pas une idée surgit de nulle part. Si Amenhotep IV construit
la " philosophie amarnienne ", Bak transcrit dans la pierre la vision du souverain. Il est remarquable que se soit
le fils de Men qui réalise cette profonde mutation, Men étant l’apôtre du " classicisme " d’Amenhotep III. Preuve
que la société égyptienne de cette époque était capable de se muter et d’innover. À croire, que la transition entre
les deux rois s’est réalisé sans difficulté. Ne perdons pas de vu un élément essentiel. Depuis l’instauration de la
XVIIIe dynastie, deux siècles auparavant, Amon est le principal dieu du pays, le plus riche et le plus puissant.
Pour la grande fête de l’an 30, Amenhotep III emménagea dans l’immense palais de Malqatta en face de Thèbes,
loin d’Amon et de son clergé. Amenhotep III avait un penchant pour le dieu Aton. Il peut s’agir d’un acte
religieux fort mais aussi (et surtout ?) d’un acte politique. Pharaon signifie qu’Amon n’est pas le seul dieu et
qu’il possède le pouvoir.
Vers l’apogée de l’an 12
La rupture se réalise à partir de l’an 5. Amenhotep IV décide de construire une nouvelle capitale dans un lieu
vierge (de tout dieu). Il choisit la localité d’el-Amarna. Le roi y recréa les temples de Karnak Est et édifia une
ville aussi importante que Thèbes. On ne sait pourquoi Amarna fut choisie. Il semble que la reine-mère Tiyi soit
toujours en vie et ce au moins jusqu’en l’an 12. Elle est représentée à plusieurs reprises dans diverses tombes
d’Akhétaton. Le couple Amenhotep III – Tiyi est même représenté. La représentation existant dans la tombe de
Huya est-elle symbolique ? Il était rattaché au service de la grande reine. Une des plus fameuses scènes de cette
tombe est le représentation du couple royal Amenhotep III – Tiyi. La scène est datée de l’an 9 d’Akhenaton, soit
un peu avant la fin d’une co-règence supposée. Tout cela pour dire que les événements précisément datés du
règne d’Akhenaton sont rares. Le principal événement du règne que l’on connaît avec précision est la grande
cérémonie de l’an 12. On sait aussi qu’entre l’an 8 et 12, Akhenaton change sa titulature. C’est grâce à celle-ci,
que l’on peut tenter de dater les événements. La cérémonie de l’an 12 est omniprésence à Akhetaton et dans la
chronologie du règne.
Entre l'an 8 et 12, va se dérouler toute une série d'événements, en tout cas, que l'on présume. Cette partie de la
présentation repose une fois encore sur la co-régence entre Amenothep III et IV. Cela va permettre de consolider
les preuves de la co-régence (sans la confirmer). Cette immense cérémonie est relatée par deux tombes, celle de
Méryré II et celle d'Houya. Des quatre coins du monde, par monde ici vous comprendrez le monde connu des
Egyptiens, on apporte à pharaon de l’or et des cadeaux. L'or et les tributs sont fournis par la Nubie, le pays de
Koush, et les royautés ou principautés sous influence. Les cadeaux sont symboles de paix et de reconnaissance

de la puissance de pharaon. On y côtoie des représentants des Hittites, de l'Assyrie, peut-être, de la Babylonie, de
la mer Egée, de la Libye, de Syrie, de Palestine... Scène sans conteste incroyable et extraordinaire à voir... On
mesure mal son importance et si c’était un événement exceptionnel ou périodique.
Néfertiti et les autres épouses
Néfertiti est, après Amenhotep IV, le personnage le plus important de la période amarnienne. La grande épouse
royale est représentée dès les premiers monuments d’Amhenotep IV à Karnak. On pense que Néfertiti épousa le
prince Amenhotep avant son intronisation. Son origine reste incertaine. Elle a une soeur, Moutnédjémet, future
épouse d’Horemheb. Elle fut élevée par la nourrice Tiy, femme du divin père Aÿ, dignitaire important. Certains
voient en Aÿ et Tiy les parents de Néfertiti sans aucune preuve. On ne connaît pas son véritable nom, Néfertiti
étant le nom officiel après l’avènement d’Amenhotep. Elle fut la seule grande épouse d’Akhenaton et a acquis un
rôle et une importance exceptionnelle, quasiment l’égale du roi. Néfertiti est omniprésente jusqu’à l’an 12, après,
elle disparaît progressivement. On comprend encore mal la raison de ce retrait surtout après l’an 14-15. Il est
possible qu’elle soit le successeur immédiat d’Akhenaton. Quelques indices pourraient le faire penser, comme
l’unique oushebti de la reine avec sans doute la représentation des emblèmes royaux et une bague. Elle donna au
roi six filles. On ne lui connaît aucun fils. Outre Néfertiti, Kiya est une épouse de grande importance. Pour
certains égyptologues, elle ne ferait qu’une avec Tadoukhépa. Cette hypothèse est recevable si on peut prouver
que Kiya fut présente à Amarna dès l’an 6. De plus, il semblerait qu’elle soit mitanienne comme Tadoukhépa.
Là, une fois de plus, les sources restent lacunaires. Kiya est très présente après l’an 12, au moment où Néfertiti
disparaît des textes et des images. Elle reçut à Akhétaton son propre domaine et des monuments dans le grand
temple d’Aton. Dans la cité du Nord d’Amarna, Kiya possède sa propre maison. Elle a été suffisamment
importante pour recevoir un très riche mobilier funéraire comme le prouve les objets usurpées de la tombe 55 de
la Vallée des Rois. L’usurpation de ces objets est la conséquence d’un grave événement. Kiya perdit toute
importance avant la mort d’Akhénaton. Cette déchéance totale provient sans doute de sa disgrâce. Tout objet et
monument au nom de Kiya fut usurpé (ou son nom effacé). Meritaton profita de cette situation pour en
récupérer. Il est possible que cette disgrâce soit une des réponses d’Akhenaton à la conquête du Mitanni par le
roi hittite, Souppilouliouma. Akhenaton aurait pu faire un geste diplomatique envers le Hittite.
Un entourage disparate
La période amarnienne laissait peu de place aux dignitaires. Et il est parfois difficile de connaître tel ou tel
individu. Les textes royaux ne mentionnent pas les noms des dignitaires mais uniquement les titres et charges.
On sait que plusieurs membres de l’entourage de la reine-mère Tiyi sont présents sous Akhenaton. Les tombes
sont nos seuls sources. Parmi les plus grands dignitaires, on peut citer : Parennefer, échanson du roi, Méryré I,
grand prêtre d’Aton, l’intendant des appartements de Néfertiti, Méryré II, Toutou, le chargé de mission en Asie,
le divin père Aÿ. On connaît depuis peu de temps, le successeur de Ramosè au poste de vizir du Nord, Aper-El.
Il était totalement inconnu avant la découverte de sa tombe à Saqqarah. Pour le moment, on ne connaît rien de sa
vie et de sa carrière. Il faudra attendre la fouille complète de son tombeau. On sait tout de même qu’il n’était pas
égyptien. Sa famille joua un grand rôle dans l’entourage de pharaon. Il reçut aussi le titre de Divin Père. Son fils
(?), Houy fut le général en chef d’Akhenaton jusqu’en l’an 10 (et peutêtre au-delà). Horemheb joue un rôle
encore très marginal alors qu’Aÿ continue une très brillante carrière.
Akhetaton : la capitale du disque soleil
Les premières années d’Aménophis IV sont marquées par une profusion architecturale et artistique. Le nouveau
roi bâtit plusieurs grands ensembles religieux à Karnak et entame très rapidement les travaux gigantesques pour
construire une nouvelle capitale en quelques années. Amenhotep IV marque très tôt son attachement au dieu
Aton. Aton n’était pas une nouveauté dans la famille royale. Son père, Amenothep III, avait “adopté” Aton pour
compenser le pouvoir d’Amon.
Un nom mystérieux
C’est durant la 5e année de son règne qu’Akhenaton part de Thèbes, où il ne reviendra plus, pour sa nouvelle
capitale, Akhetaton, ce qui signifie (même si la traduction reste polémique) : “l’horizon du disque solaire”. Cette
ville nouvelle se situe en Moyenne Égypte. Il est possible que le souverain ait voulu y déménager dès l’an 4,
mais y renonça. Il semble que les travaux dans la nouvelle capitale n’étaient pas terminés. Le changement de
nom d’Amenhotep IV se réalise avant ou peu après ce voyage. Il semble également que pharaon ait ordonné
d’arrêter les travaux dans les temples de Karnak Est pour se concentrer uniquement sur Akhetaton. La famille
royale ne peut encore habiter dans les palais d’Akhetaton. Elle passe la fin de l’an 5 et une partie de l’an 6, dans
des habitats provisoires.

Akhetaton est une vraie “ville nouvelle”.
Aucune ville n’avait été construite en ces lieux. Le roi pouvait libérer son imagination. La ville est nettement
coupée en deux parties : la ville Nord et la ville Sud. Les deux ensembles sont reliées par une “voie royale”. Elle
s’étend au Sud au-delà de la ville. Au total, cette route est longue de huit kilomètres. L’architecture urbaine de la
ville est intéressante. Il existe peu d’exemples de ce type en Égypte. On peut citer Tanis et Deir el Medineh. Une
des originalités de la ville est la présence de stèles-frontières, au nombre de 14. Cette frontière délimite l’étendue
et le territoire de la ville. Elle joue peut-être un rôle de frontière religieuse pour empêcher la venue de dieux en
dehors d’Aton. On sait que le culte des autres dieux a toujours existé à Akhetaton. Une des stèles datée de l’an 6
(du mois de pharmuthi, le 13e jour) pourrait montrer l’arrivée du couple royal dans la nouvelle capitale. A en
juger par les dispositions des principaux édifices et des stèles, certains pensent que le plan de la ville fut établi
par rapport à l’emplacement de la tombe du pharaon, symbolisant en quelque sorte, le Globe (le soleil).
La composition de la ville
La ville s’étale le long de la rive Est du Nil. Le cirque rocheux représente la frontière Est de la ville avec les
différentes nécropoles. L’emplacement des tombes (à l’est) n’est pas habituel, traditionnellement, les nécropoles
se situent à l’Ouest (comme à Saqqarah ou Thèbes Ouest). Akhetaton se divise en trois grands ensembles : le
palais du Nord, la cité en elle-même et les différentes nécropoles. Le cité est constituée de différents “quartiers”.
Aton y possède deux temples (le Grand et le Petit temple). L’architecture du grand temple est surprenante.
L’immense enceinte entoura une vaste terrain vide (730m * 229m), le temple n’occupant qu’une petite partie de
l’espace enclos. Le Grand Temple se caractérise par des centaines de tables d’offrandes à Aton. Non loin de
l’entrée du Grand Temple, on peut contempler le Grand Palais relié à la maison du roi. C’est entre les deux
bâtiments qui se situait la fenêtre des apparitions. Lieu hautement symbolique de la ville, où pharaon couvrait
d’or et de bijoux les serviteurs les plus méritants. Dans les tombes d’Akhetaton, Akhenaton est représenté à
plusieurs reprises à cette fenêtre. Les deux bâtiments sont reliés par une sorte de pont, en son centre, la fenêtre
des apparitions. Elle surplombe la grande route royale. C’est dans le palais que fut découvert une grande salle
couverte au nom de Smenkhkaré. Dans ce quartier “royal” on y trouve aussi le bâtiment des archives, le petit
palais, les résidences des prêtres ainsi que les casernes militaires. La maison du roi était le coeur de
l’administration. La ville comprend des quartiers résidentiels pour les dignitaires et les habitants et des lieux
marchands. Dans le Sud de la cité, se trouve un palais isolé, le Maru-Aton. Ce lieu fut la résidence officielle de la
reine Kiya, une des épouses d’Akhénaton. Mais à sa mort ou à sa disgrâce, le palais fut attribué à Meritaton, fille
de pharaon. Ce changement de prioritaire est visible sur les reliefs retouchés. Le citée nord marque le début de la
route royal et contient le palais nord où séjournaient, peut-être, Néfertiti et éventuellement le jeune
Toutankhaton. Une des caractéristiques d’Amarna est sa frontière virtuelle. Akhenaton a consacré une frontière
divine, délimitant la domaine d’Aton dans lequel les autres dieux ne pouvaient pénétrer. Pharaon resta à
l’intérieur de ses limites. Cette limite est marqué par des stèle-frontières. Si l’architecture des palais et des
temples diffère radicalement avec le modèle classique, les maisons des dignitaires, des ouvriers et des habitants
ne différent en rien du reste de l’Égypte et notamment de Thèbes. Le plan du village des ouvriers ressemble à
celui de Deir el-Médineh (proche de la Vallée des Rois).
Les trouvailles
Bien que la ville fut abandonnée 3 ou 4 ans après la mort d’Akhénaton, elle a livré, finalement, un nombre
d’objets et de ruines, très restreint. Les destructions systématiques à partir d’Horemheb, le remploi des blocs
dans d’autres monuments et le transfert des tombes, ont laissé peu de traces. Heureusement, tout ne fut pas
déménagé. C’est ainsi que l’on a pu découvrir un des plus précieux trésor de toute l’Égypte, les tablettes
d’Amarna. Il s’agit de la correspondance diplomatique avec les pays du Proche-Orient. Cette découverte est
exceptionnelle, car peu d’archives royales ont été découvertes. Cette trouvaille a permis de mieux comprendre
les démêlés politique-militaires du Proche-Orient à cette époque. Outre ces tablettes, les chercheurs ont pu
découvrir les plus beaux exemples de la sculpteur amarnienne. Dans la maison du sculpteur Thotmes, toute une
série de bustes et d’ébauche de Néfertiti y fut découverte, dont le fameux buste, aujourd’hui à Berlin. Les
découvertes sont essentiellement des objets “royaux” ou officiels. La statuaire privée est quasi inexistante. Les
scènes de vie sont à découvrir dans les différentes tombes. De nombreux fragments de décorations furent
découverts.
Les nécropoles
Les tombes des dignitaires ont apporté d’importantes informations sur le règne d’Akhénaton. La plupart des
tombes ne furent jamais terminées et il semble que les dignitaires inhumés ont été transférés à Thèbes (ou à
Saqqarah) lors du retour dans les premiers mois du règne de Toutankhaton. Les tombes non royales gardent une
architecture classique que l’on peut observer dans la Vallée des Nobles à Gournah. Ils existent trois
emplacements de tombes : les tombes du Nord, les tombes du Sud et la tombe royale d’Akhénaton. Les tombes
des principaux dignitaires ne furent commencées soit avant, soit peu après l’an 12. Aucune, sauf une, fut

terminée. On ne s’explique pas cette situation. Au Nord, on trouve les tombes de Huya, Méryré I et II, Ahmose,
Pentu, Pinhasy. Au Sud, le nombre des tombes est plus important : Parennefer, Toutou, Mahou, Ipy, Ramosé (à
ne pas confondre avec le vizir), Nakht, Neferkheperuhersekheper, May, Suti, Suta, Iny, Paatenemheb et Aÿ.
Plusieurs tombes sont vierges de décorations, donc impossible d’en déterminer les propriétaires. Les tombes de
plusieurs autres dignitaires et personnages importants restent indéterminées : Bek, Anen, Huy, Thotmes (le
fameux sculpteur), etc. Certains dignitaires furent enterrés non pas à Akhentaton mais à Saqqarah ou à Thèbes.
Présence étonnante quand on sait qu’Akhenaton ne sortit jamais de sa ville. On a ainsi en 2001 découvert la
tombe d’un haut dignitaire amarnien à Saqqarah ! La tombe royale d’Akhenaton est, elle aussi, restée inachevée.
Son plan rompt avec le modèle traditionnel. Akhenaton introduit le concept de la tombe rectiligne,caractéristique
des tombes royales à partir d’Horemheb. La seconde particularité est l’existence d’un second axe. C’est là que
fut découvert une très mystérieuse scène où on voit le couple royal pleurant la mort d’un de leurs enfants. Dans
le registre du haut, derrière Akhentaton – Néfertiti, se tient debout une femme portant un enfant !
Malheureusement, les textes pouvant l’identifier ont été détruit dès l’Antiquité. L’identité de la femme est elle
aussi inconnue. Lors des différentes fouilles, quelques éléments du mobilier funéraire furent retrouvés. Les corps
reposant dans les tombes furent transférés à Thèbes. Cela inclut Akhenaton qui fut sans aucun doute déplacé à
Thèbes.
La fin de la capitale
Akhénaton mort, Amarna reste la capitale l’Égypte durant trois ou quatre ans. Thèbes retrouve son statut durant
les premiers mois de règne de Toutankhaton. On ne sait pas si le jeune roi-enfant a vécu à Amarna. La ville
restera déserte durant une quinzaine d’années. Sous Toutankhamon et Aÿ, Amarna n’a pas dû connaître de
grandes dégradations et destructions. Horemheb, le véritable restaurateur de l’ancienne tradition, a sans aucun
doute voué une haine à la période amarnienne. Amarna fut alors réduite à de simples ruines. Seuls quelques
vestiges restent debout et les fondations.
Que reste-t-il aujourd’hui ?
Ce site méconnu et hautement historique, mérite un détour. Sa valeur archéologique est incalculable. Les tombes,
malgré les dégradations volontaires, ont fourni des informations importantes. S’il est encore difficile de
connaître l’architecture des bâtiments, Akhetaton fut une ville aussi grande, voir plus grande, que Thèbes.
Amarna est un des très rares sites urbains où on a pu identifier et définir les plans des palais. Comme se fut le cas
dans plusieurs palais assyriens, Amarna a livré d’importantes archives de la correspondance diplomatique. D’un
point de vue touristique, le visiteur sera déçu. Mis à part quelques colonnes ici ou là, il ne reste que les
fondations. Amarna ressemble plus à un terrain vague qu’à une antique capitale. Pour apprécier la beauté des
lieux, les musées de Berlin, du Caire ou du Louvre possèdent de très beaux exemples d’objets et de reliefs
d’Amarna. Le véritable intérêt d’Amarna se situe dans les différentes tombes des lieux.
De l’an 12 à Horemheb
Si l’an 12 est incontestablement l’apogée du règne d’Akhenaton et l’éclat de sa capitale, ce qui se passe ensuite
est frustrant. Frustrant car les informations manquent ou ne permettent pas une reconstitution certaine des
événements. On apprécie bien mal la situation de l’Égypte sous Akhenaton. La légende qui veut que le “roi
hérétique” se soit enfermé dans sa nouvelle capitale n’est peut-être pas aussi réelle que cela. Il aurait effectué au
moins un déplacement en dehors d’Armana. Même si le roi a gardé un certain nombre de dignitaires de son père,
la grande majorité des responsables sont des hommes nouveaux, manquant d’expérience. Les successeurs
d’Akhénaton dont Toutankhamon et Horemheb, ont dénoncé la situation de l’Égypte et la nécessité de la
restaurer. Malgré tout, il ne faut pas faire dans l’excès. Amenhotep III avait lui aussi pris à son service des
hommes nouveaux (ex. : Amenhotep fils de Hapou et Men). Il est certain que seul le culte d’Aton comptait
(officiellement tout du moins). Les autres temples furent fermés ou laissés à l’abandon. La situation de l’armée
ne semble pas être bien meilleure. Mais nous n’en sommes pas encore à la restauration du pays par
Toutankhamon.
Un roi pacifique ou guerrier ?
On a longtemps présenté Akhénaton comme un roi pacifique. La réalité est une nouvelle fois plus complexe. En
Nubie, des répressions furent exercées contre des populations d’Akaÿta. Le pharaon intervient cependant peu. La
ville de Sésebi fut fortifiée et un temple d’Aton y fut construit. Certains pensent que la ville de Kaoua fut fondée
par Amenhotep IV mais aucune preuve tangible ne confirme cela. Une grande partie de l’activité diplomatique se
concentre sur le Proche-Orient. Si les informations sont nombreuses, difficile d’y établir une chronologie. On
sait que l’influence de Pharaon ne dépassait pas le Nahr el-Kébir, au Nord de Byblos. Cette région était disputée
avec l’Amourrou, un important état. Son roi Azirou semble avoir joué un double jeu. S’il apparaissait fidèle de
Pharaon, il n’hésitait pas à s’allier secrètement avec le roi Hittite. L’Égypte possédait plusieurs centres
administratifs en Palestine et des itinérants circulaient constamment dans la zone d’influence égyptienne afin
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%