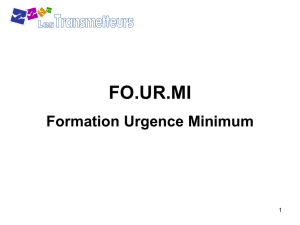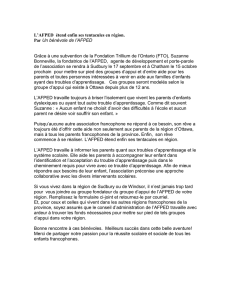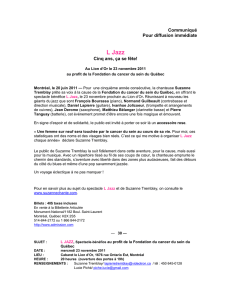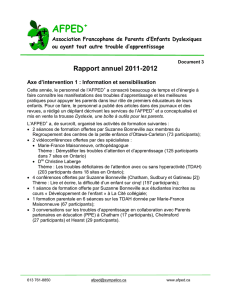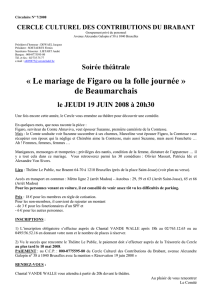Suzanne Flamme libérée

Suzanne Flamme libérée
La jeune réalisatrice Katell Quillévéré signe un superbe portrait de femme
citant abondamment Pialat, avec dans le rôle-titre une incandescente Sara
Forestier.
Elle s’appelle Suzanne. Elle est le personnage majeur du deuxième film de Katell Quillévéré
après Un poison violent. Mais elle pourrait s’appeler Sandrine et être la Suzanne du A nos
amours de Pialat, qui révéla Bonnaire. C’est assez culotté et casse-cou de pratiquer à ce point
la citation. D’autant que, stupeur de l’osmose, l’actrice Sara Forestier, qui incarne Suzanne, est,
trente ans après, plus Bonnaire que Bonnaire. Au physique, surtout quand elle sourit, comme
au moral, lorsque cette fille peu commode se claquemure dans des décisions aussi radicales
qu’irréfléchies. Cet hommage explicite est peut-être la meilleure façon de se dépoisser du
maître. Tandis qu’une forte majorité de jeunes cinéastes français rament dans le «à la manière
de…» tout en poussant des cris outragés si on suggère qu’on préfère le Pialat brut à ses
pastiches sous vide, Katell Quillévéré (née en 1980) fonce dans la transparence de son
admiration. Une sorte de slogan «A nos amours !» planté comme un poteau indicateur à
l’entrée du film. Une manière de toast aussi, comme lorsque l’on trinque à la santé d’un cher
disparu.
Ellipse. Ceci étant dit, le film peut commencer. Et tout de suite s’évader dans des régions de
cinéma qui n’appartiennent qu’à lui. Voilà une volière de gamines qui s’affairent aux costumes
pailletés et surtout aux tables de maquillage dans les coulisses d’une matinée enfantine. Dans
la salle du spectacle, les familles vont s’émouvoir aux trémoussements chorégraphiques de leur
progéniture. Et, comme dans l’Ecole des fans, un papa brandit vers sa fille un caméscope de
type soviétique qui suffit à évoquer l’époque : les années 80. Qui vont durer vingt-cinq ans au fil
des 94 minutes du film. Suzanne enfant délurée, Suzanne ado foutraque, Suzanne adulte
prématurée. Suzanne et Maria, sa sœur aînée (Adèle Haenel). Suzanne et son père, Nicolas
(François Damiens), chauffeur routier taciturne. Suzanne et sa maman qui repose au cimetière.
Tout ceci campé vite fait dans le sud-est de la France, avec un certain sens de l’ellipse
évocatrice.
Cette façon de ne jamais s’attarder est une vraie politesse pour le spectateur, qu’on suppose
aussi curieux et rêveur que le film. C’est aussi le tact d’une cinéaste qui touche où ça fait mal,
sans jamais en faire la publicité. Violentes ou tendres, les meilleures scènes s’arrêtent au
moment où elles deviendraient gênantes. Pour l’exemple, lorsque le père de Suzanne apprend

que sa fille de 17 ans est enceinte, la question n’est pas «de qui ?» mais «pourquoi ?» «Parce
que j’en avais envie»,répond Suzanne avant de se prendre une beigne à décorner un troupeau
de bœufs. Sans transition, Suzanne, par ailleurs boniche de son papa, dresse le couvert sur la
table de la cuisine.
Obsession.Suzanne est le portrait d’une fille folle. Folle de vie et bientôt dingue d’amour pour
Julien, un beau gosse de hasard (le prégnant Paul Hamy), qui va l’entraîner sur les chemins
embourbés du banditisme (cambriolage, trafic de drogue). Parce qu’il vaut mieux vivre en
quatrième vitesse qu’au point mort dans la peau flapie d’une secrétaire, qui plus est dans
l’entreprise de transport qui emploie son père. Mais surtout, comme pour son gamin, parce que
Suzanne en a envie.
Suzanne est une amoureuse sans raison, comme il y a des crimes sans motif. Et l’on
chercherait en vain dans ce film des explications apaisantes à son «inqualifiable» conduite.
Mauvaise fille, vilaine mère, putain de sœur. A tous ces titres, désirable. L’obsession du
personnage primordial n’empêche pas que les seconds rôles deviennent premiers à tout bout
de plan : la frangine flouée, le père vieux garçon, l’amant terrible, le fiston distant. Ils sont tous
comme les anticorps d’un virus incendiaire. Que nous dit Suzanne ? Qu’il vaut mieux brûler que
s’éteindre. Gérard Lefort
© Libération
17 décembre 2013
1
/
2
100%