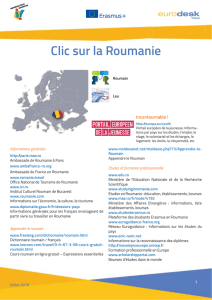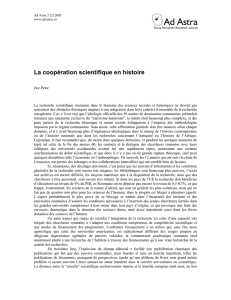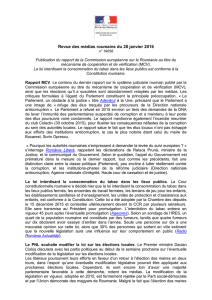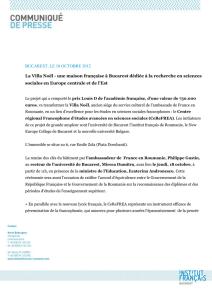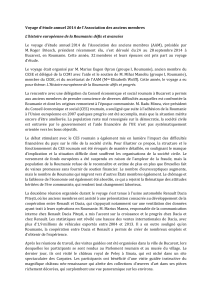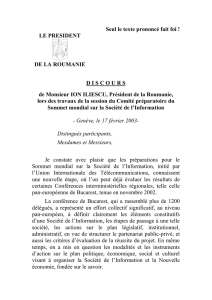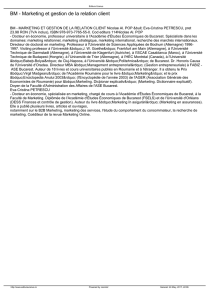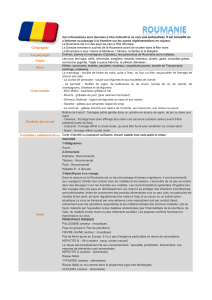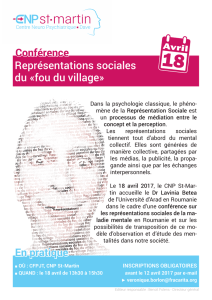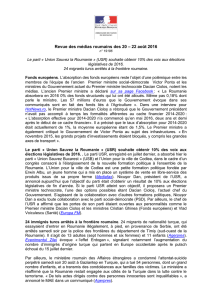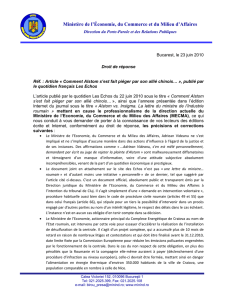Les treize ans de transition du commerce roumain

1
Les treize ans de transition du commerce roumain.
Quelques considérations sur la grande distribution;
étude de cas: implantation étrangère
Lucian BELAŞCU
Maître-assistant
Faculté des Sciences Economiques,
Université «Lucian Blaga» de Sibiu (Roumanie)
lucian_b[email protected]
Résumé: Dans le contexte du processus de transition à l’économie de marché, que la société
roumaine parcourt depuis quatorze ans (dès 1989), l’article aborde la problématique de la trajectoire
du commerce intérieur au fil de cette période. Sur le fonds d’une évolution lente, à cause de divers
facteurs, jusqu’en 1996, dans le paysage commercial roumain on ne pouvait pas parler d’une vraie
grande distribution. La situation a positivement changé à partir de 2000-2001, dans les conditions de
la stabilisation macro-économique qui a déterminé une transformation importante pour la grande
distribution. Ainsi, cette communication met en évidence les mutations profondes réalisées dans le
commerce de détail de Roumanie, suite à l’ampleur prise par la grande distribution.
Mots-clés: commerce, transition, supermarché, hypermarché, Roumanie
Abstract: Taking in consideration the process of transition towards a market economy, process that
started 14 years ago, in 1989, the article presents the domestic commerce and the problems with
which we confronted during this period of time. Until 1996, the evolution was extremely slow,
caused by several factors, at that moment within the framework of the Romanian commerce being
impossible to speak about retail. A positive change was noticed starting with the period 2000-2001,
when was sensed a macroeconomic stability. In this context, the article presents the changes made
in the retail sector from Romania, as a result of the development and the extension of the major
retailers.
Keywords: commerce, transition, supermarket, hypermarket, Romania.
1 Pourquoi l’économie de marché n’est-elle pas encore fonctionnelle en
Roumanie?
Cela fait quelque temps depuis que l’Union Européenne signale à la Roumanie que,
malgré les croissances obtenues en 2000 et 2001, son économie de marché n’est toujours
pas fonctionnelle! Maintenant, quand on a remporté une petite victoire sur la voie de
l’intégration européenne et qu’on est finalement décidé sur le futur européen de la
Roumanie, on devrait se rappeler quelques réalités qu’on n’aime pas ou qui nous dérangent
; celles-ci devraient être prises en considération dans tout programme de réhabilitation et de
développement de l’économie nationale pour pouvoir mieux agir dans l’avenir. En
conséquence, on considère aussi important de savoir pourquoi on n’a pas une économie de
marché fonctionnelle que de connaître ce qu’on doit faire dorénavant.
“La principale erreur de tous les programmes d’inspiration F.M.I. a comme croyance naïve
que l’économie de marché capitaliste surgit spontanément, dès qu’on introduit la propriété
privée, la libéralisation des prix, la stabilité monétaire et la déclaration des marchés libres -
compétitifs”, a affirmé le groupe de spécialistes occidentaux en économie, qui a élaboré
entre 1991-1993 “L’agenda de la reconstruction économique et sociale des pays de
l’Europe Centrale et de l’Est” (selon Le journal du commerce roumain, 1996, [5]).

2
Au fil des treize ans de réforme par “thérapie de choc”, l’économie de la Roumanie a
alterné récession et stagnation; les gouvernements d’après 1989 (au moins jusqu’en 2000)
n’ont réussi qu’à faire descendre le standard des réalisations vers les niveaux réalisés dans
les années 70, quand le PNB/habitant a effectivement augmenté de 1.098 dollars en 1974 à
1750 dollars/an en 1978 (il faut quand même préciser que les principaux désavantages de
l’économie roumaine proviennent des erreurs stratégiques commises avant 1989, par le
régime communiste). Notre économie de marché actuelle, dont certains hommes politiques
ont prétendu que sa transition avait presque atteint son but, ne fonctionne pas parce que
par thérapies de choc inadaptées à des situations particulières et des réformes d’un jour à
l’autre, on n’avait pas restructuré ce qu’il fallait et quand il le fallait; on n’a pas non plus créé
toutes les institutions dont l’industrie et l’agriculture avaient besoin pour qu’elles
fonctionnent comme sur tout marché capitaliste. Par contre, il est vrai aussi que les
difficultés actuelles, avec lesquelles l’économie roumaine est toujours confrontée, ne
dérivent pas de la transition, mais seulement la transition - avec tous les mécanismes
structurels que celle-ci implique - peut mener à leur solution.
Le dernier rapport de la Commission Européenne du novembre 2003 n’a toujours pas
confirmé le statut d’économie fonctionnelle pour la Roumanie mais, indiscutablement, il en a
été le plus favorable depuis toujours. Par rapport aux recommandations actuelles du F.M.I.
et de l’O.C.D.E., on précisait que “la reconstruction de l’Europe occidentale d’après la
deuxième guerre mondiale a toujours été basée sur les forces du marché, mais les mesures
prises n’ont pas été appliquées d’un seul coup; cela s’est passé lentement pendant 40 ans
environ. Ce processus occidental de réforme a été fondé sur un système comprenant des
réglementations et des mesures de contrôle, qui a maintenu l’inflation et les salaires à des
petits niveaux et, surtout, a permis le contrôle sur le taux de change, le taux d’intérêt et les
prix des produits de base, en coexistence avec la propriété publique” - spécifiaient les
auteurs de “L’agenda de la reconstruction économique et sociale des pays de l’Europe
Centrale et de l’Est”. Après 1991, des dizaines d’auteurs occidentaux mentionnaient
qu’après la guerre, si les pays de l’Europe de l’Ouest avaient appliqué les programmes de
reconstruction essayés après 1989 dans l’Europe de l’Est, aucun des miracles
économiques des démocraties occidentales n’aurait existé. Peut-être que le potentiel des
pays ex-socialistes a-t-il été sous-estimé; il n’y avait peut-être pas de meilleure solution. Les
pays du centre et de l’est de l’Europe ont appliqué des stratégies différenciées (la Pologne,
par exemple, a abordé entre 1990-1992 une large thérapie de choc, la Hongrie est passée
aux réformes depuis les années 80, etc.), mais, pour la plupart de ces économies, on a
obtenu les résultats escomptés. Contrairement à cette catégorie de pays, le démarrage de
la transition en Roumanie a été bien plus difficile, à cause de sa situation particulière
d’avant 1989 : une ultra centralisation, une totale inefficacité économique - technologie
vieillie, industrie pas du tout compétitive.
La performance réduite de l’économie roumaine n’est pas forcément la conséquence de la
passivité des gouvernements par rapport aux réformes, mais plutôt des échecs de
matérialiser leurs intentions initiales. De toute façon, parmi les éléments qui ont beaucoup
contribué à ralentir la réforme on peut énumérer :
- la confusion concernant la forme de propriété des facteurs de production. On a
beaucoup prolongé le moment de la grande privatisation et, généralement, on l’a
commencée au moment où les diverses propriétés de l’Etat ne valaient plus rien (sous
l’effet destructeur de la corruption). Une fois exprimée l’option pour l’économie de
marché et éliminée la planification centralisée et le contrôle d’Etat sur les entreprises,
qui produisaient et détenaient les moyens de production, le gouvernement de l’époque
aurait eu l’obligation minimale de créer un substitut qui garde et veille sur le réseau
public pour empêcher la disparition des liaisons vitales existantes entre producteurs,
fournisseurs et acheteurs. Non seulement on ne l’a pas fait, mais on a même pris des

3
mesures antiéconomiques (création de monopoles, ce qu’on appelait la location de
gestion pour plusieurs propriétés appartenant à l’Etat, etc.). Par conséquent, même au
cas où l’on aurait pu sauvegarder des entreprises publiques, on s’est retrouvé devant
des firmes sans aucune valeur à rentabilité nulle (c’était peut-être le but). Ensuite, cela
n’aurait pas été trop dur pour que le Fond de la Propriété d’Etat (F.P.S.) les vende
pour rien. A leur tour, les acheteurs qui ont payé moins d’argent pour les acquérir que
pour le dessous-de-table donné aux “vendeurs”, se sont tout d’abord préoccupés de
récupérer de l’argent en procédant à la vente de certains actifs, terrains, etc.
- la corruption chronique, une étape qui ne pouvait pas être entièrement contournée,
mais qui a été un phénomène totalement négligé pendant longtemps (c’est encore le
fléau qui constitue la grande crainte des responsables de l’Union Européenne vis-à-vis
de la Roumanie).
- le système législatif instable qui a découragé et a éloigné les investisseurs étrangers ;
tout cela cumulé à une bureaucratie acerbe qui persiste encore à une plus petite
échelle. Fin 2002, on apprenait par les médias qu’on venait de démarrer les travaux
pour un investissement de 25 millions d’euros pour la construction d’un deuxième
hypermarché Carrefour; et les représentants des compagnies impliquées dans
l’exécution avaient déclaré que pour pouvoir obtenir tous les documents et les
autorisations - plus de 200 - ils en ont eu à peu près pour trois ans.
2 Qu’a signifié la transition du commerce roumain ?
Le monopole de la propriété publique dans toute l’économie, la centralisation excessive
avec l’absence d’un équilibre réel entre la demande et l’offre, le soutien de quelques
branches qui n’étaient pas performantes et utilisaient des technologies dépassées, le
manque de préoccupations réelles pour le développement du marché de distribution,
l’inexistence de la libre initiative et le fait de cacher l’inflation par l’absence des biens de
grande consommation sur le marché intérieur, ont mené, inévitablement, à la chute du
système économique planifié.
En ce qui concerne la réforme économique dans le commerce intérieur roumain, celle-ci a
eu comme point de départ la faillite du système économique, déterminée par la structure
politique dictatoriale du parti unique où toute l’activité était soumise à des restrictions
diverses, qui avaient provoqué les blocages du système. D’après Etudes et recherches
économiques (1999, [3]) les plus graves non-sens ont été générés par :
- Le blocage de la propriété : l’existence du monopole de la propriété d’Etat dans toute
l’économie a déterminé la dépersonnalisation du rapport production-commerce, a
éloigné l’offre de marchandises de la demande de la population, ce qui a conduit à la
dégradation de l’approvisionnement de la population, avec des conséquences néfastes
sur le niveau de vie de celle-ci ;
- Le blocage du système directif : le processus de la planification centralisée a imposé
aux entreprises commerciales l’utilisation d’un système d’indicateurs pour l’évaluation
du besoin de l’approvisionnement ainsi que l’observation de l’activité financière par le
budget de revenus et dépenses avec des normes financières qui devaient assurer la
couverture des coûts et l’obtention de bénéfices; dans ce cadre, à cause de l’optique
restrictive anormale, des répartitions centralisées, on a provoqué d’importants

4
blocages de stocks de marchandises, on a uniformisé les processus
d’approvisionnement, en promouvant, en fait, des principes antiéconomiques;
- Le blocage institutionnel : la structure organisatrice appuyée sur la double
subordination ainsi que sur le principe de la territorialité, ont généré un appareil
commercial rigide, géré par des principes administratifs et économiques autoritaires,
sans la prise en considération des motivations comportementales et de consommation
de ceux qui représentaient la demande de marchandises;
- Le blocage des structures du réseau commercial : l’implantation de structures, qui
n’étaient pas mises en corrélation avec les exigences d’efficience et de compétition, a
déterminé l’existence d’un monopole du commerce de gros, pas du tout intégré dans
une infrastructure de distribution pour assurer une logistique efficace des
marchandises du producteur vers le consommateur ; en même temps, le
développement du commerce de détail sur le principe de la territorialité a constitué le
point de départ de quelques monopoles zonaux qui ont rejeté dans un cercle vicieux la
concurrence, avec des effets négatifs sur le degré d’approvisionnement de la
population;
- Le blocage technologique : la politique d’investissements dirigée d’ une manière ultra
centralisée de même que les normes financières de l’époque, ont limité la dotation
technique du commerce ; entre celui-ci et les secteurs où l’on produisait les biens de
consommation existait un décalage très grand.
Le contexte des transformations socio-politiques des treize dernières années a
nécessairement imposé des changements au niveau de toute l’économie et, en particulier,
la réadaptation du système de distribution des marchandises dans l’environnement
concurrentiel, déterminé par les tendances de globalisation économique. Ces changements
ont été fortement conditionnés pendant toute cette période par la création d’un cadre
législatif qui encourage le développement de la propriété privée, l’assurance d’une
concurrence loyale et la suppression des monopoles, la garantie de la propriété tout comme
la fluidisation des procédures administratives en évitant une bureaucratie excessive.
L’ouverture politique, avec l’apparition concomitante de nouveaux marchés potentiels de
distribution, le développement des mécanismes réels de publicité, ont été des facteurs qui
avaient contribué à l’évolution vers une société basée sur la consommation, comme
possible moteur du développement économique. On s’est proposé d’aborder ces aspects
d’une manière synthétique, en marquant les moments importants de l’évolution vers une
économie de marché, tels qu’ils étaient dans le secteur du commerce de détail, en
commençant par l’utilisation et l’interprétation des données statistiques. La présentation et
la détermination des limites des déséquilibres du réseau commercial, la compréhension de
leurs causes, ainsi que la mise en évidence - à ce niveau - des tendances futures
d’évolution, font également l’objet de ce commentaire.
Le commencement de la réforme dans le commerce, dans le contexte des déséquilibres
spécifiques à la période de transition à l’économie de marché, a généré une série d’effets
négatifs dont :
- la diminution quantitative et qualitative de l’offre de production interne ;
- la croissance accentuée des prix de ventes de détail ;

5
- l’apparition des pratiques déloyales entre les agents économiques, concernant autant
le niveau et la structure de l’offre que le niveau des prix pratiqués ;
- la manifestation du phénomène de l’évasion fiscale ; les fréquents transferts de
marchandises des sociétés commerciales à capital public vers les commerçants
particuliers, qui par le manque d’un contrôle financier rigoureux et d’une législation
complète, favorisaient la pratique des prix de “bourse noire” ;
- l’apparition du blocage financier avec un effet direct sur le rythme des livraisons et
implicitement, sur l’approvisionnement de la population.
De telles firmes sont apparues grâce à un complexe de facteurs, la plupart étant inhérents
à la période de transition à l’économie de marché ; les plus significatifs étaient :
- l’automatisation des agents économiques n’a pas été réalisée de façon concomitante à
la consolidation d’une infrastructure de marché, qui permette des liaisons de
coopération et d’intérêts, en fonction des différentes phases de la distribution des
marchandises et des services ;
- l’existence de certaines imperfections dans le cadre des réglementations promues (par
exemple, l’apparition de cinq actes normatifs dans le même but : la concession de la
location de gestion et le louage) ;
- l’application difficile des prévisions des actes normatifs et pas toujours dans les
conditions de transparence du processus de privatisation ;
- le retard dans l’initiation de certaines réglementations qui assurent la consolidation de
l’environnement concurrentiel et de la protection économique et sociale des agents
économiques et de la population (la loi pour la protection des consommateurs – en
plusieurs fois, on a même constaté la diminution des préoccupations pour assurer et
garantir la qualité des produits -, la loi de la faillite, la loi concernant la
commercialisation des produits et des services commerciaux – beaucoup de magasins
et rues commerciales étaient devenus de vrais bazars) ;
- l’activité réduite dans le domaine de l’éducation économique des agents commerciaux
et de la formation des managers pour le commerce : on remarquait la présence de
beaucoup d’agents économiques qui déroulaient des activités de commerce sans avoir
la formation professionnelle et les conditions financières minimes qui justifient leurs
préoccupations, ce qui a aussi conduit à l’apparition de certaines situations de
concurrence déloyale et évasion fiscale ; de plus, par leur transposition dans le
processus de distribution, ils déterminaient l’augmentation des prix de la vente de
détail.
L’impact des changements du domaine économique et politique sur le système de
distribution des biens de consommation a été assez rapide et visible. Les transformations
les plus importantes se sont produites dans le domaine des canaux de distribution, dans les
structures qui assurent et contribuent au déplacement des marchandises des producteurs
vers les consommateurs. Les principales modifications qui ont eu lieu dans la distribution
des biens de consommation ont été déterminées par les processus de réforme et transition
à l’économie de marché. Les mutations les plus importantes se sont concrétisées dans une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%