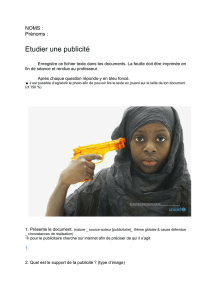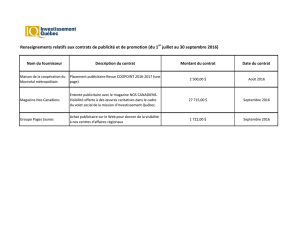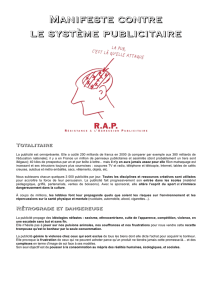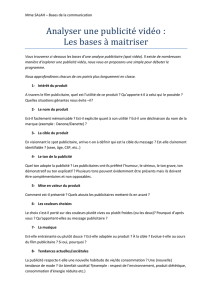« Y`a bon Banania

« Y’a bon Banania! » : quand le discours publicitaire
subsume les représentations des sens linguistiques
Notre communication s’intéresse à la représentation du sens linguistique dans la stéréotypie
de l’Africain, à travers la mise en discours de la figure du tirailleur sénégalais, développée
dans les discours coloniaux. Nous nous attacherons à montrer le rôle de la circulation
discursive de représentations du sens dans deux contextes discursifs différents :
- les différentes publicités de Banania, parues à partir de la 1re guerre mondiale ;
- les textes coloniaux contemporains : récits de missions militaires, manuel à l’usage des
troupes, dont certaines contiennent des gravures représentant les tirailleurs sénégalais.
À partir du repérage des programmes de sens représentés dans les deux contextes, nous
montrerons leur dérivation d’une matrice interdiscursive commune : des correspondances
précises peuvent être établies, à l’aide de marqueurs concrets, entre le sens produit dans les
discours écrits et sa représentation dans le discours publicitaire. Dans le contexte pluri-
sémiotique de la publicité, l’analyse des marqueurs linguistiques ne peut être désolidarisée de
celle de l’iconographie : dessin, code de couleurs, mise en scène graphique. Nous montrerons
que, par l’interaction entre les images et les marqueurs linguistiques, que sont le nom de
marque et le slogan, le discours publicitaire est une reformulation qui condense et subsume
les représentations du sens linguistique des discours écrits avec lesquelles il est en relation.
Dans les cadres théoriques de l’analyse du discours et de la sémantique discursive, les
analyses des représentations du sens dans les deux contextes discursifs étudiés – dans les
discours écrits et dans le discours publicitaire – seront conduites en parallèle par deux
chercheurs. La confrontation des résultats, dans un second temps, permettra d’évaluer les
différences et les similarités, de mettre en évidence les liens qui spécifient leur appartenance à
la formation discursive coloniale, d’identifier les particularités de chacun des contextes et leur
participation respective dans la représentation durable d’un stéréotype du noir.
Indication de bibliographie :
Grunig B.-N. [1990], Les mots de la publicité : l’architecture du slogan, Paris, Presses CNRS.
Moirand S. [2004], « L’impossible clôture des corpus médiatiques », Tranel 40, 71-92
Paveau, M.-A. [2006], Les prédiscours : sens, mémoire, cognition, Paris, Presses Sorbonne
Nouvelle
Rosier L. [2006], « Nouvelles recherches sur le discours rapporté : vers une théorie de la
circulation discursive ? », Tranel 44, 91-105
Siblot P. [1999], « De l'un à l'autre : dialectique et dialogisme de la nomination identitaire »,
in Bres et al., L’autre en discours, Montpellier, Université Paul-Valéry.
1
/
1
100%