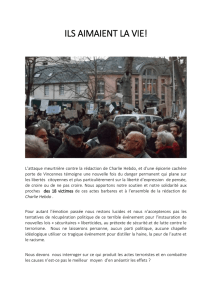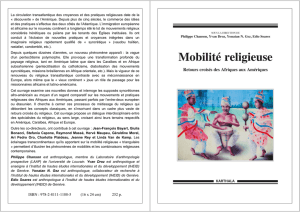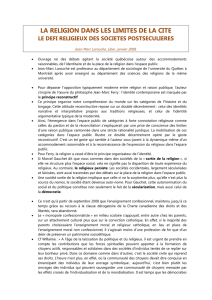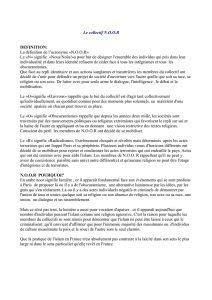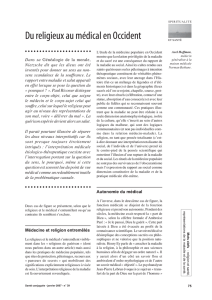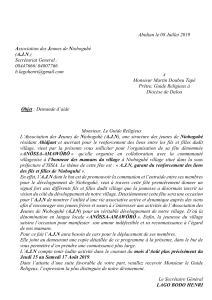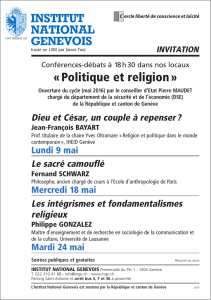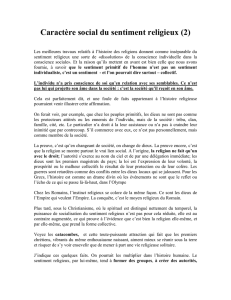b – la definition du tourisme religieux

Réunion de Travail Paray le Monial – Les Aspects du Tourisme Religieux en France
1
LES ASPECTS DU TOURISME RELIGIEUX EN FRANCE
INTRODUCTION
Depuis les années 50, le tourisme connaît un essor exceptionnel. Cet essor n'a toujours pas faibli et il
est un facteur de développement important pour de nombreux pays.
Les professionnels du tourisme affirment que tout ce qui bouge est d'ordre touristique et ils ont vite
"absorbé" l'une des plus anciennes formes de tourisme qu'est le tourisme religieux. S'il est vrai que
celui-ci consomme des prestations touristiques, il possède une spécificité fondamentale : il s'adresse
avant tout à "l'âme" de l'individu.
LES RELIGIONS ET LE TOURISME
Dans les cinq principales religions pratiquées en France, on constate deux grandes tendances :
1. Les religions qui incluent dans leur pratique le concept de pèlerinage et de retraite : les
catholiques, les musulmans, les bouddhistes. Ces religions, et en particulier la religion catholique
en France, ont mis en place toute une organisation pour faciliter et développer ce type de
pratique.
2. Les religions pour lesquelles le concept de "pèlerinage" n'existe pas, mais dont les adeptes
pratiquent néanmoins une forme de tourisme liée à la religion ou plutôt à l'histoire de la pratique
de cette religion. Les protestants et les juifs visitent les sites qui marquent l'histoire de leur
coreligionnaire : lieux de mémoire, en général des lieux de persécution.
Au vue de ces deux tendances, on peut définir trois aspects du tourisme religieux :
1. L'aspect spirituel : le tourisme religieux est un des moyens pour l'individu de se rapprocher de
Dieu en tant que croyant convaincu ou en tant que potentiel croyant dont la foi se révèle au cours
d'un voyage, d'une visite d'un lieu sacré.
2. L'aspect sociologique : le tourisme religieux est un moyen pour le croyant de connaître mieux
l'histoire de son groupe religieux
3. L'aspect culturel : la visite de lieux spirituels et de sanctuaires est un moyen pour l'individu
croyant ou non croyant de développer les messages que nous ont laissé les religions qui ont
façonné et qui façonnent encore plus les sociétés.
LIEUX DE PELERINAGE ET SANCTUAIRE
Les gestionnaires du haut lieu du tourisme religieux catholique en France observent des modifications
dans leur fréquentation et doivent forcément s'adapter aux évolutions du "marché religieux" :
1. L'augmentation de la demande avec pour conséquence la croissance des difficultés des gestions
des sites et notamment en capacité d'accueil qui devient insuffisantes.
2. L'arrivée de nouvelles clientèles des ex pays de l'est, à très faible pouvoir d'achat. qu'il faut
satisfaire.
3. L'augmentation du nombre de touristes à motivation cultuelle, dont les besoins diffèrent des
pèlerins classiques et posent le problème de leur cohabitation.

Réunion de Travail Paray le Monial – Les Aspects du Tourisme Religieux en France
2
LE TOURISME EN MILEU RELIGIEUX
On constate dans les hauts lieux religieux que très souvent, les aspects touristiques s'affirment de
façon aussi important que les aspects religieux :
- D'abord l'organisation des visites et l'hébergement
- Les hauts lieux reçoivent souvent plus de visiteurs à motivation culturelle que de visiteurs à
motivation religieux et la valorisation du patrimoine religieux répond à cette motivation culturelle
(création d'un son et lumière à Istanbul ou la mise en place d'une "série d'évènements dans une
ville de pèlerinage comme la commémoration du 9ème Centenaire de Paray le Monial").
I - L'ASPECT DU TOURIME DANS LE CATHOLICISME
A - L'EGLISE CATHOLIQUE ET LE TOURISME
Pour aborder le tourisme religieux, il est indispensable d'évoquer la situation actuelle de l'Eglise en
France, qui depuis quelques années, se transforme :
- 81 % se déclarent catholiques même s'il y a de grandes différences dans les degrés
d'appartenance (82 % sont baptisés, 18 % sont pratiquant régulier, 18 % sont pratiquants
occasionnels).
Ainsi, comme constate René Aucourt, délégué National de l'Episcopat pour la Pastorale du
Tourisme et des Loisirs, les églises, les hauts lieux spirituels et sanctuaires sont des lieux de
références commun à tous, pratiquant ou non.
On assiste à l'effondrement de pans entiers d'activités traditionnelles de l'Eglise et en même temps à
la naissance du développement d'autres activités : multiplication des grands rassemblements, création
de nombreux groupes de prières, disparition des mouvements d'activité catholique traduisant un
engagement politique et social au nom de la foi.
Les acteurs du tourisme religieux sont :
- les directeurs diocésains de pèlerinage qui organisent les pèlerinages
- les agences spécialisées qui proposent des voyages dont la dimension touristique est plus
développée
- les sanctuaires gérés par un recteur nommé par l'Evêque
- des associations pour l'accueil constituées pour répondre à la demande des visiteurs, des églises
et hauts lieux spirituels
- la Pastorale du Tourisme et des Loisirs, service de l'Eglise chargé de prendre en compte toute la
dimension "tourisme et loisir"
- la demande en matière de tourisme évolue avec une chute des "pèlerinages officiels" au
bénéfice de voyage individuel et en petit groupe.
B – LA DEFINITION DU TOURISME RELIGIEUX
Le tourisme religieux n'est qu'une étoile "dans la galaxie du tourisme tout cours".
Pierre Talec, responsable de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs à Paris, le définit de la façon
suivante :
- d'un point de vue spirituel, c'est la manière moderne d'être relié au Dieu – Créateur
- d'un point de vue sociologique, c'est l'accès à la culture des grandes religions

Réunion de Travail Paray le Monial – Les Aspects du Tourisme Religieux en France
3
- d'un point de vue culturel, c'est un moyen de se cultiver humainement à travers une
interaction valorisante pour l'homme.
Pierre Talec caractérise le tourisme religieux contemporain de la façon suivante :
- inséré dans la civilisation des loisirs : le pèlerin est d'abord un touriste avec tout ce que cela
entraîne sur le plan matériel : tributaire de l'économie de marché, c'est un "produit comme les
autres"
- caricaturé par le "culte des idoles" : à l'instar des autres formes de tourisme, le tourisme religieux
génère des effets pervers (artificialité, trivialité … )
- pris en charge par la Pastorale de l'Eglise qui cherche à concilier tourisme et religion au travers de
la réflexion théologique, la formation des chrétiens impliqués dans le monde du tourisme et des
loisirs, l'animation.
C - TOURISME RELIGIEUX OU TOURISME EN MILIEU RELIGIEUX
Michel Bauer, maître de conférence à l'Université de Savoie, définit trois attitudes face à une œuvre
qui est également un objet de culte :
- la première est exclusivement un objet de culte et prône la destruction ou la réaffectation de cette
œuvre
- la deuxième veut donner un nouveau sens à cette œuvre
- la troisième correspond à une attitude œcuménique quand les tenants des deux cultes acceptent
d'honorer deux dieux "différents" : la Trinité d'une part, et le culte "du beau et de la mémoire"
d'autre part. De la même façon, le concept de touriste en milieu religieux permet de concilier les
notions de pèlerinage et celles du tourisme.
Une typologie des touristes religieux peut être :
- le pèlerin qui se situe totalement en dehors du tourisme pour vivre une expérience purement
religieuse, voire transcendantale
- le religieux traditionaliste
- le religieux libéral et témoin de sa foi
- l'apôtre de l'art, de la culture ou de l'ethnologie
- l'idéologue laïc.
Toujours d'après Bauer, les solutions proposées pour un marketing du produit "touristique religieux"
sont :
- le marketing d'un service (accueil, gestion des flux…)
- le management d'une organisation (travailler avec les gestionnaires des sites : des représentants
de l'Eglise)
- des solutions pragmatiques pour concilier les besoins des uns et des autres (recueillement, savoir
et connaissance, loisir)
- la cohabitation et la segmentation du marché.
II – L'ASPECT DU TOURISME DANS LE PROTESTANTISME
Comme pour le catholicisme pour aborder l'aspect tourisme religieux protestant, il faut avoir un
aperçu de l'Eglise protestante en France. Minoritaire en France, le protestantisme compte environ 950
000 fidèles regroupés au sein de plusieurs églises de sensibilité théologique différente :

Réunion de Travail Paray le Monial – Les Aspects du Tourisme Religieux en France
4
- les églises dites "réformées" sont les plus nombreuses et réclament en partie de la tradition
Calviniste
- les églises luthériennes, implantées surtout en Alsace, dans le pays de Mombéliard et à Paris
- les églises nées à l'époque de la Grande Réforme religieuse du XXème siècle : les églises
évangélistes et pentecôtistes développées depuis le début du siècle.
En France, la majorité des églises protestantes se sont regroupées au sein de la Fédération
Protestante de France créée en 1905 quelques mois après la loi de séparation des Eglises et de l'Etat,
dont la vocation est de représenter le protestantisme.
Les protestants refusent la notion de lieu sacré. Ils sont attachés à des lieux de mémoire (liés à
l'histoire huguenote) , qui s'inscrivent dans la mémoire collective comme des lieux de rencontre mais
pas comme des lieux de culte. Ces lieux de mémoire abritent souvent un musée protestant pour
réfléchir sur leur avenir. Par ailleurs, des formations sont organisées avec les guides de ces musées.
Certaines paroisses organisent des voyages vers des lieux de mémoire (dans lesquels se trouve
souvent un musée) mais on ne peut parler de "tourisme religieux" au sens stricte du terme.
La grande fête du Désert au musée Mialet, dans les Cévennes, rassemble chaque année des
protestants du monde entier.
On dénombre plus d'une dizaine de musées protestants dont les plus connus sont : la Bibliothèque
musée de Paris Rive Gauche, le musée Calvin à Noyons, le musée de Bois Tiffrais en Vendée, le
musée protestant de la Rochelle, le musée du Désert à Mialet dans les Cévennes, le musée Oberlin
dans le Bas Rhin, le musée du protestantisme Dauphinois.
III – ASPECT TOURISTIQUE DANS LE JUDAISME
L'Etat d'Israël a tardivement compris l'intérêt culturel et économique que présente un développement
du tourisme international de masse qu'il a envisagé normalement dans les années quatre vingt dix. Ce
pays en proie aux guerres à répétition a su dans les accalmies, développer un tourisme basé sur la
religion (en 1987, le tourisme international a drainé 1 500 000 pèlerins en dehors des excursions de
croisière qui ont atteint 900 000 personnes).
La politique du gouvernement était d'attirer des capitaux en Israël et encourage les investisseurs
étrangers avec un soutien particulier aux équipements touristiques (subvention jusqu'à 38 % des
investissements, baisse de l'impôt sur les sociétés, exemption de la TVA pour les services aux
touristes).
Mais les accouts belliqueux ont fait s'estomper le tourisme purement religieux.
Il faut rappeler que le concept de pèlerinage n'existe pas dans la religion juive. Mais il existe un
touriste juif qui n'est pas lié à la pratique de la religion. Par contre, il est lié à la religion elle-même
avec comme motivations principales :
1. la quête de l'histoire du peuple juif (les lieux de mémoire : mur des lamentations, les camps
d'extermination, le Vel d'Iv)
2. le retour à la Terre Promise
3. le ressourcement religieux sans que l'on puisse parler véritablement de pèlerinage.
Le pays tout entier est bien un haut lieu du tourisme juif. Israël est la terre d'origine et de référence
spirituelle pour environ 17 millions de juifs dans le monde entier.

Réunion de Travail Paray le Monial – Les Aspects du Tourisme Religieux en France
5
80 % de tourisme français vers Israël est juif. Pour les 20 % restant, il s'agit de pèlerinage catholique
en Terre Sainte et représente le seul lieu non juif d'importance.
Le tourisme religieux vers Israël est devenu un tourisme de plus en plus culturel. Cela se traduit dans
le contenu des forfaits touristiques qui tend à montrer que la Terre Sainte est une terre de rencontre
de civilisations. Les touristes veulent des spectacles, une animation structurée, des hôtels ou
hébergement confortables, d'où l'encouragement de l'Etat au développement de l'infrastructure
touristique et les voies d'un tourisme de type balnéaire tropical et méditerranéen s'ouvrent plus
largement.
IV – ASPECT DU TOURISME ISLAMIQUE
Les déplacements pour des motifs religieux sont restés pendant longtemps ignorés par les
observateurs de la vie musulmane en France.
L'importance qu'ont prise les différentes formes de pèlerinage est un signe du regain de spiritualité
apolitique.
Chaque année, environ 15 000 pèlerins français musulmans se rendent en pèlerinage à la Mecque. La
plupart s'y rendent en avion mais certains acceptent de s'y rendre par la route. Le coût moyen
avoisinne 2 300 Euros (dont 250 Euros prélevés par le gouvernement Saoudien pour compenser les
"prestations terrestres").
Afin de "moraliser" cette activité, d'éviter les abus et de redonner leur vrai sens aux pèlerinages à la
Mecque, qui s'estompaient suite à la guerre du Golf, la mise en place d'une instance représentative en
France a été nécessaire, et a été mise en place début 2003.
Au travers d'une association loi 1901 "Foi et Pratique", les musulmans français se déplaçant en
groupes, avaient comme motif l'encouragement de l'ouverture des salles de prières par les
associations locales.
L'association "Foi et Pratique" organise des récollections de fin de semaine animées par des sortes de
"gyro vagues" qui visite les mosquées à tour de rôle et invite les fidèles à entreprendre des séjours
plus prolongés dans des bâtiments religieux de l'Inde, du Pakistan, et plus près au Magreb : à
Mostagen (Algérie), à Sidi Bou Saïd (Tunisie), à Sisi Meherez (Tunisie) où à Fès (Maroc).
En résumé, comme le dit l'écrivain Sadek Sellam "le pèlerinage est une occasion privilégiée de
constater la ferveur parfois impressionnante de nombreux fidèles cherchant à adorer Dieu seul sans
médiation. Mais ce grand moment de la vie religieuse musulmane montre que le site n'est pas à l'abri
des secousses de la vie : la pensée des bénéficiaires de l'usage du religieux peut être moins pure que
celle des "hôtes de Dieu" à la recherche de la sanctification que favorise le dépouillement près de la
"Maison de Dieu"".
V – ASPECT DU TOURISME RELIGIEUX DU BOUDDHISME
D'après le Président de l'Union Bouddhiste de France, 550 000 personnes se réclament de la
tradition bouddhiste. Il faut rappeler que cette religion représente 40 % de la population mondiale.
La doctrine de Bouddha s'appuie sur un seul concept : reconnaître la souffrance et s'en libérer et
l'expérience humaine prend une valeur particulière, celle de permettre à l'homme de s'affranchir de sa
condition insatisfaisante et de connaître le bonheur, la lucidité et la liberté intérieures.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%

![Où est Dieu dans le terrain ? [DOC - 42 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005150914_1-9a4f161a9df654c67d74e91720fc519e-300x300.png)