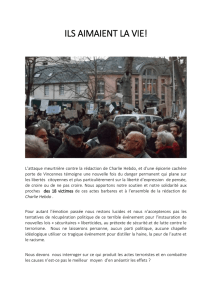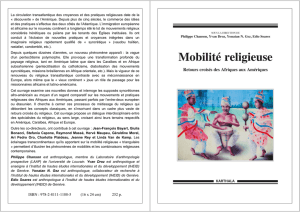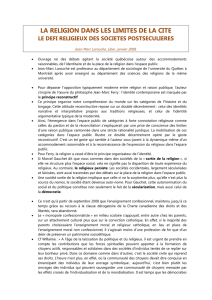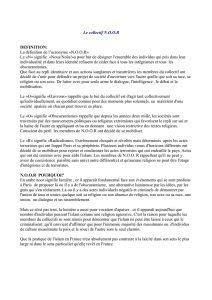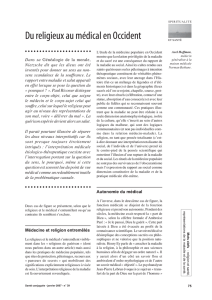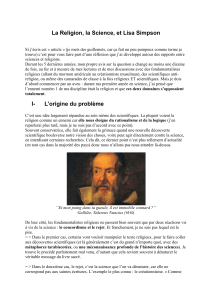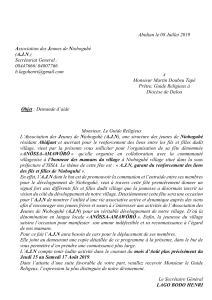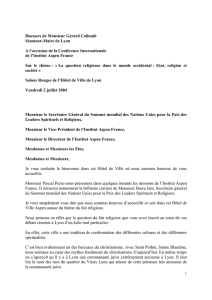Où est Dieu dans le terrain ? [DOC - 42 Ko ]

Frédéric Dejean
frederic.dejean@yahoo.fr
Doctorant à l’Université de Paris X-NANTERRE
UMR LOUEST (7145)
Où est Dieu dans le terrain ?
La question de départ porte sur la manière dont la géographie peut rendre compte de la
religion et du fait religieux dans le terrain, sur la présence de la divinité dans ce dernier, comment elle
peut la localiser et en déterminer une spatialité. Plus généralement, nous nous inscrivons pleinement
dans un questionnement sur la nature des objets auxquels le géographe est confronté en situation de
terrain. Les objets de la croyance et de la religion apparaissent d’autant plus difficiles à appréhender
qu’ils relèvent d’une adhésion qui préexiste à leur apparition (« je vois parce que je crois »), mettant à
mal les principes de neutralité scientifique ou d’athéisme méthodologique pourtant de rigueur. La
question porte finalement sur la nature des comptes-rendus du géographe après l’expérience du terrain.
De quoi parle-t-il dès lors qu’il aborde le thème du fait religieux ?
Notre projet de communication porte sur deux façons d’aborder les relations existant entre le
terrain et la géographie : interroger les manières par lesquelles la géographie appréhende le fait
religieux en situation de terrain et les réponses qu’elle a pu apporter, d’une part, et analyser comment
les autres sciences sociales participent du renouvellement des approches géographiques du terrain
religieux, d’autre part.
Il s’agit avant tout de se demander dans quelle mesure il est légitime de parler d’un « terrain
religieux » propre à la géographie. La thèse que nous soutenons est que ce « terrain religieux » est bien
réel dans la mesure où le fait religieux s’exprime dans et par l’espace. La tâche du chercheur est alors
de mettre en avant les spécificités de sa discipline dans l’appréhension du fait religieux. Cette
approche spatiale de la religion est d’autant plus juste qu’elle s’affirme au moment même où des
auteurs mettent en avant l’idée de pratiques religieuses parfaitement déterritorialisées, s’appuyant
désormais sur les réseaux de télécommunication, à commencer par Internet.
Afin d’interroger la pertinence de cette notion de « terrain religieux » nous mettrons l’accent
sur les travaux géographiques du fait religieux et les spécificités de ce terrain qui en découlent. Nous
nous attarderons également sur l’exemple des Eglises évangéliques et pentecôtistes qui connaissent
actuellement un succès grandissant à l’échelle de la planète. Nous montrerons en particulier comment
ces dernières proposent au géographe un redoutable défi dans la mesure où elles recourent largement à
des catégories spatiales en tant que ressource pratique et élément de leurs propres doctrines.

1
/
2
100%