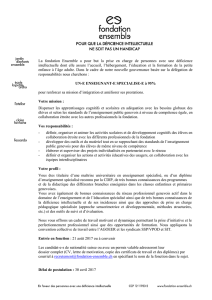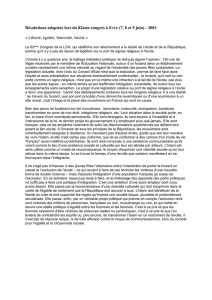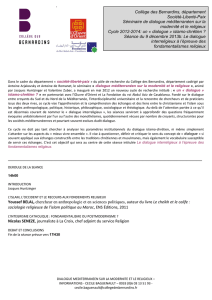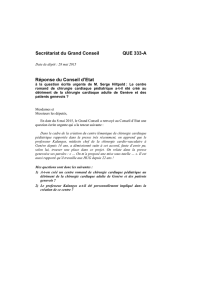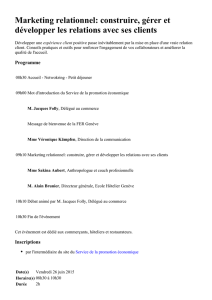Dieu et César, un couple à repenser?

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS Promenade du Pin 1 - 1204 Genève
T. 022 310 41 88 - [email protected] - www.inge.ch
Parking Saint-Antoine et arrêt bus 3, 7 et 36 à proximité
INVITATION
Conférences-débats à 18 h 30 dans nos locaux
« Politique et religion»
Ouverture du cycle (mai 2016) par le conseiller d’Etat Pierre MAUDET
chargé du département de la sécurité et de l’économie (DSE)
de la République et canton de Genève
Dieu et César, un couple à repenser ?
Jean-François BAYART
Prof. titulaire de la chaire Yves Oltramare «Religion et politique dans le monde
contemporain», IHEID Genève
Lundi 9 mai
Le sacré camouflé
Fernand SCHWARZ
Philosophe, ancien chargé de cours à l’Ecole d’anthropologie de Paris
Mercredi 18 mai
Les intégrismes et fondamentalismes
religieux
Philippe GONZALEZ
Maître d’enseignement et de recherche en sociologie de la communication et
de la culture, Université de Lausanne
Mardi 24 mai
L’Institut National Genevois est soutenu par la République et canton de Genève 2016
Soirées publiques et gratuites Résumés au verso
C ercle liberté de conscience et laïcité

Dieu et César, un couple à repenser ?
Comment penser le retour en force de la foi sur la place publique, voire des institutions religieuses
sur la scène politique ? L’analyse de situations sociales concrètes, contemporaines ou historiques,
permet de saisir l’articulation du religieux et du politique au-delà des passions identitaires et des
emportements idéologiques qui tiennent le haut du pavé.
Les deux répertoires s’imbriquent souvent, plutôt qu’ils ne s’opposent ou n’entretiennent des
relations d’extériorité. Ils partagent d’ailleurs une même ambition: celle de porter le bien commun.
Ils mêlent aussi, chacun, l’ordre de l’imaginaire et celui de la raison. Et pourtant le religieux et le
politique ne se confondent pas. Ils obéissent à des logiques intrinsèques qui garantissent leur
autonomie mutuelle, y compris dans les sociétés dites islamiques, contrairement à l’idée reçue.
Dieu et César agissent souvent comme larrons en foire, une fois qu’on leur a rendu ce qui leur
revient. Pour en rendre compte, il s'agit de proposer un nouveau paradigme des relations entre
religion et politique : celui de la cité cultuelle, qui naît des pratiques rituelles, de plus ou moins forte
intensité religieuse, et parfois sécularisées, autant que des idéologies et des politiques publiques.
Le débat sur la laïcité s’en trouve éclairé d’un jour inédit et apaisant.
Le sacré camouflé
Malgré la sécularisation de nos sociétés contemporaines, le fond archaïque symbolique de l’être
humain n’a pas disparu. Ces traces du sentiment religieux se retrouvent aujourd’hui camouflées
dans nos pratiques quotidiennes.
Le symbolique est un des ressorts cachés du pouvoir.
Le désengagement des pratiques symboliques, comme celle des rites de la démocratie démobilise
l’élan collectif qui cherche alors d’autres voies d’expression, tels le communautarisme, le
phénomène des bandes, la tribalisation, le repli identitaire.
Les intégrismes et fondamentalismes religieux
Les notions d’« intégrisme» ou de «fondamentalisme » renvoient aujourd’hui à un religieux
communautaire qui peine à composer avec les différends et les différences au sein de la société.
Notre réflexion portera sur un opérateur critique de la religion: la culture. Celle-ci introduit
d’emblée au sein d’une communauté religieuse un différentiel, relatif aux variations entre les
groupes qui la composent ou à son histoire, les façons de faire ayant varié au cours du temps. On
retrouve alors, de façon embryonnaire, l’opération comparative et relativisante que l’anthropologie
exerce sur les groupes humains et l’historiographie sur la durée. Il n’est dès lors pas étonnant que
l’intégrisme ou le fondamentalisme tentent de neutraliser cette dimension critique en soustrayant
le religieux à la culture.
Section Sciences morales et politiques
Rejoignez-nous ! Devenez membre de l’Institut National Genevois
La mission de l’ING, fondé en 1853 et soutenu par la République et canton de Genève, est d’aider
les Genevois à saisir les changements sociaux, économiques, culturels et politiques qui
interviennent dans leur environnement. Lieu d’échanges et de réflexions, notre institut se veut
ouvert à toutes et à tous. Les membres de l’ING reçoivent évidemment une information complète
sur les manifestations que nous organisons et y accèdent gratuitement. Ils bénéficient par ailleurs
d’un certain nombre d’avantages culturels et commerciaux.
1
/
2
100%

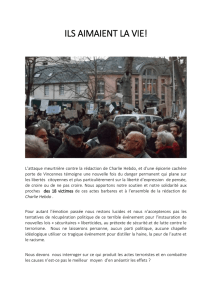
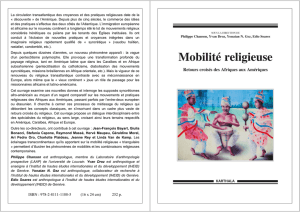


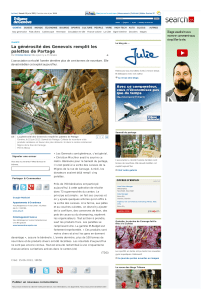
![Où est Dieu dans le terrain ? [DOC - 42 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005150914_1-9a4f161a9df654c67d74e91720fc519e-300x300.png)