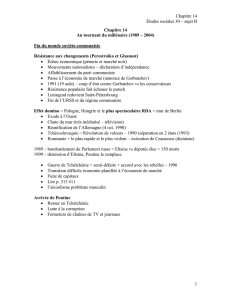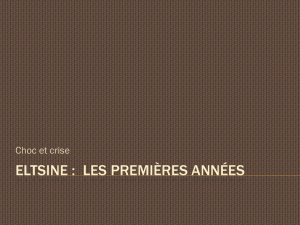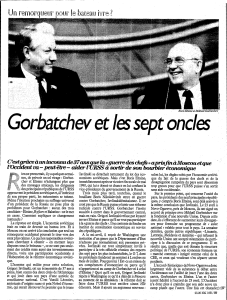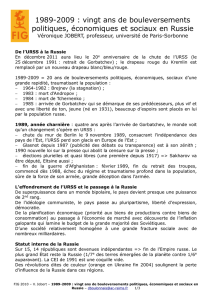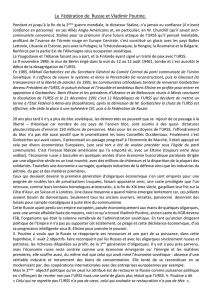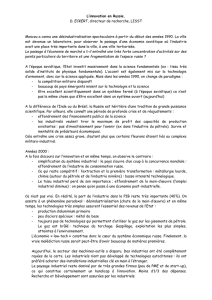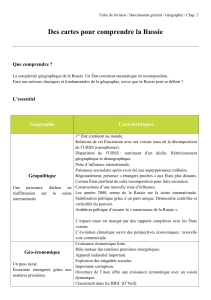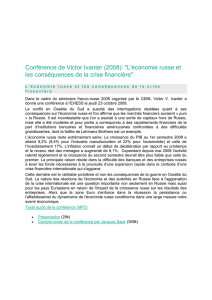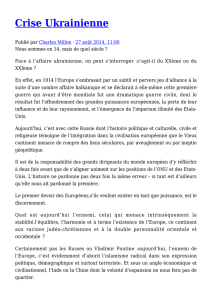La géographie économique - Cours-univ

1
Note : 11 ouvrages utiles – six en français et cinq en anglais – sur la civilisation russe et sa langue vous sont offerts à la fin de
ce livre.
L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques fut proclamée le 30 décembre 1922. Lénine
assure alors une libéralisation contrôlée du régime, qui permet la relance de l’économie et une hausse
du niveau de vie avec la NEP (« nouvelle politique économique. ») La construction de l’État soviétique
se consolide avec l’absorption des républiques non russes, l’adoption de la Constitution de 1924 et sa
reconnaissance par les puissances occidentales. Après la mort de Lénine en 1924, Staline, secrétaire
général du Parti Communiste de l’Union Soviétique (PCUS), élimine Trotski et l’opposition de « gauche »
en 1929, puis l’opposition de « droite » (Boukharine.) Staline peut alors donner la priorité à deux
objectifs : le renforcement de l’État et le développement économique. De 1934 à 1939, le NKVD,
nouvelle police politique, instaure la terreur, emprisonnements, exécutions et déportations en masse
vers les camps de concentration. Une série de grands procès (1936-1938) décime notamment l’armée
Rouge et le parti communiste, frappant en priorité la « génération d’octobre. » Les plans quinquennaux,
à partir de 1929, exigent de chaque citoyen un travail acharné et de grands sacrifices matériels.
L’infrastructure et l’industrie lourde font des progrès importants, mais les industries légères sont
négligées, et le niveau de vie reste bas. Dans les campagnes, la collectivisation forcée se heurte à
l’opposition des paysans enrichis par la NEP : les koulaks. La répression est impitoyable, et le secteur
agricole se trouve complètement désorganisé pour de longues années. En politique extérieure, Staline
soutient la constitution de « fronts populaires » (France, Espagne.) En 1939, le pacte germano-
soviétique permet l’annexion de vastes territoires occidentaux et retarde la guerre avec l’Allemagne, qui
envahit l’URSS en 1941.
Le 30 décembre 1922 l’union des républiques socialistes soviétiques est fondée. A cette date elle
comprend les Républiques de Russie – qui englobe toute l’Asie centrale – d’Ukraine, de Biélorussie et
de Transcaucasie. Remaniée en 1923 et 1924, la constitution soviétique proclame l’égalité en droit des
républiques et leur souveraineté, mais le fonctionnement institutionnel de l’union favorise de fait
l’intervention du pouvoir central dans les organes républicains. De nombreux changements dans les
découpages et les statuts territoriaux interviennent jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1936, qui
donne à l’Union soviétique sa physionomie quasi définitive, sauf sur la frontière occidentale, où de
nouvelles modifications interviendront à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
Depuis sa première attaque cardiaque, survenue en mai 1922, Lénine ne participe que sporadiquement
à la vie politique, avant de s’en trouver définitivement écarté en mars 1923. A la fin de sa vie, il exprime
ses inquiétudes devant l’évolution du parti – marquée notamment par le poids de la bureaucratie -,
critique les principaux dirigeants, en particulier Staline, secrétaire général depuis 1922, avec lequel il est
en désaccord sur la question national et qu’il recommande d’écarter de son poste. Le retrait de Lénine
attise les oppositions au sein de la direction du parti, qui s’étalent au grand jour après la mort, le 21
janvier 1924, du chef historique de la révolution.

2
La lutte pour la succession domine dès 1924 la vie politique soviétique. Le secrétaire général renforce
ses positions au sein du parti en s’alliant avec Léon Kamenev et Grigori Zinoviev pour lutter contre le
« nouveau cours » réclamé par Trotski, lequel défend la nécessaire démocratisation de l’appareil.
Cependant, la troïka – Staline, Zinoviev et Kamenev – qui dirige le pays éclate lors du XII ème congrès
du parti en décembre 1925. Aux rivalités de personnes s’ajoutent des différends sur les grands choix
politiques et économiques de l’URSS. La poursuite de la NEP ou son abandon au profit d’une
industrialisation de massive du pays, revendiquée par Trotski, et le mode de fonctionnement du parti
constituent les principaux enjeux qui opposent les dirigeants. Tandis que Zinoviev et Kamenev
rejoignent Trotski dans l’ »opposition unifiée » de gauche, Staline se pose en médiateur entre celle-ci et
la droite du parti – incarnée par Nicolas Boukharine. Se présentant comme le fidèle héritier de Lénine,
utilisant son rôle de secrétaire général pour placer ses partisans aux postes clés de l’appareil, Staline
parvient à évincer l’ « opposition de gauche » en 1927. Trotski, exclu du parti en novembre, est expulsé
de l’URSS en 1929.
L’adoption en 1928 du premier plan quinquennal, qui marque le début de l’industrialisation accélérée du
paya et de la collectivisation, permet à Staline d’engager la lutte contre Boukharine et l’aile droite,
partisans de la poursuite de la NEP. En 1929, sa victoire est acquise au sein du parti. Le cinquantième
anniversaire du secrétaire général inaugure le culte dédié à Staline, qui, vingt-trois ans durant, va diriger
l’URSS.
La réalisation du premier plan quinquennal (1929 -1933) provoque un changement radical de l’univers
social soviétique. Après des années d’atermoiement sur fond de crise économique, toute la société se
trouve brusquement mobilisée pour entreprendre la modernisation structurelle du pays. Le plan est
orienté vers le développement de l’industrie lourde, l’ouverture des immenses chantiers de grands
combinats, notamment à Magnitogorsk (Oural) et à Dniepropetrovsk (Ukraine.) Vécue comme un défi
face aux crises qui frappent les pays capitalistes, la réalisation du plan est orchestrée par une
propagande de masse, qui associe étroitement le thème de la modernité du pays à l’édification de
socialisme. La « lutte sur tous les fronts », décrétée par le parti, se traduit par une grande campagne
antireligieuse, en 1929, et par une série de procès spectaculaires, en particulier celui du « parti
industriel » en 1930 et celui des mencheviks en 1931. La collectivisation agraire est accélérée entre
1929 et 1933. A la fin de l’année 1929, Staline lance la campagne de « liquidation des koulaks en tant
que classe. » Les grandes répressions qui accompagnent la « dékoulakisation » (expropriation,
réquisition des céréales et du bétail, déportation des paysans) et la collectivisation forcée du monde
rural provoquent la désertification des campagnes. En Ukraine, dans le Nord du Caucase et dans la
basse Volga, une famine d’une ampleur inégalée fait 6 millions de victimes en 1932 – 1933. En dépit des
conséquences désastreuses de la collectivisation, le premier plan est déclaré achevé avec succès en
décembre 1932. A cette date l’industrie lourde a augmenté de 273%, et 61% des terres ont été
collectivisées.
Une brève détente s’esquisse dans les deux années suivantes, mais elle est brutalement interrompue
après l’assassinat, le 1er décembre 1934, de Sergueï Kirov, secrétaire du parti de Leningrad. Le meurtre
de Kirov donne le signal de nouvelles mesures d’exception et d’une répression de masse. Les grands
procès publics de Moscou, intentés en 1936-1937 contre les dirigeants historiques du parti (Zinoviev,
Kamenev, Radek, Boukharine, Rykov), le jugement à huis clos des principaux chefs de l’armée
constituent la face visible des purges, qui atteignent toutes les couches sociales et toutes les régions du
pays. La population des camps soviétiques – assujettis depuis 1930 à l’administration du Goulag, qui
dépend du ministère de l’intérieur (NKVD) – passe de 500 000 détenus en 1934 à 2 millions en 1937 et
à 3 millions en 1939. Alors que le règne de la terreur atteint son paroxysme dans la seconde moitié des
années 1930, la nouvelle Constitution soviétique de 1936, présentée comme « la plus démocratique du
monde », définit les cadres de la légalité socialiste. L’évolution de l’idéologie officielle est marquée par le
retour progressif aux valeurs culturelles et sociales traditionnelles, vilipendées durant les années
révolutionnaires. L’interdiction de l’avortement en 1936 consacre la naissance d’un nouvel ordre moral
glorifiant la famille comme modèle de stabilité de la société socialiste. La révision de l’histoire aboutit à la
réhabilitation des figures fondatrices de la grande Russie et à une relecture positive de l’expansionnisme
tsariste qui annonce l’émergence du nouveau discours nationaliste. L’éthique et l’esthétique

3
néoclassiques sont requises pour fonder les références d’une société radicalement bouleversée par le
grand tournant économique des années 1930 et les purges de masse qui l’accompagnent.
La politique internationale de 1920 à 1941.
Durant ses premières années d’existence, le nouveau régime subordonne sa victoire à celle de la
révolution mondiale, sans laquelle le communisme russe, proclamé dans un pays socialement arriéré et
encerclé par les puissances capitalistes, n’aurait aucune chance de l’emporter. Lors de sa fondation à
Moscou, en mars 1919, l’Internationale communiste (Kominterm) se donne pour mission de coordonner
l’action des mouvements révolutionnaires pour préparer l’avènement du nouvel ordre mondial. Le
onzième congrès du Kominterm, tenu en 1920, adopte le principe de créer « un seul parti communiste
ayant des branches dans chaque pays. » Lénine et Trotski élaborent les 21 conditions d’admission au
Kominterm. Mais dans la pratique la priorité est donnée au développement des forces révolutionnaires
dans le monde, ardemment défendue par Trotski, est abandonnée avant même l’éviction politique de ce
dernier. Et la montée au pouvoir de Staline, partisan de « la construction du socialisme dans un seul
pays », consacre bientôt la subordination du Kominterm aux intérêts de l’URSS. Dans les années 1930,
l’organisation devient un pur instrument aux mains de l’État soviétique, qui téléguide la politique des
partis communistes étrangers. A partir de 1936, ses principaux dirigeants disparaissent, victimes des
purges. Lorsqu’il est officiellement dissous, en 1943, afin de rassurer les alliés, le Kominterm n’est plus
qu’une organisation fantôme.
Dès les années 1920, l’État soviétique cherche à normaliser ses relations internationales. Le traité de
Rapallo, signé avec l’Allemagne en 1922, inaugure une décennie d’échanges privilégiés avec ce pays,
qui constitue le principal partenaire occidental de l’URSS. En revanche, les relations du gouvernement
avec la France et la Grande-Bretagne restent distantes en dépit de la reconnaissance de jure de l’URSS
par ces États, en 1924. Jusqu’à l’avènement de Hitler, la politique extérieure de Staline s’inspire de la
théorie léniniste selon laquelle les « contradictions impérialistes » ne peuvent que renforcer la position
de l’URSS dans le monde. Toutefois, cette orientation change à partir des années 1933-1934 : face à
l’accroissement des tensions internationales suscitées par la montée au pouvoir du parti nazi, Moscou
entre dans le jeu de la sécurité collective engagé par les puissances occidentales. L’Union Soviétique
multiplie les traités de non-agression et d’assistance avec les États d’Europe et adhère à la Société des
Nations en 1934. Après avoir violemment condamné toute collaboration avec les sociaux démocrates
européens, Staline prône un front des forces antifascistes et intervient activement dans la guerre civile
espagnole. Mais la passivité des démocraties occidentales au moment de l’Anschluss renforce sa
méfiance à l’égard des pays alliés, dont il craint toujours un revirement dirigé contre l’État Soviétique.
L’abandon de la Tchécoslovaquie signe la faillite de la politique de sécurité collective et détermine le
rapprochement soviético-allemand. Il se concrétise le 23 août 1939 par la signature d’un pacte de non-
agression, assorti de clauses secrètes sur les zones d’influences en Europe de l’Est. Le pacte germano-
soviétique met en évidence le primat des intérêts géostratégiques sur les orientations idéologiques des
deux États.
Après plus de six ans de guerre de dévastations, le bilan est lourd pour le nouvel État, confronté à
l’ampleur des pertes humaines, à la famine et aux épidémies, à la désorganisation complète de
l’économie; la production industrielle et agricole recule bien au-dessous du niveau d’avant guerre, le
mécontentement populaire s’exprime par des révoltes paysannes, des grèves ouvrières, l’insurrection
des marins de Kronstadt en février mars 1921. Le pouvoir réprime impitoyablement le soulèvement, et le
dixième congrès du parti cherche au même moment à renforcer la discipline et la cohésion de ses
membres. Mais ce congrès marque aussi le lancement de la NEP, qui doit permettre le relèvement du
pays : son objectif premier est de rallier la paysannerie au régime et de restaurer la confiance, avec la fin
des réquisitions, la levée d’un impôt en nature puis en argent, et la liberté de vendre les surplus. Dans le
commerce et l’industrie, l’État fait une place au secteur privé, tout en gardant le contrôle des
mécanismes essentiels. Dès 1924/1925, l’augmentation de la production et de la productivité témoigne
d’un net redressement économique dont bénéficie l’ensemble de la population.
Cette période est aussi celle d’une refonte des institutions, marquée par la création de l’URSS en 1922
et par l’élaboration d’une constitution fédérale, ratifiée en janvier 1924. Mais les réformes économiques

4
et constitutionnelles s’accompagnent d’un durcissement de la lutte contre les opposants, d’une
intensification de la pression idéologique et, dans le parti lui-même, d’un renforcement des moyens de
centralisation et de contrôle. Avec la maladie de Lénine, frappé par une première attaque en 1922, se
développent d’âpres luttes pour le pouvoir. C’est le début d’une nouvelle période au cours de laquelle
Staline, devenu secrétaire général du parti en 1922 mettra progressivement en place un pouvoir absolu,
avec pour toile de fond le débat sur la NEP et ses effets.
L’ascension de Staline.
La lutte pour la succession a commencé avant la mort de Lénine, qui s’exprime, dès 1922-1923,
son inquiétude devant l’évolution du parti. L’ascension de Staline se fera par étapes, l’une de ses
grandes forces étant, dès 1924, de se poser en humble porte-parole du léninisme, soucieux des intérêts
du parti, sachant rester en retrait lors des grandes controverses pour jouer ensuite un rôle apparemment
modérateur. Il emploie en même temps ses fonctions de secrétaire général à un patient investissement
de l’appareil ; contrôlant peu à peu les rouages d’une organisation qui se renouvelle profondément avec
l’arrivée massive de nouveaux membres à la conscience politique encore limitée, plus dociles que les
vétérans de la révolution ou de la guerre civile. Moins brillant que nombre de ses adversaires, Staline
est, en revanche, plus proche d’une base qu’il sait mobiliser dans de grandes certitudes, n’hésitant pas à
utiliser des méthodes répressives héritées des années précédentes contre de nouveaux « ennemis »,
non plus extérieurs mais intérieurs au parti.
Les rivalités de personnes se doublent de controverses politiques et économiques, relevant de choix
décisifs pour l’avenir de l’URSS (poursuite ou abandon de la NEP, possibilité de construire le socialisme
dans un seul pays, rôle du Kominterm.) Mais les débats sont souvent empreints de confusion et
d’ambiguïté, alliances et retournements d’alliances se succédant dans une lutte sans merci pour le
pouvoir : la troïka Staline – Zinoviev – Kamenev contre Trotski en 1924 – 1925 ; la rupture de 1925,
Staline écartant les adversaires de la NEP regroupés en 1926 – 1927 en une « Opposition unifiée »
(avec Trotski, Zinoviev et Kamenev, et l’ « Opposition ouvrière » de Chliapnikov), qui s’effondre fin
1927 ; le revirement de 1928, par lequel Staline abandonne l’alliance avec la paysannerie, engageant le
pays sur la voie de l’industrialisation accélérée, de la planification et de la collectivisation, avant
d’éliminer, en 1929, l’ « opposition de droite » attachée à la défense de la NEP, avec Boukharine, Rykov
et Tomski. Staline se pose dès lors en maître du parti et lance le pays tout entier dans l’épreuve d’une
nouvelle bataille.
La mise en œuvre du premier plan quinquennal – officiellement lancé le 1er octobre 1928- marque un
tournant décisif dans l’histoire de l’URSS. La priorité est donnée à l’industrialisation et, en particulier, à
une industrie lourde guidée par d’ambitieux objectifs. Cette mutation exige un gigantesque effort, une
main d’œuvre nombreuse dont il faut améliorer la qualification, des techniciens compétents, parfois le
recours à l’expérience étrangère. Les énergies sont mobilisées par une véritable « mystique du plan »,
mais aussi par des stimulants matériels et par un système de contraintes qui pèse de plus en plus lourd
sur l’ouvrier soviétique. Au début de 1933, on proclame le premier plan accompli avec 9 mois d’avance,
et des résultats exceptionnels dans l’industrie lourde, qui augmente sa production de 273%. Mais
nombre d’objectifs ne sont pas atteints, tandis qu’apparaissent des difficultés liées à la rigidité de la
planification. Dans les campagnes, on avait d’abord envisagé une mise en œuvre progressive de la
collectivisation. A la fin de 1929, le rythme s’accélère, la généralisation des kolkhozes est à l’ordre du
jour en même temps que le parti décrète la « liquidation des koulaks en tant que classe. » Dès lors, la
collectivisation est menée par la contrainte et le plus souvent par la terreur. A l’issue du premier plan, le
régime recense 210 000 kolkhozes (70% des terres cultivées), 4 300 sovkhozes (10% des terres
cultivées) et 2 400 stations de machines et de tracteurs. Le bilan de l’opération est catastrophique, avec
un recul général de la production et le repli sur elle-même d’une paysannerie violentée. La vie politique
est, elle aussi, engagée dans la bataille pour le plan : le parti semble se forger une nouvelle unité, avec
la mise à l’écart ou le ralliement des opposants et les purges qui frappent les « mauvais communistes. »
La responsabilité des échecs est rapidement imputée aux saboteurs de l’économie nationale, dont les
procès se succèdent jusqu’en 1933. En 1934 cependant, après le douzième congrès, une relative
détente semble se dessiner, en même temps que l’URSS confirme par son admission à la SDN son
retour dans le concert des nations.

5
La révolution devant le tribunal.
Après l’assassinat de Kirov, sans doute à l’investigation de Staline, le premier décembre 1934 à
Leningrad, s’ouvre une période de répression et de terreur, dont l’ampleur et la brutalité marqueront pour
longtemps l’ensemble de la société soviétique. L’aspect le plus spectaculaire en est la série de trois
procès qui, de 1936 à 1938, mènent à l’élimination des représentants les plus en vue de la vieille garde
bolchevik. Les aveux arrachés aux accusés les accablent des crimes les plus divers et souvent les plus
invraisemblables – complots contre les dirigeants, relations avec Trotski, trahison au profit de
l’Allemagne ou du Japon, sabotage de l’industrie et de l’agriculture- en même temps qu’une série de
procès secrets fait disparaître, en 1937, les hauts responsables de l’Armée rouge. A tous les niveaux, le
parti est frappé par de grandes purges, éliminant ceux qui se sont, à un moment ou à un autre, opposés
à la politique stalinienne, facilitant la promotion d’hommes nouveaux dont l’avenir reste cependant
incertain, dans un climat de peur où la méfiance, le calcul ou la fidélité aveugle font taire les désarrois.
Au-delà du parti, l’ensemble de la société soviétique est touché par cette pédagogie infernale au cours
de laquelle une propagande soigneusement calculée désigne les responsables de tous les échecs :
paysans, ingénieurs, écrivains. Tous peuvent être pris dans le tourbillon d’arrestations et de procès
expéditifs qui mènent à la mort ou peuplent les camps de travail d’une main d’œuvre exploitée sans
retenue.
En même temps que cette pratique de la terreur quotidienne renforce le pouvoir stalinien, la Constitution
de 1936 vient donner à l’État soviétique – « État socialiste » de type nouveau – une façade
démocratique. Sont affirmés le rôle dirigeant du parti et le choix d’une économie planifiée. Les deuxième
et troisième plans reprennent, pour l’essentiel, les objectifs et les méthodes du premier, poursuivent
l’industrialisation et achèvent la collectivisation des campagnes. Forte de succès économiques
hautement revendiqués, l’URSS prétend désormais jouer un rôle international : cherchant des alliés
contre la menace nazie en Europe et les agressions japonaises en Asie, elle fait adopter par le
Kominterm, en 1935, la tactique du « front commun » des partis de gauche contre la montée du
fascisme.
La seconde guerre mondiale.
Après la signature en septembre 1938 des accords de Munich, Staline rompt avec la politique de
sécurité collective de son ministre des affaires étrangères Litvinov : il le remplace en mai 1939 par
Molotov et fait conclure, le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique. Ce traité de « non-agression »
est complété par un protocole secret sur le partage des zones d’influence en Europe orientale, qui
permet à l’URSS d’annexer dans les mois qui suivent la Pologne orientale, la Carélie, les États baltes, la
Bessarabie et la Bucovine du Nord. Malgré le répit accordé par le pacte, l’effort de réorganisation d’une
armée décimée par les purges et le renforcement du potentiel militaire soviétique ne peuvent remédier à
l’impréparation criante du pays, envahi le 22 juin 1941 par des forces allemandes très supérieures en
détermination et en matériel. Cette offensive éclair mène en quelques mois l’ennemi aux portes de
Leningrad et de Moscou, et au-delà de Kiev. Pourtant, l’offensive marque une première pause avant de
reprendre en 1942 vers le Caucase et la Volga. Malgré ses difficultés, le pouvoir soviétique cherche à
mobiliser toutes les ressources spirituelles, humaines et matérielles dans un grand élan d’union
nationale dirigé par Staline, commandant suprême et bientôt maréchal. L’attaque allemande sort l’URSS
de son isolement international ; l’aide anglo-saxonne se traduit par des livraisons d’armes et de matériel,
les Soviétiques attendant en outre avec impatience l’ouverture d’un second front européen. De
novembre 1942 au début de février 1943, la bataille de Stalingrad marque la fin de la progression
allemande. L’Armée rouge reprend l’initiative, occupe l’Europe orientale et centrale jusqu’à la prise de
Berlin, qui est suivie de la capitulation allemande en mai 1945. Sûre de sa force, l’URSS discute
désormais avec les Alliés des conditions de la paix et de la reconstruction de l’après-guerre. Mais déjà
se dessinent les divisions de l’Europe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%