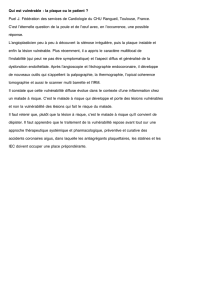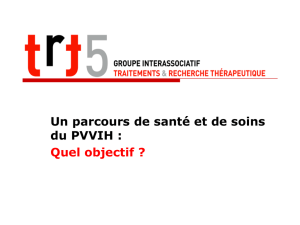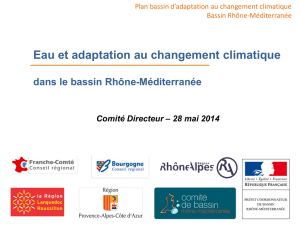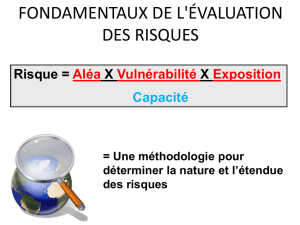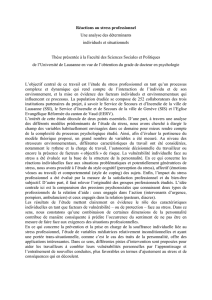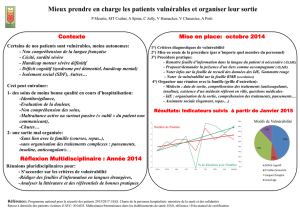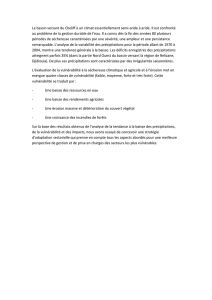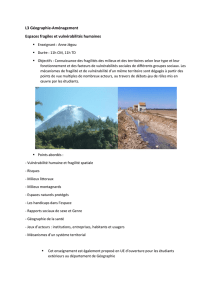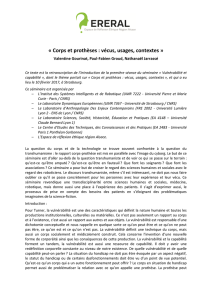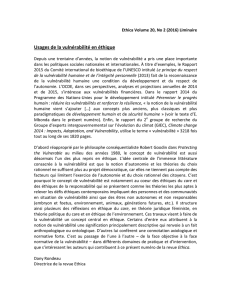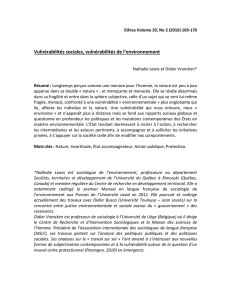Vulnérabilité, souffrance et développement humainement durable

1
Vulnérabilité au sein du développement humainement durable.
En hommage au professeur André Nicolaï
1
François-Régis MAHIEU
IRD-UMI « Résiliences » /CEMOTEV
25/11/2011
Résumé : Le développement humain est non durable s’il accroît la vulnérabilité et la
souffrance des personnes. Ce processus peut être fatal ou donner lieu à une réaction, un
rebond ; pour analyser cette résilience, une optique anthropologique est alors nécessaire,
fondée sur la personne dans tous ses aspects, conscients et inconscients.
Introduction : la vulnérabilité
2
survient au devant de la scène internationale
3
avec les
« témoignages ultimes » et les manifestations massives des « indignés ». Ce concept de
vulnérabilité est très polysémique. La vulnérabilité est au même titre que la résilience un
« concept aux mille visages ». La vulnérabilité d’une personne peut provenir de nombreux
évènements ayant trait à l’identité, la dignité, la maladie, la souffrance, le chômage, la
pauvreté etc….La vulnérabilité est-elle fatale ? Tel est le cas dans le réalisme social avec les
exemples célèbres de Gervaise Macquart (Emile Zola) ou de Jesus Sanchez (Oscar Lewis).
Leur vulnérabilité est liée à leurs responsabilités et accroit leur souffrance. Cette souffrance
qui implique la psychologie de la personne, aggrave sa vulnérabilité. Malgré ce fatalisme (Ch.
Dejours, 2009), une résilience (B.Cyrulnik,1999) est plausible dans certaines circonstances,
en intégrant en économie les concepts de la psychanalyse. Dés lors, on peut considérer la
personne, compte tenu de sa construction comme fragile, souffrante (première partie) et
capable de résilience (seconde partie), en intégrant le calcul de l’inconscient ( troisième
partie).
1
André Nicolaï-Kiel (1931-2011) a été professeur d’économie aux universités de Lille et Paris X-
Nanterre. Il a été à la tête du département d’économie de l’ORSTOM dans les années 1960 et a orienté des
jeunes chercheurs vers l’anthropologie économique.
2
Initialement, la vulnérabilité a été employée en philosophie , synonyme de la fragilité (Ricoeur). En
économie sociale elle permet une vision dynamique de la pauvreté et de l’employabilité. Sophie Rousseau
(C3ED) a étendu le concept à d’autres domaines et a utilisé la capabilité
3
Pour reprendre le mot de Baudrillard, elle est « ob-scène ».

2
-I- La vulnérabilité de la personne
Le sujet de l’économie : la personne existe en tant qu’elle est capable de s’imputer une
responsabilité ( Lévinas,1983 ; Jonas,1979, Ricoeur, 1995) . La responsabilité n’est pas
bonne en soi et peut aggraver la vulnérabilité. Cette vulnérabilité partielle pose des problèmes
d’évaluation que ce soit dans un cadre probabiliste ou autre, notamment dans l’accès à des
monde possibles.
-11 La vulnérabilité liée à la responsabilité .
Les choix macro-économiques actuels centrés sur les agrégats ignorent les conséquences
micro (individus), ou plutôt anthropologiques (personnes) ; aucune imputation sur le bonheur
ou plutôt les souffrances à venir. Ces choix se traduiront par une plus grande vulnérabilité des
personnes concernées…. Vulnérabilité c'est-à-dire affaiblissement des capacités de la
personne, en particulier la capacité à s’imputer une responsabilité. Et ses conséquences sur la
dignité et l’estime de soi, en particulier la montée des souffrances, en grande partie
mentales.
Une structure de capacités constitue la personne au sens de Ricoeur : capacité à parler, à se
désigner, à savoir le pouvoir faire (agency), à l’identité narrative, à s’imputer, à l’estime et au
respect de soi et à évaluer ses actions en termes de bon et obligatoire.
- La fragilité de la personne face à une responsabilité disproportionnée : faillibilité et
« fautivité».
Dans une conception humaine de l’économie, les sujets sont chargés de responsabilité et donc
vulnérables et faillibles ; la « disproportion » des responsabilités les rend vulnérables et peut
les amener à l’erreur. En effet, la responsabilité comme l’altruisme n’est pas bonne en soi.
Elle peut s’avérer malveillante et criminelle. A l’hédonisme égoïste, répond une conception
plus large des valeurs, au nom d’une conception positive de l’éthique. En définitive le
radicalisme économique considère les individus comme des objets, contrairement à
l’anthropologie économique qui les prend comme des sujets responsables de leur destin.
L’individu comme objet n’est pas libre, il obéit à ses instincts et à des lois fatales. La
personne autonome, capable d’être responsable, assume ses choix et ses contraintes, prouvant
par là même sa liberté.
-I- La vulnérabilité de la personne
Le sujet de l’économie : la personne existe en tant qu’elle est capable de s’imputer une
responsabilité ( Lévinas,1983 ; Jonas,1979, Ricoeur, 1995) . La responsabilité n’est pas
bonne en soi et peut aggraver la vulnérabilité. Cette vulnérabilité partielle pose des problèmes
d’évaluation que ce soit dans un cadre probabiliste ou autre, notamment dans l’accès à des
monde possibles.

3
-11 La vulnérabilité liée à la responsabilité .
Les choix macro-économiques actuels centrés sur les agrégats ignorent les conséquences
micro (individus), ou plutôt anthropologiques (personnes) ; aucune imputation sur le bonheur
ou plutôt les souffrances à venir. Ces choix se traduiront par une plus grande vulnérabilité des
personnes concernées…. Vulnérabilités c'est-à-dire affaiblissement des capacités de la
personne, en particulier la capacité à s’imputer une responsabilité. Et ses conséquences sur la
dignité et l’estime de soi, en particulier la montée des souffrances, en grande partie
mentales.
Une structure de capacités constitue la personne au sens de Ricoeur : capacité à parler, à se
désigner, à savoir le pouvoir faire (agency), à l’identité narrative, à s’imputer, à l’estime et au
respect de soi et à évaluer ses actions en termes de bon et obligatoire.
- La fragilité de la personne face à une responsabilité disproportionnée : faillibilité et
« fautivité».
Dans une conception humaine de l’économie, les sujets sont chargés de responsabilité et donc
vulnérables et faillibles ; la « disproportion » des responsabilités les rend vulnérables et peut
les amener à l’erreur. En effet, la responsabilité comme l’altruisme n’est pas bonne en soi.
Elle peut s’avérer malveillante et criminelle. A l’hédonisme égoïste, répond une conception
plus large des valeurs, au nom d’une conception positive de l’éthique. En définitive le
radicalisme économique considère les individus comme des objets, contrairement à
l’anthropologie économique qui les prend comme des sujets responsables de leur destin.
L’individu comme objet n’est pas libre, il obéit à ses instincts et à des lois fatales. La
personne autonome, capable d’être responsable, assume ses choix et ses contraintes, prouvant
par là même sa liberté.
-2- Comment évaluer l’occurrence d’une vulnérabilité ?
La vulnérabilité exprime de nombreuses modalités dont la probabilité n’est qu’une
composante. Elle peut être traitée de façon axiomatique comme une fonction et de façon
sémantique par les mondes possibles.
-121- Le débat sur les probabilités et l’induction
Ici réside toute la difficulté de la logique inductive utilisée en macroéconomie et le «désarroi
» de l'économétrie que Hicks (1979) illustre en revenant sur le vieux débat entre probabilité
objective (ou fréquentielle) et probabilité subjective. Selon lui, la probabilité objective, basée
sur le cercle vicieux probabilité/hasard (l'un est défini par l'autre), est trop étroite pour
l'économiste ; celui-ci a intérêt à une appréciation subjective des probabilités, conception plus
proche des idées exprimées par Keynes dans son Treatise on Probability (1921) et par Jeffrey
au long de sa Theory of probability (1939). Cependant, Hicks se demande si une appréciation
subjective des probabilités est possible. Pour ce faire, il commence par mettre en doute le pre-
mier axiome de Jeffrey (compte tenu d'une information donnée, soit un événement est plus

4
probable qu'un autre, soit les deux, soit équiprobables) en soulignant qu'il existe une « zone
grise » où les probabilités des deux événements sont incomparables.
La vulnérabilité ne saurait se contenter des probabilités et peut très bien se traduire par
d’autres contextes, par exemple le plausible, le possible, l’incertain, la catastrophe. Cependant
la démarche probabiliste est centrale en économie : induire les conséquences probables
d’évènements constatés est la capacité essentielle de l’économiste. Il n’y a donc rien de
surprenant à ce que la conception probabiliste de la vulnérabilité soit largement majoritaire
chez les économistes. Le type de probabilités utilisé est supposé définir la rationalité
(Suppes,1981) ; sinon hiérarchiser les individus en fonction du type de probabilité qu’ils sont
censés pratiquer. La probabilité n’est cependant pas un instrument fiable face aux situations et
a connu de la part de G. Shackle (1945) et J. Hicks (1979) des critiques du même ordre que le
théorème d’impossibilité dans le domaine du choix social. Les travaux de Kahneman et
Tversky (1979), critiquent radicalement la valeur explicative des probabilités dans le calcul
économique et financier. En situation d’incertitude, les épargnants surestiment les déviations
par rapport à leurs objectifs plus que la perspective de gains plus importants.
Ces critiques sont oubliées le plus souvent dans les nouvelles applications de la randomisation
et de la vulnérabilité probabilisable.
-Les modalités : plausible, possible, incertain…La probabilité n’est qu’une modalité parmi les
autres, limitée par le paradoxe des zones grises ( Hicks, 1981) et l’imbrication des modalités.
La tentation habituelle est d’écrire que » la vulnérabilité a trait « aux chocs économiques, aux
catastrophes naturelles, à la mauvaise santé, à l’invalidité et à la violence physique » (BM,
2001). Ainsi la vulnérabilité d’une personne résulterait par sommation de ses différentes
vulnérabilités (santé, revenu, intégrité etc….). Mais ceci pose des problèmes de comparaison
entre situations : paradoxe des zones grise de Hicks (annexe 1). Une sommation de
probabilités n’a pas de sens si elles sont incomparables. On peut distinguer au moins trois
zones, A (probabilisable numériquement), B (probabilisable qualitativement) et C (non
probabilisable), la vulnérabilité étant représentée par l’ellipse en noir dans la Figure 2 .
Figure 2. Vulnérabilité et probabilités

5
Vulnérabilité et catastrophe
De quel choc s’agit-il ? Un petit choc peut avoir de grands effets, d’où l’idée de populations
vulnérables parce qu’un petit choc peut entraîner les pires catastrophes ; d’où les réserves sur
une politique « prudentielle » dont les conséquences peuvent être extrêmes compte tenu de la
précarité où se trouvent les intéressés. La panique migratoire est de ce type, en tant que VAR
(variable auto- entretenue).
La vulnérabilité parce qu’elle se situe dans le temps, oblige à rentrer dans les modalités
aléthiques (possible et nécessaire), épistémiques (absolument, généralement,
conventionnellement, spécialement) et surtout temporelles (temporellement, perpétuellement),
le plus souvent combinées, domaine d’excellence de la pensée arabe (Rescher, 1974),
notamment Al Qāzvīnī et Shirwānī, au 13° et 15° siècles.
Ainsi une vulnérabilité peut être possible, générale, actuelle, absolue, temporelle, etc… ;
chacune de ces modalités pouvant elles-mêmes être décomposées en plusieurs modalités. Elle
peut surtout connaître une incertitude radicale,non probabilisable, non mesurable, non
soumise à la loi des grands nombres.
-122- La vulnérabilité ou fragilité de la personne peut être traitée à trois niveaux :
axiomatique (grammaire), sémantique (modalités et mondes possibles), pragmatique (quelle
appréhension statistique, quelles politiques ?).
Vulnérabilité = une fonction exprimant la fragilité. Cette faiblesse peut être partielle ou totale
pour une personne dite « totale ».
Viα = vulnérabilité partielle par rapport à un événement selon des modalités : ontiques,
temporelles (cycle), aléthiques (possible), épistémiques (croyances ou non), déontiques
A
B
C
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%