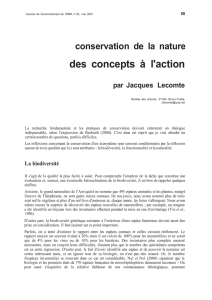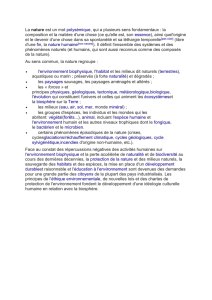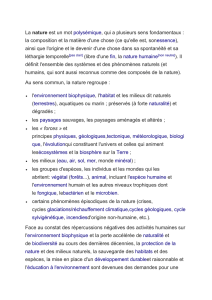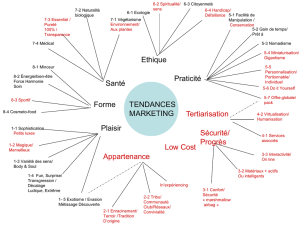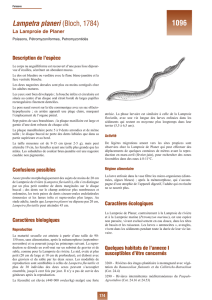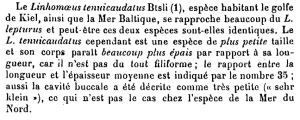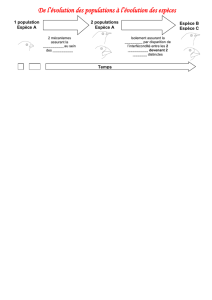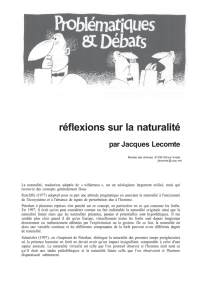des concepts à l`action

Dossier de l’environnement de l’INRA n°27 59
conservation de la nature
des concepts à l’action
Jacques Lecomte
article repris du Courrier de l’environnement de l’INRA n°43, mai 2001
La recherche fondamentale et les pratiques de conservation doivent entretenir un dialogue
indispensable, selon l’expression de Barbault (2000). C’est dans cet esprit que je vais aborder un
certain nombre de questions, parfois difficiles.
Les réflexions concernant la conservation d’un écosystème sont souvent conditionnées par la réflexion
autour de trois qualités qui lui sont attribuées : la biodiversité, la fonctionnalité et la naturalité.
La biodiversité
Il s’agit de la qualité la plus facile à saisir. Pour comprendre l’ampleur de la tâche que constitue une
évaluation et, surtout, une éventuelle hiérarchisation de la biodiversité, il est bon de rappeler quelques
chiffres.
Aristote, le grand naturaliste de l’Antiquité, ne nomme que 495 espèces animales et les plantes, malgré
l’œuvre de Théophraste, ne sont guère mieux connues. De nos jours, nous avons nommé plus de trois
cent mille végétaux et plus d’un million d’animaux et, chaque année, les listes s’allongent. Nous avons
même encore la surprise de découvrir des espèces nouvelles de mammifères ; par exemple, un rongeur
a été identifié en Guyane lors des inventaires effectués pendant la mise en eau d’un barrage (Vié et al.,
1996).
D’autre part, la biodiversité génétique existante à l’intérieur d’une espèce linnéenne devrait aussi être
prise en considération. Il faut insister sur ce point important.
Parfois, on a tenté d’estimer le rapport entre les espèces connues et celles existant réellement. Le
rapport moyen est souvent évalué à 20% mais il est voisin de 100% pour les mammifères et ne serait
que de 4% pour les virus ou de 10% pour les bactéries. Des inventaires plus complets seraient
nécessaires, mais on conçoit leurs difficultés, d’autant plus que le nombre des spécialistes compétents
est en nette régression. D’autre part, le fait d’avoir identifié une espèce et de pouvoir la nommer est
certes intéressant mais, si on ignore tout de sa biologie, on n’est pas très avancé. Or, le nombre
d’espèces inventoriées se trouvant dans ce cas est considérable. Nel et Nel (2000) signalent que la
biologie et les premiers états de 770 espèces françaises de microlépidoptères demeurent inconnus ! On
peut aussi s’inquiéter de la relative faiblesse de nos connaissances éthologiques, pourtant
indispensables pour concevoir un plan de conservation. Doit-on ajouter que les inventaires et les

60 Johannesbourg
données biologiques ne doivent pas concerner uniquement les espèces animales ou végétales les plus
populaires, ou intéressant un plus grand nombre de systématiciens ?
On constate, en France, que les programmes basés sur des espèces telles que le chamois, le bouquetin,
les aigles ou le grand tétras sont souvent privilégiés par les gestionnaires. Pour expliquer ces choix, il
ne faut pas oublier que la conservation de la nature intéresse certes des scientifiques mais aussi des
militants et que ces deux populations se recoupent en partie. Pour des militants, il est sans doute
important de disposer d’adversaires bien définis et le fait de défendre des espèces emblématiques, qui
ont souvent le statut de gibier, n’est pas sans importance. Il est certain que la défense des collemboles
apporte moins de plaisirs polémiques que celle du chamois. Il ne faudrait pas pour autant que la
défense légitime de ce dernier nous détourne d’autres problèmes au moins aussi importants, sinon
plus.
Il faut donc reconnaître que, souvent, l’aspect médiatique, voire politique, l’emporte sur l’aspect
scientifique et que les conditions d’une conservation à long terme ne sont peut-être pas toujours
remplies. C’est aussi la voie ouverte vers le parc de vision clos qui a peu de choses à voir avec la
conservation de la nature. Conscients de cet inconvénient notable mais aussi de l’intérêt promotionnel
des espèces emblématiques, certains ont alors commencé à parler d’espèces-parapluie dont la
protection garantirait celle de leurs écosystèmes en entier.
On peut ainsi citer le Saumon atlantique dont on assure que la protection est certainement bénéfique
non seulement au milieu, mais aussi à la quasi-totalité des espèces qui s’y rencontrent. La chose est
vraisemblable en ce qui concerne les frayères mais plus contestable le long des trajets de migration
pour lesquels les exigences du Saumon atlantique sont réduites. En général, d’ailleurs, il est
déconseillé d’utiliser des espèces migratrices dans ce rôle bien qu’à mon avis, leurs zones de
reproduction puissent être prises en compte. On constate aussi qu’en faisant ce choix, on se dispense
d’étudier les divers éléments de l’écosystème, ce qui ne peut pas être considéré comme une bonne
option, malgré la valeur propre de l’idée.
Souvent aussi, on se base pour évaluer la valeur écologique d’un milieu sur la présence d’espèces
répertoriées sur des listes nationales, européennes ou internationales d’animaux ou de végétaux
protégés, rares ou menacés. Sans nier l’importance de ces listes qui permettent de prendre des mesures
administratives de protection, en particulier des arrêtés de biotope, il faut reconnaître que leur valeur
scientifique n’est pas toujours évidente. En particulier, bien des taxons n’y figurent pas ou sont très
mal représentés. En la matière, on ne peut comparer la pression exercée par les ornithologues ou les
spécialistes des orchidées avec celle des mycologues ou des microbiologistes.
Une autre pression aboutit à la désignation d’espèces dites confidentielles parce qu’on craint que les
indications concernant leur présence ne soient utilisées par différents pillards. Cette précaution
présente sans doute plus d’inconvénients que d’avantages. De plus, on peut faire remarquer que la
disparition d’une espèce rare, certes très regrettable, n’affecte qu’elle-même alors que les espèces dites
« clé de voûte » peuvent, par leur présence ou leur absence, influencer l’ensemble de l’écosystème.
Assez curieusement, en France du moins, il semble que celles-ci ne soient pas prises en compte en tant
qu’espèces dont la conservation est essentielle. Il est vrai que, depuis la définition donnée par Paine,
en 1969, de nombreuses discussions ont eu lieu au sujet de ce concept. Il faut admettre que la notion
d’espèces jouant à elles seules un rôle déterminant doit être examinée avec quelques précautions.
Par exemple, souvent, dans un écosystème donné les espèces clé de voûte sont redondantes et
nombreuses. C’est plus une guilde qu’une espèce que nous devons considérer. C’est pourquoi Brown
et Heske, en 1990, ont parlé de guilde clé de voûte au sujet du rôle des rongeurs en milieu désertique.
D’autre part, la même espèce peut jouer un rôle important dans un écosystème et insignifiant dans un
autre.

Dossier de l’environnement de l’INRA n°27 61

62 Johannesbourg
Pourtant, en particulier au niveau des guildes, on peut trouver des exemples indéniables d’acteurs
essentiels au fonctionnement des systèmes. On peut ainsi citer les pollinisateurs, les coprophages, les
grands herbivores, les ressources trophiques de consommateurs spécialisés. Au niveau spécifique, on
peut mentionner le castor ou certains termites africains. Mais, parler de guilde au sujet des
pollinisateurs est peut-être outré car on va y trouver des chauve-souris, des oiseaux, des insectes et des
adaptations réciproques entre l’animal et la plante qui sont d’une très grande diversité.
On pourrait aussi s’étonner avec Barbault (1995) qu’on ne classe pas l’homme parmi les espèces clé
de voûte. L’humanité a indiscutablement joué ce rôle mais nous sommes certainement maintenant à
classer « hors catégorie ». Pourtant, au risque d’étonner, je pense, qu’en l’absence irrémédiable de
grands prédateurs, une chasse encadrée et disciplinée pourrait constituer une clé de voûte acceptable. Il
s’agit en effet de reconstituer une fonction manquante.
Avec, encore une fois, Barbault (1995), on peut conclure que « sans constituer une clé miraculeuse
mais loin d’être une impasse, le concept d’espèce clé de voûte conduit finalement à d’intéressantes
perspectives... »
On pourrait encore citer la prise en compte des « espèces indicatrices » qui ont fait couler beaucoup
d’encre et séduisent encore les gestionnaires d’espaces protégés. Il est évident que des espèces peuvent
indiquer dans quel type de milieu on se trouve. Parfois, cette démarche comporte une certaine part de
naïveté (par exemple, quand on vous annonce que l’analyse d’un peuplement de Coléoptères indique
l’existence d’une hêtraie alors qu’on se trouve entouré de hêtres !) mais les botanistes ont fait grand
usage de ces indicateurs, avec profit.
En ce qui concerne les indicateurs de qualité, ils ne paraissent pas toujours convaincants. Certes, ils
ont été souvent utilisés pour apprécier la qualité des cours d’eaux mais, dans ce cas - qui mérite
d’ailleurs quelques réserves - il s’agit d’un groupe d’espèces et non d’un indicateur unique.
Il faut sans doute aussi parler des espèces endémiques, celles dont la distribution spatiale est
remarquable par ses petites dimensions. L’existence de ces espèces endémiques est liée à l’isolement.
Au passage, relevons le paradoxe qui nous conduit, d’une part, à lutter, sans doute avec raison, contre
la fragmentation et, d’autre part, à attribuer une grande valeur aux endémiques.
Bien entendu, les îles possèdent souvent un grand nombre de ces espèces. Par exemple, Simon (1987)
estime que 90 à 99% des espèces terrestres, animales et végétales des îles Hawaï sont dans ce cas.
Cependant, on trouve aussi des endémiques dans des milieux continentaux. La faune des Lépidoptères
de la péninsule ibérique en est un bon exemple.
Enfin, sur un autre plan, il faut considérer que la distribution d’un endémique est souvent située à
l’intérieur de frontières politiques, ce qui engage fortement la responsabilité de l’État souverain. Dans
le cas de notre pays, on peut citer, en restant parmi les oiseaux : la sittelle de Corse, l’échenilleur de la
Réunion ou le pic de Guadeloupe, sans parler de la Guyane.
Pour conclure ce rapide tour d’horizon, nous pouvons dire qu’aucun moyen proposé pour hiérarchiser
les espèces en vue d’une conservation prioritaire n’est entièrement satisfaisant. Le meilleur moyen de
sauvegarder l’intérêt de cette approche, qui a le mérite d’être lisible, consiste sans doute à croiser les
différentes échelles de valeur disponibles tout en évitant de laisser croire que nous disposons du
meilleur des outils imaginables.
Dépasser le stade de l’intérêt porté à une espèce individuelle paraît indispensable, d’où la nécessité
d’un accroissement de nos connaissances sur les fonctions exercées par les constituants de
l’écosystème.
Cependant, tout en considérant que l’approche par espèce conserve un certain intérêt, nous sommes
bien obligés de nous pencher sur la question de la conservation des espaces. D’autant que l’on ne peut

Dossier de l’environnement de l’INRA n°27 63
considérer la conservation d’une population viable sur le long terme sans raisonner à l’échelle de la
superficie minimale nécessaire.
Ici encore, les difficultés ne manquent pas. Sur le plan législatif, la France a disposé pendant
longtemps d’un ensemble de possibilités concernant souvent des surfaces relativement restreintes et
souvent partiellement protégées. On pratique la chasse, dans des conditions ordinaires, dans plus de
vingt pour cent des réserves naturelles !
Ces zones protégées possèdent toutes un certain intérêt, mais souvent leur choix est dû à des
opportunités plus qu’à une planification.
Pourtant, à la suite de la rencontre avec la théorie de la biogéographie insulaire de MacArthur et
Wilson (1967), de nombreux spécialistes de la conservation ont pensé pouvoir tirer des enseignements
destinés à permettre la création de nouvelles réserves sur des bases scientifiques indiscutables. Cette
théorie, vérifiée en grande partie par des observations et des expérimentations, n’a pas à être exposée
ici dans les détails. Qu’il soit seulement rappelé, d’une manière un peu caricaturale, que le rapport
entre les dimensions des îles et aussi leurs distances au continent est en relation avec le nombre des
espèces qu’elles abritent. D’autre part, chaque espèce a une durée d’existence limitée et peut ainsi
céder sa place à une nouvelle arrivée. La première démarche intellectuelle a été de considérer que les
habitats terrestres isolés les uns des autres étaient l’équivalent des îles océaniques et évoluaient selon
les mêmes règles. On espérait ainsi répondre à d’importantes questions. Par exemple, doit-on préférer,
à superficies totales égales, une grande réserve ou plusieurs petites ?
Outre quelques faiblesses dans la théorie elle-même, on peut observer une erreur importante
d’appréciation. On ne peut, en effet, comparer la situation de la faune et de la flore terrestre d’une île
océanique, entourée par un milieu parfaitement hostile et souvent difficile à traverser, avec celle
rencontrée dans un habitat terrestre, quelle que soit son originalité. Même si nous prenons l’exemple,
souvent cité, d’un étang sans exutoire, nous constatons que les odonates peuvent aller chasser très loin
et que, si beaucoup de batraciens s’y reproduisent, leurs vies d’adulte se déroulent dans d’autres
habitats. C’est pourquoi la colonisation d’une mare nouvellement creusée est assez rapide. Laan et
Verboom (1986) ont montré qu’une nouvelle mare était colonisée dans les trois ans par le crapaud
accoucheur, à condition de se trouver à moins de 500 m d’une mare plus ancienne abritant cette
espèce.
Il faut cependant reconnaître que ce nouvel effort de réflexion sur les bases du choix d’une réserve
naturelle a produit d’autres fruits : prise en compte du nombre de reproducteurs nécessaires pour une
survie à long terme, réflexion sur les dangers de la fragmentation, intérêts des corridors, etc. Nous
reprendrons l’examen de certains de ces points quand nous étudierons le détail des mesures proposées
pour conserver la nature.
À côté, mais non à l’opposé, de la stratégie de création d’espaces à protections fortes mais de
superficies relativement réduites, nous assistons à la mise en place d’une stratégie bien différente.
Depuis la parution, en 1992, d’une directive européenne connue sous le nom de « directive habitat »,
nous disposons, en effet, d’une stratégie destinée à créer un réseau écologique cohérent dénommé
« Natura 2000 ».
Un habitat est défini comme comprenant les espèces animales ayant tout ou partie de leur niche
écologique, c’est-à-dire essentiellement l’espace trophique et le lieu de reproduction, dans l’espace
considéré ainsi que la végétation particulière et différents paramètres abiotiques. Ces habitats
correspondent aux biotopes décrits dans le manuel européen Corine biotop, dans lequel la végétation
est considérée comme l’identifiant principal. Cette classification n’est pas sans défaut et doit faire
l’objet de certaines adaptations. En France, on connaît des tentatives intéressantes et appropriées à
notre situation. On peut, pour les milieux forestiers et associés, consulter le référentiel publié par
Rameau (1997).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%