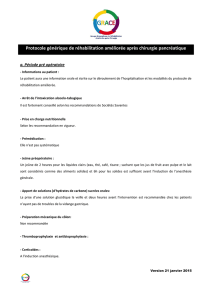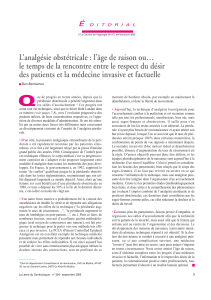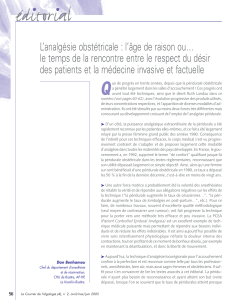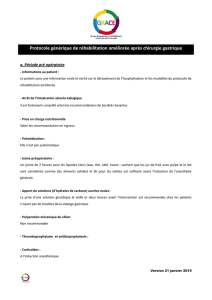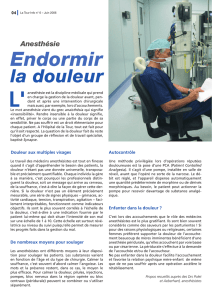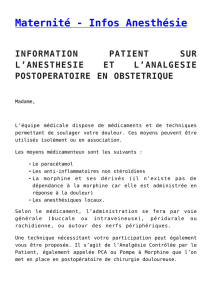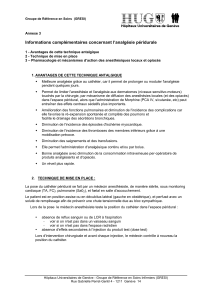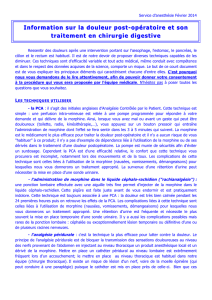votre patiente va avoir une peridurale pour son

SESSION POUR LES GENERALISTES 805
VOTRE PATIENTE VA AVOIR UNE PERIDURALE
POUR SON ACCOUCHEMENT
F-J. Mercier, Département d’Anesthésie-Réanimation de Bicêtre, Hôpital Antoine
Béclère, 157 rue de la Porte de Trivaux , 92141 Clamart.
INTRODUCTION
L’objectif premier des parturientes qui demandent à bénéficier d’une analgésie pé-
ridurale est bien sûr le soulagement de la douleur due au travail et à l’accouchement. En
revanche, rares sont les parturientes qui envisagent d’autres bénéfices pour elles-
mêmes ou pour leur futur enfant. C’est à l’inverse la crainte d’effets adverses materno-
fœtals qui les fait parfois renoncer à cette méthode d’analgésie. Une information adéquate
nécessite donc de préciser aussi ces autres avantages de la péridurale qui peuvent
parfois être déterminants.
1. DOULEUR LORS DU TRAVAIL ET DE L’ACCOUCHEMENT
Malgré l’existence d’une augmentation physiologique des seuils douloureux en fin
de grossesse, le travail et l’accouchement provoquent une douleur aiguë intense pour
2/3 des parturientes. Melzack [1] dans son échelle d’intensité de la douleur situe
l’accouchement certes au-dessous de la douleur d’une amputation digitale mais en
moyenne bien au-dessus de celle d’une fracture. Ces données qui pourraient paraître
excessives ont été globalement confirmées récemment auprès de 1 091 parturientes [2].
Une analgésie puissante au cours du travail est donc souvent nécessaire et constitue une
exigence maternelle légitime. L’intensité douloureuse reste en effet principalement
influencée par la primiparité, l’utilisation d’oxytocine, et surtout par le stade du travail,
même s’il ne faut pas nier l’existence de facteurs psychogènes ou socioculturels. Les
scores douloureux augmentent significativement lors de la rupture de la poche des eaux
et après 5 cm de dilatation cervicale pour atteindre un maximum au moment de l’expul-
sion. Au cours de la première phase du travail, c’est la dilatation du col et la distension
du segment inférieur utérin pendant les contractions qui génèrent les sensations
douloureuses. Cette douleur irradie dans les dermatomes thoraciques T11 et T12, puis
s’étend progressivement aux territoires sous-jacents T10 et L1. A dilatation complète,
s’ajoutent les douleurs permanentes dues à la distension des structures du petit bassin
par la présentation. Enfin, lors de l’expulsion, l’acmé douloureuse est provoquée par la
distension de la filière génitale et du périnée, via les racines sacrées myélinisées moins
sensibles aux agents anesthésiques. On voit donc que la prise en charge analgésique

MAPAR 2000806
doit s’adapter à l’évolution quantitative et qualitative des stimuli douloureux pendant
le travail et l’accouchement. Mais, il faut avant tout prendre en compte des variations
interindividuelles considérables : ainsi 10 % des parturientes ont un accouchement quasi
indolore (multipares en travail spontané) ; à l’inverse, 30 % des primipares et 10 % des
multipares ressentent des douleurs atroces et intolérables. Le jeune âge, le surpoids
maternel, la macrosomie fœtale et les présentations postérieures favorisent aussi la
survenue de douleurs intenses.
Outre son retentissement psychologique, la douleur obstétricale peut être
directement délétère pour la mère et pour le fœtus. Ainsi, le débit cardiaque maternel
déjà élevé en fin de grossesse (+ 40 %) continue d’augmenter tout au long du travail
jusqu’à l’expulsion où il atteint le double de celui observé en fin de grossesse. Ceci est
notamment la conséquence d’une stimulation sympathique majeure et explique la
mauvaise tolérance maternelle du travail en cas de cardiopathie préexistante ou
d’hypertension gravidique. Seule, l’analgésie péridurale permet de prévenir efficace-
ment cette stimulation sympathique ; elle réduit ainsi de moitié l’accrois-
sement du débit cardiaque maternel au cours du travail. La douleur induit également
une hyperventilation. Celle-ci est responsable d’une alcalose respiratoire parfois
profonde qui peut entraîner une hypoxémie maternelle par hypoventilation au décours
des contractions, une modification de la courbe de dissociation de l’hémoglobine
diminuant la délivrance d’oxygène au fœtus, et une vasoconstriction utéro-placentaire.
Ainsi, l’hyperventilation maternelle peut favoriser le développement d’une hypoxie
fœtale. Ces phénomènes liés à la douleur, habituellement sans conséquence, peuvent avoir
un retentissement important en cas de pathologie maternelle ou fœtale pré-existante.
2 . ANALGESIE PERIDURALE POUR ACCOUCHEMENT NORMAL
Une enquête nationale réalisée en 1996 [3] a permis de chiffrer à 48 % la
proportion de femmes (toutes parités confondues) bénéficiant d’une analgésie péridu-
rale au cours du travail. Ce chiffre place désormais la péridurale en tête de liste des
méthodes analgésiques utilisées en France pour l’accouchement. Il traduit l’efficacité
très supérieure de la péridurale par rapport aux autres techniques analgésiques
(Dolosal® ou autres morphiniques IV, protoxyde d’azote inhalé, bloc des nerfs
honteux). Cette supériorité est maintenant parfaitement démontrée [2, 4]. Les métho-
des de préparation psychoprophylactiques à l’accouchement ne doivent pas pour autant
être négligées : si elles ne réduisent au mieux que de 30 % l’intensité douloureuse, elles
favorisent en revanche un bien meilleur contrôle vis-à-vis de la douleur. De plus, une
bonne préparation permet d’attendre dans de bien meilleures conditions psychologi-
ques la réalisation de l’analgésie péridurale lorsqu’elle n’est pas immédiatement
disponible et elle s’avère fondamentale dans les rares cas où la péridurale ne peut être
réalisée du fait d’une contre-indication de dernière minute.
2.1. CONSULTATION D’ANESTHESIE.
La connaissance du dossier médical et obstétrical et l’information éclairée de la
parturiente sont indispensables. Elle passe donc par un interrogatoire, un examen
clinique et la lecture des résultats biologiques. L’ensemble doit s’inscrire dans le cadre
d’une consultation d’anesthésie rendue obligatoire par le décret du 9 octobre 1998 sur
la périnatalité. Elle est effectuée au mieux à distance de l’accouchement (8emois). La
consultation d’anesthésie doit concerner toutes les futures accouchées, y compris celles
qui ne souhaitent pas d’analgésie péridurale pour le travail. En effet, ces dernières
peuvent présenter une indication spécifique d’analgésie péridurale qu’elles ignorent.

SESSION POUR LES GENERALISTES 807
Elles peuvent aussi nécessiter une anesthésie urgente pour un forceps, une césarienne
ou une révision utérine inopinées. Un questionnaire d’anesthésie rempli par la future
parturiente et d’une séance collective d’information préalable facilitent l’organisation
de cette consultation individuelle (qui demeure néanmoins indispensable).
2.2. CONTRE-INDICATIONS
La liste est longue, mais l’incidence globale est assez faible. Les contre-
indications majeures sont :
• Les troubles de la coagulation non corrigés : déficits congénitaux ou acquis durant la
grossesse (thrombopénie < 80 ou 100 000, CIVD/fibrinolyse notamment lors d’un
hématome rétroplacentaire ou d’une mort fœtale in utero), héparinothérapie efficace.
• L’infection systémique ou au point de ponction, non contrôlée par le traitement.
• Le refus de la patiente malgré une information éclairée ; il faut cependant se montrer
convaincant si un bénéfice spécifique est attendu.
• L’hypovolémie non compensée ou évolutive (hémorragie active).
Les autres «contre-indications» sont plus discutables et dépendent du rapport
bénéfice/risque attendu :
• L’anticoagulation préventive (HBPM < 12-24 h notamment) est une contre-
indication le plus souvent respectée.
•
A un moindre degré la prise (même unique) d’aspirine datant de moins d’une semaine ;
l’agrégation plaquettaire est néanmoins en grande partie restaurée au-delà de 48 à 72 h.
• Certaines pathologies neurologiques et interventions sur le rachis dorso-lombaire
(analyser préalablement le dossier en incluant volontiers les spécialistes concernés).
• Le placenta praevia ; le désir d’éviter une anesthésie générale conduit souvent à
pro poser une péridurale pour la césarienne, sauf lorsque le placenta risque d’être
incisé du fait de sa localisation antérieure. Cependant, il n’y a pas d’attitude
consensuelle et l’éventualité redoutable d’un placenta accreta peut faire préférer l’anes-
thésie générale.
•
La chorioamniotite était classiquement une contre-indication mais de vastes études
l’on remise en question ; sous couvert d’une antibiothérapie préalable (et pour certains
d’une température contrôlée < 38°C) la réalisation d’une péridurale peut souvent être
acceptée s’il n’y a pas de signes avant-coureurs de défaillance circulatoire.
• Certaines pathologies cardiaques peuvent contre-indiquer la grossesse elle-même ;
dans le cas contraire, la plupart des experts s’accordent maintenant pour considérer
que la voie basse doit être la règle (en dehors des indications obstétricales habituelles
de césarienne). Une analgésie péridurale «légère» (i.e., limitée à T10 et associant un
morphinique avec un anesthésique local très dilué) n’entraînera quasiment pas
d’effet hémodynamique propre et limitera au contraire l’augmentation délétère du
débit cardiaque induit par la douleur. L’analgésie péridurale pour le travail sera donc
une indication majeure pour la prise en charge de la plupart des cardiopathes (si leur
traitement anticoagulant peut être brièvement interrompu). En revanche, l’anesthésie
péridurale dense et étendue nécessaire pour la césarienne s’avèrera beaucoup plus
délicate (car le retentissement hémodynamique est bien plus marqué), et elle sera de
ce fait assez souvent écartée au profit d’une anesthésie générale.
2.3. RAPPELS ANATOMIQUES ET TECHNIQUE DE PONCTION PERIDURALE
Les structures traversées durant la ponction comprennent d’arrière en avant
(Figure 1 et 2) :
• La peau puis l’espace sous-cutané.
• Le ligament interépineux.

MAPAR 2000808
• Le ligament jaune.
• L’espace péridural.
• Les enveloppes méningées entourant le liquide céphalorachidien et les racines
nerveuses.
L’œdème et/ou l’infiltration de l’espace sous-cutané ainsi que le ramollissement
ligamentaire sont fréquents au cours de la grossesse. Il existe de plus une hyperlordose
lombaire. Enfin, la compression cave inférieure par l’utérus gravide provoque une
élévation de la pression dans l’espace péridural. Toutes ces modifications rendent le
repérage de l’espace péridural plus difficile chez la femme enceinte.
Figure 2 : Technique de ponction péridurale par perte de résistance au sérum
physiologique
A- Seringue remplie de sérum physiologique (en grisé) ; sensation de résistance sur le trajet
de ponction durant la poussée sur le piston.
B- Perte de résistance brusque sur le piston lors de l’entrée de l’aiguille de Tuohy dans l’es-
pace péridural.
C- Introduction du cathéter dans l’espace péridural à travers l’aiguille de Tuohy (après
désadaptation de la seringue) ; l’aiguille est ensuite retirée et le cathéter est laissé en place.
Figure 1 : Anatomie de l’espace péridural lombaire
1. Peau et espace sous-cutané
2. Ligament interépineux
3. Ligament jaune
4. Espace péridural
5. Liquide céphalorachidien
6. Disque intervertébral
7. Corps vertébral

SESSION POUR LES GENERALISTES 809
La ponction péridurale est effectuée avec une aiguille de Tuohy entre deux
vertèbres lombaires au-dessous de L2, après un double badigeonnage antiseptique et
une anesthésie locale de la peau. Le choix de la position de la patiente dépend des
habitudes de l’anesthésiste. Certains préfèrent le décubitus latéral qui est parfois plus
confortable pour les parturientes (notamment lorsque la dilatation est très avancée). La
majorité des anesthésistes préfèrent cependant la position assise en obstétrique car elle
rend la ponction plus aisée et facilite ainsi un abord bien médian de l’espace péridural.
L’espace péridural est identifié entre deux contractions grâce à la technique de la perte
de résistance (Figure 1). Un cathéter est inséré de 4 à 5 cm dans l’espace péridural puis
fixé par un pansement stérile. L’injection initiale (12 à 20 mL selon la parturiente et la
solution utilisée) est effectuée de façon fractionnée pour permettre le dépistage d’une
injection intrathécale ou intravasculaire.
2.4. PRODUITS UTILISES, OBJECTIF, ET MODALITES DE SURVEILLANCE
Les principaux anesthésiques locaux actuellement à notre disposition sont la lido-
caïne (Xylocaïne®), la bupivacaïne (Marcaïne®), et la ropivacaïne (Naropéine®). La
Xylocaïne® est responsable d’un bloc moteur plus important que la Marcaïne® qui de
ce fait est devenu l’anesthésique local de référence en matière d’analgésie péridurale
pour le travail. La ropivacaïne (Naropéine®), introduite sur le marché français en 1997,
est une alternative intéressante à la Marcaïne® (voir détails au § 5).
L’objectif au cours du travail sous péridurale est d’obtenir une analgésie qui remon-
te au moins à l’ombilic (T10) et un bloc moteur minimal. La recherche de ce niveau
sensitif supérieur se fait avec un tampon alcoolisé. On peut ainsi déterminer la zone
métamérique transitionnelle en dessous de laquelle le froid n’est plus perçu et qui
correspond au niveau sensitif supérieur. L’évolution des pratiques, centrée sur la réduc-
tion du bloc moteur, conduit à l’emploi de solutions très diluées (Marcaïne® 0,12 % à
0,06 % ou Naropeine® 0,15 à 0,10 %) associé à un morphinique puissant (fentanyl ou
sufentanil).
L’efficacité de l’analgésie doit être évaluée à l’aide d’un score de douleur régulière-
ment répété au cours du travail. L’EVA (= Echelle Visuelle Analogique, nécessitant une
réglette) ou l’ENS ( = Echelle Numérique simple, de 0 à 10) sont les deux scores les
mieux adaptés. Une mesure automatique intermittente de la pression artérielle
maternelle et un enregistrement continu du rythme cardiaque fœtal doivent être
institués avant la ponction péridurale et poursuivis durant tout le travail. Un monito-
rage plus compliqué n’est indiqué qu’en relation avec une pathologie maternelle ou
fœtale. Les éventuelles réinjections et les éléments de la surveillance peuvent être
confiés à un(e) infirmier(e) anesthésiste ou à une sage-femme à condition que cette
dernière ait été formée et qu’elle accepte cette participation.
3 . INCIDENTS ET COMPLICATIONS
3.1. INSUFFISANCE D’EFFICACITE AU COURS DU TRAVAIL
Si la qualité analgésique procurée par la péridurale est bien meilleure qu’avec les
autres techniques [2, 4], l’insuffisance initiale d’analgésie est pourtant assez
fréquente (20 à 30 %). On peut schématiquement distinguer plusieurs situations :
• Le niveau sensitif supérieur d’analgésie peut être insuffisant (< T10).
• Il peut persister un ou plusieurs point(s) douloureux bas situé(s) malgré un niveau
suffisant (≥T10).
• L’analgésie peut être asymétrique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%