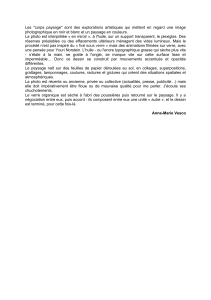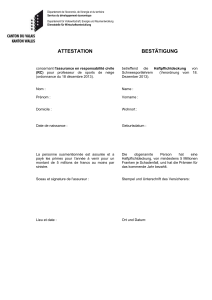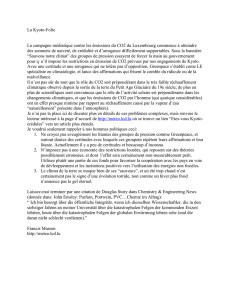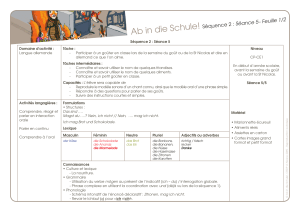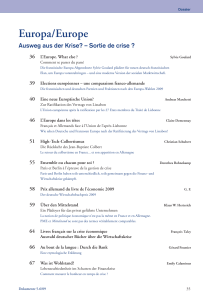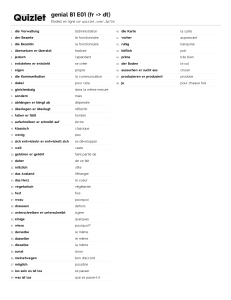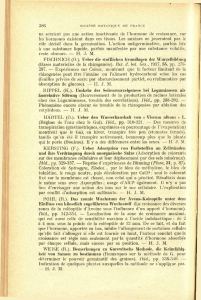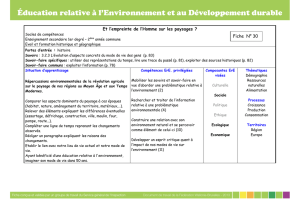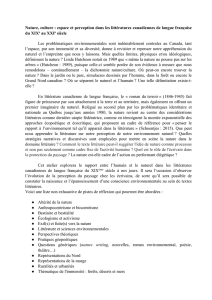PDF 479k - Revue germanique internationale

Revue germanique internationale
7 | 1997
Le paysage en France et en Allemagne autour de 1800
Herder et le paysage italien
Pierre Pénisson
Édition électronique
URL : http://rgi.revues.org/612
DOI : 10.4000/rgi.612
ISSN : 1775-3988
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 10 janvier 1997
Pagination : 93-99
ISSN : 1253-7837
Référence électronique
Pierre Pénisson, « Herder et le paysage italien », Revue germanique internationale [En ligne], 7 | 1997,
mis en ligne le 22 septembre 2011, consulté le 02 octobre 2016. URL : http://rgi.revues.org/612 ; DOI :
10.4000/rgi.612
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Tous droits réservés

Herder et le paysage italien
PIERRE PÉNISSON
Les rochers romantiques et entre eux les sombres vallées, et tout comme des jar-
dins enchantés, les golfes séduisants et les insulaires plus séduisantes encore
auraient donné à vos sens et votre sentiment des rêves éveillés1.
Friedrich Hildebrand von Einsiedel peint un paysage napolitain, un
Pausilippe - un apaisement de la tristesse, donc une modalité de l'humeur
différente de la nostalgie, de la Sehnsucht, et Herder est censé avoir perçu une
sensibilité et une sensualité qu'il est supposé avoir partagées. Et en effet lors
de son séjour en Italie, d'août 1788 à juillet 1789, Herder croit devoir cons-
tater une « sensualité » italienne ; à l'en croire, on mènerait sous ces climats
du sud une « vie simplement sensible »2, et Herder ne cesse, dans son abon-
dante correspondance avec son épouse Caroline, d'évoquer toute cette sen-
sualité à laquelle son prédécesseur en Italie, Goethe, s'était abandonné.
«Mais je ne suis pas Goethe»3, déclare-t-il. C'est dire qu'il n'est pas un
artiste voué à la sensibilité, mais aussi qu'il est pour sa part autre chose, un
autre type d'écrivain, qu'il n'y a pas lieu de comparer avec Goethe. Dès
lors,
le manque de sensibilité ou de sensualité n'est pas un défaut. Bien plus :
« Quand tout est sensible, on devient insensible. »4 Ainsi donc Einsiedel se
trompe. Mais en usant de l'expression «rêves éveillés», qu'on pourrait
presque qualifier de benjaminienne, il nomme sans doute très exactement
le rapport de Herder au paysage.
1.
« Denn die romantischen Felsen, die dunkeln Täler dazwischen, alles wie Zaubergärten !
Die reizenden Ufer und die noch reizendem Insulanerinnen würden alle Ihre Sinne und Gefühle
zum schönsten wachenden Traume bestimmt haben », Friedrich Hildebrand von Einsiedel à
Herder, Naples le 29 septembre 1789, in Johann Gottfried Herder, Italienische Reise. Briefe und
Tagebuchaufzeichnungen
1788-1789, éd. par Albert Meier et Heide Hollmer, Munich, Beck, 1989,
p.
537.
2.
« Bloß sinnliches Leben »,
ibid.,
p. 268.
3.
« Ich bin nicht Goethe »,
ibid.,
p. 209, et voir la postface à l'édition de Italienische Reise,
op.
cit., par A. Meier et H. Hollmer.
4.
« Wo alles sinnlich ist, wird man unsinnlich »,
ibid.,
p. 334.
Revue
german

Or ce rapport est de prime abord si curieux qu'on doit réellement
douter si Herder a jamais réellement perçu un paysage. Car en réalité
Herder ne voit pas, ou plutôt il voit autre chose que ce qui est ; il imagine
et - là est peut-être le plus remarquable pour ce qui touche le paysage -
selon lui le regard n'embrasse pas une unité, alors que sans doute une
forme d'unité doit bien être la condition de possibilité du paysage.
Si Herder ne voit pas c'est, pourrait-on dire, parce qu'il lit. Pris dans
une tempête aux abords d'Amsterdam en 1769, il se saisit des poèmes
d'Ossian ; à Ancône en 1788, il consulte la traduction d'Homère par
Bodmer. Voyageant entre Nantes et Paris, il reste plongé dans la lecture
de Montesquieu. Mais si l'écrivain Herder ne voit pas, c'est aussi sans
doute que l'individu Herder est affecté sa vie durant, et malgré des
opérations atroces, d'une anomalie oculaire : les glandes lacrymales
s'épanchent dans les narines - c'est presque dire que la vision ne se sépare
pas de
l'olfactif.
Mais encore Herder développe d'une manière constante
et très cohérente une théorie physiologique et esthétique extra-
ordinairement défavorable au sens de la vue, c'est-à-dire pour lui au sens
de la distance, de la vitesse, de cette mauvaise abstraction par laquelle
l'idéalisme philosophique a d'une certaine manière produit ses ravages.
Enfin, et surtout, la philosophie herderienne, héritière indirecte de
Leibniz, tient que le perçu excède partout et toujours la perception1.
Entre notre perception et ce qui est, il n'y a pas adéquation : l'être nous
déborde de toute part2. Aidé de livres, d'amis éclairés et savants, Herder
sait pourtant qu'il n'a pas vu l'Italie. On ne saurait prétendre la voir. Il
est d'ailleurs hautement significatif que Herder emporte dans son bagage
ses propres œuvres touchant la perception : la Plastique, Connaître et sentir
notamment3. « L'âme ne peut pas tout saisir, ni la mémoire tout conser-
ver. »4 C'est dans Une autre philosophie de l'histoire que Herder indique le
plus nettement le thème de la Blödigkeit au sens de myopie : du réel, nous
ne voyons que des fragments. Mais cette infirmité, ce défaut, cette imbecil-
litas est moins un manque, un statut ontologique comme chez saint
Thomas d'Aquin, que la condition même de la juste perception, ainsi
qu'on peut le voir dans la Plastique et dans Sentir et comprendre (1778). Dès
1.
Le primat de l'ouïe, « sens moyen », sur la vue est le thème rémanent, anthropologique-
ment dans le Traité sur l'origine de la langue, esthétiquement dans la Plastik, philosophiquement
dans Connaître et sentir.
2.
« Homme, reconnais-le : tu es entouré par l'Être et par le monde sensible », cf. P. Pénis-
son, Herder, la raison dans
les
peuples, Paris, Le
Cerf,
p. 31.
3.
La liste complète est la suivante : Winckelmann, Volkmann 3 Teile, Plastik, Erkennen und
Empfinden, Laokoon, Webb und Mengs, Pindar 2 Bände, Theokrit, Junius
:
über die Malerei, Anthologiam,
Geschriebenes
Büchlein, über Deutsche Art und Kunst, 8
Geschriebene
Bücher, Handbuch der Mythologie, Ita-
lienisch Lexikon, Italienisch Grammatik, Befreites Jerusalem, Pastor fido (Deutsch u. Ital. Preisschrift über
die Sprache), Ursache
des
gesunknen Geschmacks, Gedicht eines Skalden, Tändeleien, Socrates immaginario.
4.
« Die Seele kann es doch nicht fassen, das Gedächtnis doch nicht alles behalten. » Her-
der à Maximilian von Knebel, Weimar, le 18 septembre 1789, op. cit., p. 533.

lors,
on ne peut dire la nature, on ne peut que l'évoquer, hymniquement,
musicalement :
Les paysages de la nature ont pour moi des attraits qui m'ont toujours été ineffa-
bles,
c'est-à-dire fort tranquilles et solitaires
;
c'est ainsi que Tivoli fut l'adieu à
Rome, et pour moi un hymne véritable, au plus haut degré1.
Tivoli est au reste une nature plus que domestiquée et la première
visite, le 18 septembre 1788, avait été assez peu de chose : « Nous sommes
allés aux chutes d'eau et repartons vite, grande vision, pas plus grande
cependant que ce que j'escomptais. »2 Si le second séjour est si plaisant
- au point que Herder le compte parmi les jours les plus heureux de sa
vie3
- c'est qu'il est empreint de la douceur des adieux, c'est que Angelika
Kaufmann y était présente, c'est qu'il y avait un « accord donnant le ton
à toute la nature et à la société »4.
A lire les lettres du voyage en Italie, de même que le récit et la corres-
pondance lors du voyage en France en 1769, on voudrait bien croire que
les contrées ~ les pays sinon les paysages - ont un attrait ineffable. Mais il
reste remarquable que chez cet auteur dont la réception associe le nom
pour ainsi dire par automatisme avec Natur, cette dernière n'est en réalité
jamais directement présente. En France, le jeune Herder pouvait sans
scrupule imaginer, voire halluciner, des natures connues de lui seul :
notamment une très improbable forêt de Nantes où il prétend lire, ainsi
qu'une forêt dans Strasbourg. Herder d'une certaine manière ne visite ou
ne perçoit jamais un paysage, il les revisite, si je puis dire, toujours déjà.
Non seulement parce qu'en bon et réel érudit il ne regarde jamais rien
sans tous les outils savants possibles, en l'occurrence les ouvrages histori-
ques et les récits de voyage. Mais aussi parce que son imagination excède
toujours la vision. On peut dire qu'il invente une forêt nantaise qui
n'existe pas, on peut envisager tout aussi bien que quelques arbres suffi-
sent à produire sinon un paysage, du moins un environnement. Que l'on
considère par exemple l'arrivée à Naples le 6 janvier 1789: «Le voyage
était difficile, car les belles forêts d'orangers de cette heureuse région sont
couvertes d'une glace inconnue et inouïe. »5 II y a là un irréel fantastique
dont Herder est coutumier, sans, semble-t-il, en maîtriser les effets. Rap-
pelons à cet égard les deux versions du Voyage vers l'aimée6, dont une pre-
1.
« Die Gegenden der Natur haben Reize auf mich, die mir immer unaussprechlich, d. i.
sehr einsam-still waren ; so war Tivoli das Adieu von Rom u. ein wahrer Hymnus für mich im
höchsten Grad», lettre de Herder à Caroline le 9 mai 1789, op. cit., p. 459.
2.
« Wir sind beim Wasserfall gewesen, u. eilen fort ; ein großer Anblick, doch nicht größer,
als meine Erwartung ihn dachte », op. cit., p. 115.
3.
Ibid.
4.
Ibid.
: « Zusammenklang, der der ganzen Natur u. Gesellschaft Ton gab. »
5.
«Die Reise war beschwerlich, denn die schönen Orangenwälder dieses glücklichen
Erdstrichs liegen unter ungesehenem u. unerhörtem Eise : ein trauriger Anblick »,
ibid.,
p. 300.
6. Cf. A. F. Kelletat Die Fahrt zur Geliebte, Herder und die Rezeption lapischer Volkspoesie
im 17. und
18.
Jahrhundert, in Trajekt, 3, 1983.

mière version décrivait un voyage parmi les noisetiers fleuris, puis parmi
les neiges polaires.
En vérité Herder ne décrit guère de paysages, ou alors il épelle le
lexique le plus convenu : « Comme le Tyrol est un beau pays
!
montagnes
magnifiques, gens naïfs au bon cœur. »1 Certes, il
s'agit
là de lettres desti-
nées à être lues par sa famille, mais lorsqu'il s'adresse à ses enfants en par-
ticulier, il donne à l'un des leçons d'histoire romaine, à un autre des rudi-
ments de géographie fort peu paysagistes. Ce théoricien de la langue et ce
philosophe des peuples peut s'avérer d'une spontanéité touchante, ou
profonde, comme l'on voudra. On connaît son étonnement débarquant
en France devant le fait que « tous les Français parlent français » (à vrai
dire,
ce n'est pas s'étonner qu'à Paimpol on parle français, c'est plutôt
admirer la coïncidence, réelle ou imaginée par Herder, entre un peuple
et sa langue). A Nuremberg et à Rome, ce luthérien manifeste avant tout
une immédiate phobie pour les «têtes papistes»2. Contrairement aux
nombreux voyageurs de l'époque, ses remarques sur les us et coutumes
des autochtones sont inexistantes ou très convenues. Voir l'Italie aura
beaucoup moins été pour lui contempler des vedute que ressentir a contrario
à quel point il est allemand. Il proclame ressentir une « nouvelle joie de
l'Allemagne (...) et tout ce que vous nommez en elle, l' Aufklärung, la
manière allemande »3. Herder est manifestement tout sauf un observateur
doté de qualités d'empirisme anti-idéaliste. Il appartient habituellement
à son style de reprendre des stéréotypes, et, feignant de les adopter, de les
détruire, de les inverser, voire de les déconstruire. Mais dans ses récits de
voyages - en France (1769), en Italie (1788) -, il ne travaille pas les pon-
cifs : les Napolitains sont grecs, les dames romaines « braient »4. Se
réjouissant de son proche retour en Allemagne, Herder déclare enfin qu'il
aurait dû demeurer davantage «dans le jardin de Dieu, en Italie du
Nord »5.
Un élément essentiel du paysage italien, réel et pictural, le cyprès, fait
précisément difficulté pour Herder. Au clair de lune, sortant d'une
longue étude des Raphaël dans Vérone, conduit par l'évêque en per-
sonne, Herder a eu « l'honneur de déambuler parmi les pins (cyprès) et
de voir cet arbre noble et mélancolique s'élever dans l'air bleu »6. Mais en
réalité Herder n'aime pas du tout les pins ou cyprès, ils sont les arbres de
Rome, ville décidément papiste et détestable («Toi, Rome inhumaine,
1.
«O was Tirol für ein schönes Land ist! prächtige Berge, gutherzige, naive Leute», in
Italienische Reise, op. cit., p. 73.
2.
Notamment dans la lettre à Caroline, depuis Bamberg, du 10 août 1788.
3.
«Denn seit ich Italien kenne, bin ich sehr gern ein Deutscher (...) eine neue Freude an
Deutschland (...) alles was Sie das Ihre nennen, Aufklärung, Deutscher Umgang»,
ibid.,
p. 533.
4.
Ibid.,
p. 300 («Eselgeschrei») et 482.
5.
« Im Garten Gottes, im obern Italien »,
ibid.,
p. 546.
6. «Die Ehre, unter Pinien (Zypressen) umherzuwandeln, u. diesen edeln, melancholi-
schen Baum in die blaue Luft steigen zu sehen »,
ibid.,
p. 97.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%