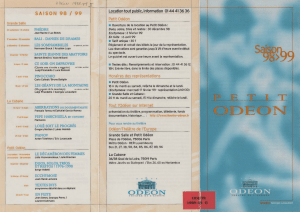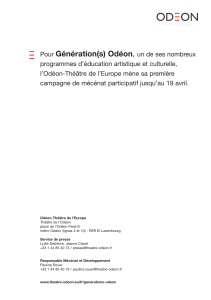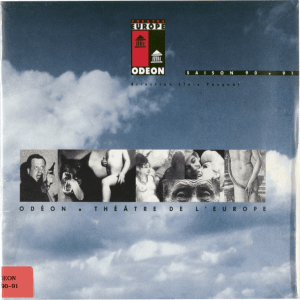Le Théâtre de l`Europe retrouve en beauté sa salle

Avril 2006 restera comme
une pierre blanche dans
l’histoire de l’Odéon.
Après trois ans de tra-
vaux, le théâtre de la pla-
ce Claudel, dans le
6earrondissement, à
Paris, ouvre ses portes au public, qui ne
sera pas dépaysé. Si la rénovation a été
complète, si, pendant des mois, la salle
n’a plus été qu’un trou impressionnant,
tout ou presque est comme cela fut.
C’est dans le hall que les change-
ments sont les plus visibles, avec la
réapparition des cariatides longtemps
masquées pour des raisons de sécurité
– mesdames chancelaient –, et aujour-
d’hui revêtues d’un jaune éclatant. Les
perspectives des escaliers et du foyer
ont ainsi retrouvé toute leur amplitude,
rehaussée par le lissage des pierres.
Mais qui entrerait pour la première fois
dans la salle pourrait croire que le théâ-
tre est en activité depuis des années.
C’est là que la rénovation décline sa
délicatesse : le vieil or des dorures et le
rouge des tentures semblent déjà pati-
nés. Pourtant, il y a une innovation
importante. Le plancher, qui était plat,
est désormais incliné. Les spectateurs
verront donc bien, sans avoir à tourner
la tête pour éviter celle du voisin de
devant.
Ainsi, le premier théâtre monumen-
tal de Paris s’offre une beauté et un
confort à la hauteur de son histoire et
de son ambition, inscrite en lettres d’or
au fronton de la façade : Odéon Théâ-
tre de l’Europe. Cette double inscrip-
tion, on la doit à Giorgio Strehler. Et
c’est vers lui que vont les pensées, au
moment de la réouverture du théâtre
dont le maître italien de la mise en scè-
ne a voulu qu’il soit une institution fran-
çaise au service de l’Europe, cette Euro-
pe qui pour lui représentait avant tout
« une certaine idée de l’homme », portée
haut à travers la culture.
Depuis 1995, Giorgio Strehler n’est
plus. Mais le Théâtre de l’Europe qu’il
a créé en 1983, grâce à Jack Lang, a
résisté, contre vents et marées. Il est
aujourd’hui aussi naturel que l’est la
nécessité d’un théâtre d’art. Nécessité
à laquelle s’emploie depuis 1996 Geor-
ges Lavaudant, le directeur des lieux.
Pendant la durée des travaux, l’Odéon
a investi les Ateliers Berthier, dans le
17earrondissement. Le public a vite
trouvé le chemin de ces anciens dépôts
de décors reconvertis en deux salles
propices aux spectacles qui sortent du
cadre du théâtre à l’italienne. Les Ate-
liers Berthier, prévus pour n’abriter
qu’une halte, restent dévolus à
l’Odéon, désormais doté de tous outils
en accord avec sa mission.
Vive les travaux ! Ils ont permis d’ex-
périmenter une autre façon de tra-
vailler, une autre géographie parisien-
ne, jetant un pont entre les quartiers
chics et les abords du périphérique. Ain-
si s’ouvre une nouvelle page de l’histoi-
re du plus beau théâtre de Paris, et du
théâtre à Paris. a
Brigitte Salino
PATRICK MESSINA POUR « LE MONDE »
Le Théâtre de l’Europe retrouve
en beauté sa salle historique
L’Odéon,
devenu Théâtre
de l’Europe
en 1990,
rouvre après
trois ans
d’une rénovation
complète
0123
Mercredi 26 avril 2006 ODÉON

Le Théâtre de l’Odéon, qui a
ouvert ses portes en 1782, est
sans doute la plus ancienne sal-
le de théâtre parisienne enco-
re debout. Elle a été construite,
sur les anciens terrains de l’hô-
tel de Condé, par les architec-
tes Charles de Wailly (1730-1798) et Marie-
Joseph Peyre (1730-1785). Nés la même
année, tous deux couronnés d’un prix de
Rome, ce sont des représentants du style
néoclassique, qu’ils vont contribuer à popu-
lariser. Ils s’associeront pour construire un
théâtre à proximité du palais du Luxem-
bourg. Ils présenteront plusieurs projets.
Celui qui sera accepté est conçu sur un plan
rectangulaire. La façade principale est
parée d’une colonnade rectiligne, des ponts,
de chaque côté, conduisent à des cafés
situés dans les bâtiments qui flanquent le
théâtre, de l’autre côté de la rue. Une arcade
fait le tour de l’édifice. A l’intérieur, un vesti-
bule carré, planté de colonnes doriques,
s’ouvre à deux escaliers symétriques.
Il s’agit là du premier édifice monumen-
tal entièrement voué à l’art théâtral. La salle
à l’italienne, la plus grande de Paris, peut
loger 1913 places. Première innovation : il
n’y a plus de places debout au parterre, tout
le monde est assis. La seconde vient de
l’éclairage par des quinquets. Des mécon-
tents se moquent de cette « carrière de sucre
blanc », la couleur qui domine dans la déco-
ration. La nouvelle salle est confiée au Théâ-
tre français, qui restera ici onze ans
(1782-1793). Il occupe là sa quatrième sal-
le : après la salle des machines au château
des Tuileries (1770-1782), l’hôtel des Comé-
diens-du-Roi, rue des Fossés-Saint-Ger-
main (1689-1770) et l’hôtel Guénégaud
(1680-1689).
C’est au futur Odéon qu’est créé, en 1784,
Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, par
les Comédiens français, qui montent égale-
ment le Charles IX, de Marie-Joseph Ché-
nier (le frère du poète guillotiné), une tragé-
die qui stigmatise la monarchie et fait scan-
dale. «SiFigaro a tué la noblesse, Charles IX
tuera la royauté », prophétise Danton en sor-
tant du théâtre, qui change de nom en 1789,
pour devenir, avec la même troupe, le Théâ-
tre de la Nation.
Sur scène, les « révolutionnaires »
conduits par Talma, affrontent les
« Noirs » réactionnaires, qui seront
d’ailleurs arrêtés et emprisonnés. On y joue
L’Esclavage des Noirs ou l’Heureux naufrage,
d’Olympe de Gouges, féministe révolution-
naire, qui finit sur l’échafaud. Le 3 décem-
bre 1793, le Théâtre de la Nation est fermé. Il
rouvre un an plus tard, sous le nom de Théâ-
tre de l’Egalité, doté d’un grand amphithéâ-
tre à l’antique qui avale loges et balcons. En
1796, avec le Directoire, c’est le théâtre qui
disparaît : voué à la « chorégraphie grec-
que », il ne s’appelle plus que l’Odéon.
D’ailleurs, il brûle en 1799 et reste abandon-
né pendant huit ans.
Napoléon le fait reconstruire par Chal-
grin (l’architecte de l’Arc de triomphe), qui
abaisse la toiture, repousse d’une travée le
mur du fond, refait entièrement le décor du
foyer, où il introduit des colonnades en
faux marbre jaune, ouvre une rotonde où il
place des cariatides de stuc et parvient à
caser une cheminée « retour d’Egypte ».
L’établissement dénommé Théâtre de l’Im-
pératrice prend le
nom de Théâtre
Royal dès la Res-
tauration pour
rebrûler derechef
sous les yeux de
Louis XVIII, en
1818. L’architecte
Baraguay, qui
reconstruit
l’Odéon, suppri-
me les deux petits
ponts le reliant
aux maisons de la
rue Corneille et
de la rue Molière
(aujourd’hui
Rotrou). Sage pré-
caution contre les incendies, il édifie un
mur pour mieux isoler la salle de la scène.
L’Odéon continue son existence mouve-
mentée. Si, en 1830, Victor Hugo gagne la
bataille d’Hernani à la Comédie-Française
(rue de Richelieu), Alfred de Musset perd
celle de La Nuit vénitienne à l’Odéon, où il
est sifflé. En revanche, en 1843 triomphe la
Lucrèce de Ponsard, une tragédie néoclassi-
que avec une ex-romantique dans le rôle-
titre, Marie Dorval, elle aussi passée à l’en-
nemi – elle venait de créer (sans succès) Les
Burgraves, de Victor Hugo. George Sand
(François le Champi), Edmond de Gon-
court (La Maréchale) et Alphonse Daudet
(Jack) y créent des pièces. Transformé en
ambulance pendant la guerre de 1870, res-
tauré par Duquesne en 1875, l’Odéon a vu
longtemps les galeries à arcades qui l’entou-
rent occupées par des bouquinistes.
Antoine (1858-1943), le fondateur du
Théâtre libre, restera sept ans à l’Odéon
(1906-1914), le temps de monter 364 piè-
ces, une par semaine. Aussi bien Tartuffe de
Molière que Ramuntcho de Loti. Il engage-
ra aussi de gros travaux, supprimant « 300
mauvaises places » – il en reste alors 1264 !
–, aménageant l’orchestre en pente, repei-
gnant la salle couleurs « feuille morte » et
« vieil or ». Il y monte Shakespeare, notam-
ment pour son « arrivée », Jules César, avec
De Max dans le rôle-titre et à l’aide d’une
figuration nombreuse dont il maîtrise les
amples mouvements. Il essaie également
des dispositifs transformables (dans Corio-
lan et Roméo et Juliette) et multiplie les
décors. Le père du théâtre naturaliste s’y
ruine. C’est le « dauphin rétif » d’Antoine,
Firmin Gémier (1869-1933), le futur créa-
teur du Théâtre national populaire, qui
reprendra un temps l’Odéon (1922-1930).
De 1946 à 1959, l’Odéon devient la
« deuxième salle » de la Comédie-Françai-
se, dite du Luxembourg. Nouveau ministre
des affaires culturelles du général de Gaul-
le, André Malraux s’empresse de confier
l’Odéon, devenu Théâtre de France, à Jean-
Louis Barrault, qui le gardera neuf ans. Le
temps d’y monter Tête d’or, de Claudel, spec-
tacle inaugural à l’issue duquel le général
aurait déclaré à son ministre : « Ce Claudel,
il a du ragoût. » Mais Barrault monte aussi
Ionesco (Rhinocéros, Le Piéton de l’air), Bec-
kett (Oh les beaux jours), Duras (Des jour-
nées entières dans les arbres), et, bien sûr,
Genet. Les Paravents, qui feront scandale,
seront joués sous protection policière.
Arrive 1968 et le joli mois de mai.
L’Odéon occupé est le théâtre de fabuleux
happenings improvisés, tandis que Bar-
rault est débarqué. Il devient un « centre
expérimental », chargé d’accueillir des
troupes de province ou de l’étranger. En
1971, la Comédie-Française, dirigée par
Pierre Dux, récupère le théâtre. En 1975, un
Italien flamboyant, Strehler, directeur du
Piccolo Teatro de Milan, est invité à y mon-
ter Goldoni. Après lui, on y verra Vitez et
Roger Blin. Jack Lang met fin à ces ambiguï-
tés : le nouveau ministre de la culture de
François Mitterrand, en 1983, le confie à
Giorgio Strehler, qui en fera l’Odéon-Théâ-
tre de l’Europe. Lluis Pasqual lui succédera
en 1990. Et après lui Lavaudant, en 1996.
La nouvelle institution vient ainsi de passer
vingt ans sans changer d’étiquette – un
exploit pour l’Odéon. a
Emmanuel de Roux
L
’Odéon vient de fêter ses 200 ans
quand, en 1983, il devient Théâtre de
l’Europe. Il est alors attribué à la
Comédie-Française, qui cède la place six
mois par an à la nouvelle institution. C’est
le début d’une histoire essentielle qui
aujourd’hui semble aller de soi, mais fut
longtemps conflictuelle.
Cette histoire est avant tout celle d’un
homme, un des grands maîtres de la mise
en scène du XXesiècle, l’Italien Giorgio Stre-
hler, pour qui l’Europe n’était pas une idée,
mais une réalité. D’abord par sa famille :
né en 1921 à Trieste d’un père d’origine
autrichienne et d’une mère d’origine fran-
çaise, il a grandi entre trois langues, à un
poste-frontière de la Mitteleuropa.
Ensuite, par sa génération : Strehler a
eu vingt ans pendant la seconde guerre
mondiale. Il a été soldat, et résistant. Il
avait la guerre en horreur et le désir indes-
tructible de bâtir, à travers le théâtre qu’il a
très tôt choisi, une Europe autre que celle
dont aujourd’hui on désespère parfois : cel-
le qui représente « une certaine idée de
l’homme, avant même la création d’un systè-
me de gouvernement », comme il l’écrivait
dans Le Monde, en 1979.
Cette Europe-là passerait par les croise-
ments et les échanges, bien sûr, mais aussi
et surtout par « un théâtre d’art pour tous »,
à la hauteur de l’exigence jamais démentie
du travail mené par Strehler en son Piccolo
Teatro de Milan, fondé en 1947 et devenu
un phare en Europe : « Nous avons
toujours pensé le théâtre comme une
institution morale, comme un geste respon-
sable : le Théâtre de l’Europe ne veut pas
renoncer à ce principe. »
L’élection de François Mitterrand à la
présidence de la République, en 1981, et la
nomination de Jack Lang au ministère de
la culture ont été décisives dans la création
du Théâtre de l’Europe, indissociablement
liée à la victoire de la gauche. Ami de lon-
gue date de Strehler, Jack Lang soutient le
projet, dans l’effervescence de la nouvelle
ère politique et culturelle française.
Les statuts de l’acte fondateur du Théâ-
tre de l’Europe tiennent en quelques pages.
Son statut officiel repose, lui, sur la con-
fiance plus que sur un contrat précis, ce qui
sera assez vite source de malentendus, de
bagarres et de coups bas. Mais qu’importe,
en ce 3 novembre 1983, la première de
La Tempête, de Shakespeare, dans une
mise en scène signée du Maestro, donne le
coup d’envoi d’une saison qui concrétise
un rêve.
Cette première saison permet d’enten-
dre également Kleist, avec Minna von Barn-
helm, une autre mise en scène de Strehler,
Lumières de Bohême, de Valle Inclan, mon-
tées par l’Espagnol Lluis Pasqual, et La
Bataille d’Arminius, de Kleist, mise en scè-
ne par l’Allemand Claus Peymann.
L’année suivante, Strehler crée, en fran-
çais, L’Illusion comique, de Corneille,
rebaptisée L’Illusion, avec Gérard Desarthe
dans le rôle principal, – un triomphe, et un
spectacle emblématique des dialogues
artistiques au-delà des frontières.
Dans les trois premières années du Théâ-
tre de l’Europe, on verra ainsi Dostoïevski
par Youri Lioubimov, ou Shakespeare et
Ibsen par Ingmar Bergman, tandis que Ugo
Tognazzi viendra jouer en français sous la
direction de Jean-Pierre Vincent, dans Six
personnages en quête d’auteur, de Pirandello.
Ce brassage des langues et cette confron-
tation des esthétiques, qui seront par la
suite souvent soutenus par le Festival
d’automne, sont les vecteurs d’une
ouverture qui pourrait s’appeler l’utopie
pragmatique. En témoigne une revue,
Théâtre en Europe, lancée en 1984 qui,
aujourd’hui encore, reste un modèle et une
terre de rencontres inégalée.
Une maison et un statut
A l’issue de son premier mandat, en
1986, Strehler affiche légitimement sa fier-
té : le Théâtre de l’Europe existe. Mais il
est menacé. En 1986, Jean Le Poulain suc-
cède à Jean-Pierre Vincent à la direction
de la Comédie-Française, qui retrouve ses
prérogatives sur l’Odéon. Retour donc à la
situation d’avant 1983. Le Théâtre de l’Eu-
rope n’est plus à demeure, il est l’invité du
Français, qui, à partir de 1987, l’accueille
quatre petits mois par an, de mars à juillet.
La France vit à l’heure de la cohabita-
tion, l’Odéon aussi. Cela ne l’empêche pas
de faire venir Luca Ronconi, Andrei
Konchalovsky ou le splendide Théâtre
Katona de Budapest, juste avant l’effon-
drement du bloc soviétique. La tension
monte en 1988. Nommé par Jack Lang,
qui a retrouvé son poste après la présiden-
tielle, Antoine Vitez succède à Jean Le
Poulain à la Comédie-Française.
Giorgio Strehler choisit alors de
frapper un grand coup. A un an de
l’échéance de son second mandat, il écrit
une lettre au président de la République
dans laquelle il réclame un siège et un sta-
tut permanents pour le Théâtre de l’Euro-
pe. Parmi ceux qui appuient sa demande,
il y a Samuel Beckett, Heiner Müller,
Maurizio Pollini, Sir John Gieldgud...
François Mitterrand entend. L’Odéon
devient à partir de 1990 la maison du
Théâtre de l’Europe, dont la direction est
confiée au successeur de Strehler, le Cata-
lan Lluis Pasqual. Ce dernier restera six ans
à Paris, appelant Patrice Chéreau, Peter
Zadek, Deborah Warner, Lev Dodine,
Klaus Michael Grüber, Luc Bondy, Robert
Wilson, Georges Lavaudant.
Dans ces années-là, une autre Europe
se dessine. L’effondrement du bloc soviéti-
que signe la fin d’un monde bipolaire. Des
repères idéologiques s’effacent, de
nouvelles questions se posent. Georges
Lavaudant, qui succède à Lluis Pasqual en
1996, maintient le cap et la barre. Krystian
Lupa, Romeo Castellucci ou Christoph
Marthaler entrent dans l’histoire du
Théâtre de l’Europe, qui continue à se
réinventer. a
B. Sa.
A l’automne sortira un livre, piloté par Colette
Godard, sur le Théâtre de l’Europe
Grâce au
flamboyant Italien
Giorgio Strehler
(1921-1995),
le fondateur du
Piccolo Teatro
de Milan (ici ,en
répétition), l’Odéon
devient en 1983 le
Théâtre de l’Europe.
LUIGI CIMINAGHI/ PICCOLO
TEATRO DI MILANO
En 1789 est créé
le « Charles IX »
de Chénier,
qui stigamiste
la monarchie.
« Si “Figaro”
a tué la noblesse,
“Charles IX” tuera
la royauté », dit Danton
à la sortie du spectacle
Inauguré par Marie-Antoinette
en 1782, le Théâtre de l’Odéon
vit au miroir de la société et de
la politique françaises
Deux siècles riches
d’une histoire mouvementée
Vingt ans d’une Europe à inventer
II
ODÉON

aQuartett, d’Heiner Müller.
Mise en scène de Robert Wilson.
Du 28 septembre au 2 décembre,
Odéon, Paris 6e.
aBaal, de Bertolt Brecht.
Mise en scène de Sylvain Creuzevault.
Du 5 au 28 octobre, Berthier, Paris 17e.
aHey Girl !, par la Societas Raffaello
Sanzio. Mise en scène de Romeo
Castelluci. Du 16 au 25 novembre,
Berthier.
aCassandre, d’après Christa Wolf.
Musique de Michaël Jarrell.
Mise en scène de Georges Lavaudant.
Les 9, 12 et 13 décembre, Berthier.
aLe Roi Lear, de Shakespeare.
Mise en scène d’André Engel.
Du 13 janvier au 24 février 2007,
Berthier.
aZarathustra, d’après Friedrich
Nietzsche et Einer Schleef.
Mise en scène de Krystian Lupa.
En polonais surtitré.
Du 18 au 27 janvier, Odéon.
aL’Affaire de la rue de Lourcine,
d’Eugène Labiche.
Mise en scène de Jérôme
Deschamps et Macha Makeïeff.
Du 22 février au 31 mars, Odéon.
aBase 11/ 19, conception Guy
Alloucherie, Martine Cendre,
Howard Richard.
Mise en scène de Guy Alloucherie.
Du 8 au 31 mars, Berthier.
aThérèse Philosophe, texte anony-
me, attribué au marquis Boyer d’Argens.
Mise en scène d’Anatoli Vassiliev.
Du 29 mars au 28 avril, Berthier.
aLes Cenci, d’après Antonin Artaud.
Livret et musique de Giorgio Battistelli.
Mise en scène de Georges Lavaudant.
Les 6 et 7 avril, Odéon.
aLa Tempête, de William Shakespea-
re, en quatre langues surtitrées.
Mise en scène de Dominique Pitoiset.
Du 27 avril au 2 juin, Berthier.
aIl Ventaglio (L’Eventail),
de Carlo Goldoni.
Mise en scène de Luca Ronconi.
En italien. Du 10 au 20 mai, Odéon.
aBerthier’07, un festival pour les jeu-
nes acteurs. En juin, Berthier.
aRenseignements
Du lundi au samedi, par téléphone,
au 01-44-85-40-40.
Internet : www.theatre-odeon.fr
aAdresses
Théâtre de l’Odéon, place de l’Odéon,
75006 Paris.
Métro Odéon ou RER B Luxembourg.
Ateliers Berthier, 8, boulevard Berthier,
75017 Paris.
Métro et RER C Porte de Clichy.
aLocation
Par téléphone, au 01-44-85-40-40,
ou à la Fnac, au 0892-68-36-22
(0,34¤ la mn).
Au guichet du Théâtre de l’Odéon,
du lundi au samedi de 11 heures
à 18 heures.
Internet : www.theatre-odeon.fr,
theatreonline.com
aAbonnements et pré réservations
En individuel :
Par téléphone, au 01-44-85-40-38.
Au guichet du lundi au vendredi
de 15 heures à 18 heures.
Internet :
En groupes :
Pour les amis, les associations,
les comités d’entreprise, par téléphone
au 01-44-85-40-37.
Internet :
Pour les groupes scolaires
et universitaires, par téléphone
au 01-44-85-40-39.
Internet : [email protected]
aCorrespondance
A adresser à l’Odéon,
Théâtre de l’Europe,
2, rue Corneille, 75006 Paris .
1996. Georges Lavaudant
invite Carmelo Bene, acteur
inégalé de la consomption,
de la fureur et de la stupeur.
Par la grâce d’une voix qui
réconcilie le chant antique
et celui de l’opéra, l’Italien
frère d’Artaud fait entendre
« ce que Shakespeare
se cachait à lui-même ».
EFFIGIE/LEEMAGE
D’APRÈS OP HOOP VAN ZEGE,
D’HERMANN HEIJERMANS, MIS EN SCÈNE
PAR CHRISTOPH MARTHALER
DE SHAKESPEARE, MISE
EN SCÈNE PAR GIORGIO
STREHLER
La Tempête
DE SHAKESPEARE,
PAR CARMELO BENE
Horror Suite
Macbeth
2005. Puisque le temps d’une chan-
son, tout est possible, ils chantent,
ces hommes et ces femmes réunis au
café de La Bonne Espérance. Des
gens de la mer, en partance ou dans
l’attente du retour, qui tanguent
comme tangue la vie, la vie humaine
trop humaine, celle que le Suisse
Christoph Marthaler sait comme nul
autre mettre en scène. PHILE DEPREZ
Seemannslieder
1995. Sept
« voyous suprêmes »
dansent avec la mort,
le temps d’une nuit,
leur dernière nuit,
qu’ils passent
dans un palace où
ils se sont retranchés
après avoir
enlevé la fille d’un
millionnaire. C’est
Splendid’s, la pièce
de Genet reniée
par son auteur,
que l’Allemand Klaus
Michael Grüber met
en scène, demandant
à Peter Handke de la
traduire. Dans l’ovale
mystérieux d’un
décor de Gilles
Aillaud, la nuit
se déploie comme
un voile, repliée
sur la solitude
de chacun,
dans l’attente
du moment ultime.
WILFRIED BÖING
DE JEAN GENET,
MIS EN SCÈNE
PAR KLAUS
MICHAEL GRÜBER
Splendid’s
PROGRAMMATION
2006-2007
PRATIQUE
QUATRE TEMPS FORTS DE L’ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE
1983. Le 3 novembre, le Théâtre de l’Europe est inauguré avec
une Tempête qui s’inscrit comme un rêve dans les mémoires. Le
rideau s’ouvre sur une mer nocturne et furieuse, le vent rugit, un
mât penche, des hommes se débattent : c’est la plus belle tempê-
te qui fut jamais donnée à voir. Elle s’achève dans un roulis de toi-
les qui met à nu l’illusion, cette illusion de la vie et du pouvoir qui
bat au cœur même de la pièce de Shakespeare. Strehler œuvre
en maître, il magnifie le théâtre à l’italienne, en montre la magie
et la fragilité, qui sont celles mêmes du théâtre et de son pouvoir.
LUIGI CIMINAGHI/PICCOLO TEATRO DI MILANO
0123
Mercredi 26 avril 2006 III

Vous faites souvent référence au théâ-
tre d’art : qu’entendez-vous par là ?
Pour moi, on est dans le théâtre d’art
quand la vérité du plateau prime sur tout
le reste, et quand tout est mis au service
de cette vérité d’essence artistique que
l’on essaye d’atteindre : le spectateur
doit avoir le sentiment que ce qu’il voit
est unique, qu’il ne s’agit pas d’un objet
reproductible. Et on n’est pas dans le
théâtre d’art quand ce sont d’autres
contraintes, financières notamment, qui
priment.
Dans quelle tradition inscrivez-vous ce
théâtre d’art ?
Je l’inscris, contra-
dictoirement
d’ailleurs, dans la dou-
ble filiation de Stanis-
lavski, bien sûr, et de
Vilar. Pour moi, Jean
Vilar, c’était cela : l’at-
tention portée aux
moindres détails, au
texte que l’on veut
jouer, aux acteurs, à
l’espace scénique, aux
musiques, aux costu-
mes, etc., mais tout en
faisant que le public
soit le plus large possi-
ble. Vilar, même s’il se
minorait lui-même en
s’appelant régisseur
et non metteur en scène, voulait que ce
qui était sur le plateau soit d’une dignité
et d’une morale sans faille.
Et bien sûr, la référence principale,
c’est Stanislavski. Avant lui, les pièces se
répétaient en quelques jours, avec des
acteurs qui arrivaient au dernier
moment et trois costumes récupérés
dans la réserve. Le théâtre était une acti-
vité à moitié sportive et à moitié caboti-
ne. Stanislav-ski a dit : « Arrêtons tout et
réfléchissons à ce que serait une morale du
théâtre – qui n’est pas une morale de la vie.
Au contraire, dans le bon sens du terme, le
théâtre est toujours amoral. La morale du
théâtre d’art, c’est la conscience de ce qui se
fait. On ne peut jamais l’atteindre vrai-
ment, c’est une chose vers quoi on tend. »
Ce théâtre est-il lié à un répertoire et à
une esthétique particuliers ?
Plus à une esthétique qu’à un répertoire.
Le répertoire, on l’a bien vu ces dernières
années, avec Feydeau notamment, on peut
l’ouvrir à l’infini quand on le retravaille
avec des conceptions ludiques ou intellec-
tuelles fortes. L’esthétique du théâtre d’art
consiste en une chasse aux clichés sur la
pièce, et sur l’époque. Ce n’est pas parce
que vous jouez une pièce en costumes
contemporains avec de la musique techno
que cette pièce trouve sa vérité pour aujour-
d’hui. Comme le disait Carmelo Bene, il ne
s’agit pas de faire un Hamlet de plus, mais
un Hamlet de moins. Je pense que le théâ-
tre d’art est aussi lié au fait que les institu-
tions soient dirigées par des metteurs en
scène. Etre soi-même dans le conflit de la
double casquette don-
ne plus de poids pour
maintenir le cap.
Quel était votre ima-
ginaire de l’Europe
quand vous avez pris
la direction de
l’Odéon en 1996 ? A
l’époque, vous disiez
que votre Europe
était plutôt celle de
Kafka que celle de
Goethe.
Il est vrai que je
suis arrivé avec l’envie
d’apporter dans ce
temple qui symboli-
sait une Europe forte,
sûre d’elle-même,
brillante, lumineuse,
la vision d’une Europe différente, comme
une ombre portée : un imaginaire euro-
péen allant de Kafka à Joyce en passant
par Pessoa ou Schulz – ce que Gilles Deleu-
ze appelle « les langues minoritaires ».
Giorgio Strehler, c’est l’Européen
modèle, c’est un maître incontestable,
c’est l’Europe de Mozart et de Goethe. Je
souhaitais mettre en question l’Odéon,
l’amener à réfléchir sur ses propres cli-
chés d’institution au public bien élevé,
attendant un post-stréhlérisme dans tou-
te sa splendeur. Il ne s’agissait pas de
contredire Strehler, mais de dire qu’il y
avait aussi une autre Europe, plus fragi-
le, plus contradictoire, plus torturée. Met-
tre un peu de mineur dans le majeur.
Et aujourd’hui, que signifie ce label ?
En arrivant, je me suis rendu compte
qu’il y avait une réalité des théâtres en
Europe, très concrète, loin de l’imaginai-
re littéraire. Il y a eu une sorte d’ajuste-
ment à faire. Aujourd’hui, on est dans
une amplification du travail amorcé par
Strehler et poursuivi par Lluis Pasqual.
L’idée, c’est d’avoir les meilleurs spec-
tacles européens, dans leur langue, et de
les jouer le plus longtemps possible –
pour que ce ne soit pas qu’une politique
festivalière en deux soirs, avec la salle des
invités le premier soir et vaguement du
public le second soir. Il s’agit donc d’un
effort de consolidation et non de rupture.
Une affirmation européenne qui doit être
rendue la plus militante possible. C’est
particulièrement essentiel après le refus
de l’Europe qui s’est exprimé au référen-
dum de mai 2005 – si tant est que ce
« non » ait vraiment exprimé un refus de
l’Europe.
Pourquoi est-ce si essentiel ?
Parce que je me sens européen. Et que,
pour moi, le théâtre européen, c’est le
contraire de Bruxelles. Ce n’est pas une
langue unique, ce n’est pas l’euro. C’est
une autre Europe, plus riche, moins sché-
matique que celle à laquelle on voudrait
nous faire adhérer et qui, peut-être,
connaît des ratés justement parce qu’elle
veut lisser la richesse de cet ensemble
extrêmement divers, mais qui est un espa-
ce géographique, historique et culturel
incontestable.
Pourquoi vous semblait-il nécessaire
de conserver la salle de Berthier, mal-
gré la réouverture de la salle histori-
que ?
D’abord parce que l’Odéon a toujours
voulu obtenir une deuxième salle. Main-
tenant qu’on l’a, on ne va pas l’abandon-
ner ! Ensuite, parce qu’on ne fait pas la
même chose à Berthier que dans une sal-
le à l’italienne. Cela permettra de varier
les projets, selon l’inspiration des met-
teurs en scène.
Berthier ne sera pas dévolue aux tex-
tes contemporains, tandis que l’Odéon-
Claudel accueillerait le répertoire. Avoir
ces deux salles permet de servir au
mieux notre projet d’un théâtre de l’Eu-
rope. a
propos recueillis par
Fabienne Darge
et Brigitte Salino
GEORGES LAVAUDANT,
directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe
« Mettre un peu
de mineur
dans le majeur »
Hamlet, c’est lui : Ariel Gar-
cia-Valdès, sans qui Geor-
ges Lavaudant n’aurait
pas monté la pièce de Shakespea-
re qui inaugure l’Odéon rénové,
dans une version très personnel-
le, sous-titrée Un songe. Ainsi se
poursuit, entre le metteur en scè-
ne et l’acteur, une histoire de
théâtre et de vie qui traverse
l’arc du temps.
Elle a commencé dans les
années 1960, à Grenoble, où
Ariel Garcia-Valdès a grandi
entre une mère catalane et un
père castillan, des républicains
qui, comme tant d’autres, ont
fui l’Espagne de Franco et sont
venus dans les Alpes, parce qu’il
y avait du travail à l’usine.
Le théâtre, lui, est venu par
un professeur qui, en lui don-
nant des textes à dire, a vu
qu’Ariel Garcia-Valdès était
acteur. L’adolescent est alors
allé pour la première fois dans
une petit théâtre de la ville, et là,
dans l’obscurité au milieu des
gens, il s’est senti bien.
C’est alors que sa route a croi-
sé celle de Georges Lavaudant,
qui était alors étudiant. Ensem-
ble, avec la bande où il y avait
déjà Philippe Morier-Genoud et
Annie Perret, ils créent le Théâ-
tre Partisan et font du théâtre
partout où cela est possible, et
même improbable.
Leur premier spectacle s’ap-
pelle Eh bien quoi qu’il arrive on
fait quelque chose ensemble ! La
suite appartient à l’histoire, qui
les mène dans une salle de Gre-
noble qu’ils aménagent. Gabriel
Monnet, un grand bonhomme
de la décentralisation, les prend
sous son aile.
En 1973, Ariel Garcia-Valdès
joue Lorenzaccio, en 1975, il est
Edgar dans Le Roi Lear – deux
spectacles qui assurent la
renommée de la bande de Lavau-
dant, invité en 1976 à devenir
codirecteur (avec Gabriel Mon-
net) du Centre dramatique
national des Alpes.
« Ce temps merveilleux du
théâtre et de la vie en même
temps », comme le dit Ariel Gar-
cia-Valdès, voit naître plusieurs
spectacles restés dans les anna-
les, Palazzo mentale (1976), un
collage dans la tradition des
tout premiers spectacles, Maître
Puntila et son valet Matti, de
Brecht (en 1978), Les Géants de
la montagne, de Pirandello (en
1981), ou bien encore Les Céphéi-
des, de Jean-Christophe Bailly,
créés dans la Cour d’honneur du
Palais des papes, au Festival
d’Avignon, en 1983.
Une séduction désespérée
L’année suivante, Ariel Gar-
cia-Valdès retrouve la Cour, où
il est un inoubliable Richard III.
Avec lui, la claudication du roi-
monstre de Shakespeare devient
une danse nietzschéenne, le mal
et la laideur s’enlacent dans une
séduction désespérée, la mort se
maquille d’un rictus noir.
Et puis plus rien. En 1986,
Georges Lavaudant est appelé à
codiriger avec Roger Planchon
le Théâtre national populaire de
Villeurbanne. Il part bien sûr
avec sa bande. Moins Ariel Gar-
cia-Valdès, qui ne voit pas l’inté-
rêt de déplacer leur aventure à
cent kilomètres de Grenoble. A
ce moment-là, on propose à l’ac-
teur de monter L’Echange, de
Claudel, à Barcelone.
Il part. « J’ai toujours pensé
qu’une histoire viendrait là. »
Ainsi, la boucle de l’exil des
parents est bouclée. Le travail le
mène à Séville et Madrid, des
classiques aux contemporains,
mais toujours du côté de la mise
en scène.
Ariel Garcia-Valdès ne joue
plus. Et cela pendant vingt ans.
A une exception près : en 1994,
il est dans Les Estivants, de Gor-
ki, mis en scène par Lluis Pas-
qual, alors directeur de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe.
Ne pas jouer ne manque pas à
Ariel Garcia-Valdès. Des propo-
sitions, il en a beaucoup, mais il
les repousse. « Je ne me suis
jamais dit que je n’avais plus
envie de jouer, dit-il, mais je n’ai
jamais eu cette nécessité impé-
rieuse qu’ont les acteurs d’être sur
une scène. »
Ce n’est pas une coquetterie.
Ariel Garcia-Valdès a toujours
été ainsi. A Grenoble déjà, il pou-
vait rester des mois sans jouer,
et sans que cela lui pèse. Au
contraire : être dans la rue où
les montagnes lui suffisait, com-
me lui a toujours suffi un poème
de Georg Trakl ou une phrase de
Stanislas Rodanski.
C’est un acteur qui se nourrit
des « vides » vécus comme une
promesse, et se ressource dans
un ailleurs qui n’appartient qu’à
lui. Ariel Garcia-Valdès n’a
jamais eu d’agent, il n’a pas de
portable ni de téléphone fixe.
« Et on arrive toujours à me trou-
ver », dit-il.
Depuis 1996, on le trouve à
Montpellier, où il dirige avec
passion le Conservatoire d’art
dramatique. A sa façon : seul
avec une secrétaire. Dans cette
école qu’il veut avant tout « une
école de la vie », il n’y a pas de
professeurs fixes, mais des
acteurs, comme Serge Merlin,
Jacques Bonnaffé ou Denis
Lavant, qui accompagnent les
élèves totalement impliqués
dans toutes les activités.
Il a fallu que ce soit Georges
Lavaudant pour qu’Ariel Garcia-
Valdès cède et revienne à la scè-
ne. En 2005, ils ont repris à Ber-
thier un de leurs spectacles féti-
ches créé en 1979, La Rose et la
Hache, d’après Shakespeare et
Carmelo Bene. Maintenant, il y
aHamlet, qu’Ariel Garcia-Val-
dès a joué sous la direction de
Daniel Mesguich, et qui fait de
lui le premier à fouler le plateau
du nouvel Odéon. En attendant
Quartett, d’Heiner Müller, avec
Isabelle Huppert, sous la direc-
tion de Robert Wilson, en ouver-
ture de la saison 2006, à
l’Odéon, toujours.
Alors, cours vite, camarade,
Ariel Garcia-Valdès est là. Et
cela ne durera peut-être qu’un
temps. a
B. Sa.
« Le théâtre
européen,
c’est le contraire
de Bruxelles.
Ce n’est pas
une langue
unique,
ce n’est pas
l’euro »
PARCOURS 1947 : naissance à Grenoble (Isère).
1975 : met en scène Lorenzaccio,de Musset,
avec sa compagnie du Théâtre Partisan.
1976 : codirecteur, avec Gabriel Monnet, du Cen-
tre dramatique national des Alpes, à Grenoble.
1986 : devient codirecteur, avec Roger Plan-
chon, du Théâtre national populaire de Villeur-
banne (Rhône).
1996 : prend la direction de l’Odéon-Théâtre de
l’Europe, à Paris. PATRICK MESSINA POUR « LE MONDE »
Les chemins de traverse d’Ariel Garcia-Valdès
IV
ODÉON
1
/
4
100%