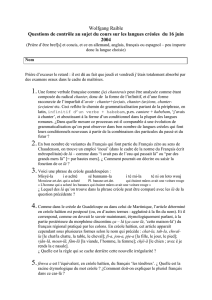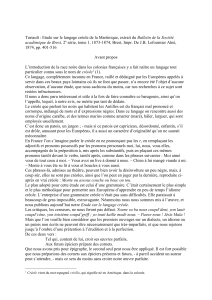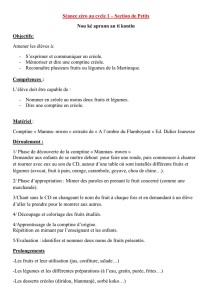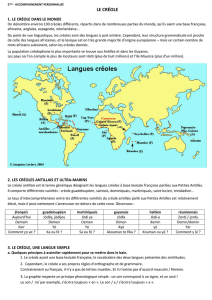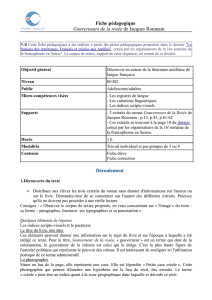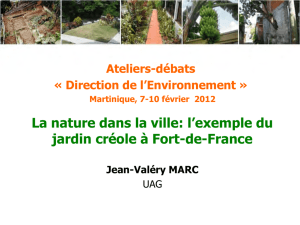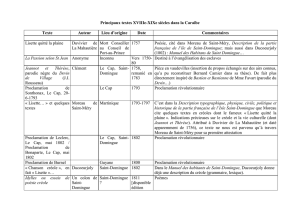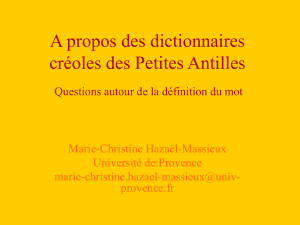LES LANGUES CRÉOLES : Regard sur une trajectoire de 25 ans

1
LES LANGUES CRÉOLES : Regard sur une trajectoire de 25 ans
Par Pierre Vernet
Doyen de la Faculté de Linguistique Appliquée
Université d’Etat d’Haïti
Janvier 2002
SOMMAIRE
A- Bases politiques et scientifiques de la trajectoire
B- Contours de la Trajectoire : Principaux repères
C- Cadre d’observation de la trajectoire
: Données quantitatives (taux de pratiques) et
qualitatives (statut social et décréolisation)
D- Les données
DI- Pratique orale
DI
1
- Radios :
1a) Données : Liste, pourcentage
1b) Commentaires
DI
2
- Télévision :
2a) Données : Liste, pourcentage
2b) Commentaires
DI
3
- Enoncées créoles :
3a) Données
3b) Commentaires

2
DI
4
- Influence des médias sur la pratique de la population
DI
5
- Appréciation des données dans leur évolution
DII- Pratique écrite
DII
1
- Données
DII
2
- Commentaires
E- Conclusion
F- Notes

3
Les langues créoles
Regard sur une trajectoire de 25 ans
------------------------------------------------
A-
Bases politiques et scientifiques de la trajectoire
Les années 70 ont vu l’arrivée d’un nouveau tournant dans le combat pour
l’avancement des langues créoles.
Du nombre de facteurs sous-jacents à ce phénomène l’on peut retenir une plus
grande prise de conscience -- au plan international, mais également dans l’espace
spécifique à chacune -- de l’importance de ces langues. Ce fait, loin de se produire
isolément, s’est plutôt révélé comme un élément intégré dans une mouvance plus globale.
Tout d’abord, l’effervescence contestataire de 68 a été le point culminant au plan
international d’une vaste remise en question socio-politique
1
. Sur le plan scientifique on a
enregistré des avancées considérables des Sciences Humaines dont principalement la
Linguistique (avec la systématisation du courant structuraliste), l’anthropologie, la
psychologie etc
2
…
Dans le domaine des Sciences du Langage l’un des axes méthodologiques
introduits dans le cadre des nouvelles avancées scientifiques à travers le structuralisme a
consisté à aborder l’analyse de la langue de manière spécifique «en elle-même, par elle
même et pour elle-même». Il s’est agi d’une rupture d’avec le courant précédent, la
philologie, la grammaire comparée, dont la charpente méthodologique reposait sur la
filiation des langues et la démarche comparative
3
.
Ainsi engoncée dans le carcan millénaire de l’idéologie de la verticalité et de la
hiérarchisation (langue sacrée versus langue non sacrée, langue de civilisation versus
langue de non civilisation, langue noble versus langue vulgaire etc…), une langue créole
ne pouvait-elle être appréhendée qu’à travers le prisme d’une autre langue dite de “grande
culture” ayant participé à son élaboration: le français, l’anglais, le hollandais etc… On
parlait de créoles français, anglais, hollandais etc
4
…
S’est dégagée, dans cette vaste dynamique de renouveau socio-politique et
scientifique, une nouvelle compréhension du développement selon une dimension moins
mécaniste et orientée davantage vers l’apport incontournable des ressources humaines
(avec une autre approche de la formation), le rôle de l’individu dans sa propre
participation à son développement et une nouvelle conception du bien-être de ce dernier
qui ne devait plus dès lors se mesurer à la seule aune de la production de biens.

4
Et le corollaire obligé de cette vaste remise en question socio-politique et de ces
nouvelles orientations a été, au plan idéologique, super structurel, la valorisation des
langues et des cultures dont certaines, spécifiquement du Tiers-Monde, ont été jusqu’alors
minorées ou tout simplement ignorées.
L’on peut retenir dans le cadre de cette dynamique l’intérêt pour les langues
considérées dès lors comme nationales des pays d’Afrique et la mise en place notamment
au CNRS, et dans d’autres universités d’Europe et d’Amérique, d’un véritable chantier
pour les travaux de description de ces langues
5
.
B-
Contours de la Trajectoire : Principaux repères
Dans le champ qui nous concerne spécifiquement ici, celui des langues créoles,
l’on a assisté dans sa dynamique à un foisonnement d’activités sans précédent.
Un premier fait à retenir inédit dans la trajectoire de la mouvance des langues
créoles: l’émergence d’un groupe important de linguistes natifs
6
. Fait qu’il faut
évidemment saisir comme corollaire à la fois de la remise en question socio-politique au
plan international, et des avancées au plan scientifique de disciplines comme
l’anthropologie et la linguistique. Ces deux facteurs ayant entraîné une reconnaissance des
langues et des cultures des pays du Tiers-Monde, donc des peuples créolophones…
Cette dynamique allait être renforcée à la même époque par l’émergence
concomitante de jeunes linguistes non originaires de pays créolophones, dont le créole
n’était pas la langue maternelle
7
. Formés techniquement dans le cadre des dernières
avancées scientifiques notamment en linguistique, en anthropologie, leurs démarches et
leurs travaux se sont trouvés naturellement convergents par rapport à ceux des linguistes
natifs.
Il faut signaler à cet égard qu’il y a eu, bien sûr, précédemment à cette période, des
travaux réalisés sur les langues créoles par des linguistes dont le créole était la langue
maternelle (Elodie Jourdain, Suzanne Comhaire-Sylvain, Pradel Pompilus etc…). Mais le
contexte des années 70 et le nombre de linguistes natifs de différents pays créolophones
(Dominique, Guadeloupe, Guyane, Jamaïque, Haïti, Martinique, Maurice, Réunion,
Seychelles, Ste-Lucie, Surinam etc…) doublé de linguistes créoles non natifs ont assuré
au mouvement une nouvelle dynamique plus forte et plus cohérente.
Le Colloque de Nice suivi de celui des Seychelles engagea le mouvement,
également nouveau quant à sa systématicité et à sa régularité, de l’organisation de
rencontres scientifiques
8
.

5
Phénomène qui s’accompagna de son double: la production foisonnante de travaux
de description scientifique des langues créoles et de documents d’illustration: charte,
textes littéraires (roman, poésie, conte), textes didactiques etc
9
…
Plus spécifiquement, l’un des outils fondamentaux à l’avancement de ces langues,
l’orthographe, allait être systématisé et standardisé. A partir de travaux convergents, dans
leurs soubassements théoriques, du laboratoire de créole de l’Université René Descartes
(Paris V), du GEREC, de la Faculté de Linguistique Appliquée de l’Université d’Etat
d’Haïti, l’on aboutit à un système orthographique cohérent. Système avec des faits
d’application différents en fonction des particularités de chacune des langues créoles mais
unique et standard dans les principes qui lui sont sous-jacents
10
.
Un autre produit de la vaste remise en question internationale a été la prise en
compte de la nécessité d’instaurer une nouvelle école. Une nouvelle approche, plus
humaine, du développement impliquait un système éducatif dans ses rapports avec les
langues et les cultures des pays concernés
11
.
Des classes expérimentales utilisant le créole ont été mises en place dans plusieurs
pays créolophones dont la Martinique, la Guadeloupe. Dans le cas d’Haïti et des
Seychelles cette expérience s’est réalisée dans un cadre plus élargi, celui d’une réforme
éducative nationale assurée par l’Etat
12
.
Toutes ces démarches assurées dans le cadre de l’école entraînèrent la diffusion, la
standardisation et la fixation de l’orthographe. Dans le cas d’Haïti et des Seychelles
l’orthographe a été officialisée
13
.
D’autres démarches à un plan politique ont contribué par ailleurs à conférer un
statut aux langues créoles. L’on peut retenir, entre autres, la constitution d’Haïti qui en
1987 a fait du créole une langue officielle au même titre que le français. Plus récemment
en 2001 il y a eu les décisions du gouvernement français concernant le CAPES créole
14
.
Ces acquis (officialisation de l’orthographe puis de la langue, introduction formelle
à l’école, CAPES etc…) correspondant à des décisions administratives donc politiques
doivent être appréciés à leur juste valeur, c’est-à-dire comme des conquêtes. En effet il ne
faut pas perdre de vue que ces décisions ont émané du pouvoir, de l’Etat. Or, on le sait, et
la situation sociolinguistique le dit, le pouvoir est en symbiose avec les couches
scolarisées francisante ou anglicisantes, puisque contrôlées par elles. Force donc est de
reconnaître le travail collectif redynamisé avec plus de vigueur et plus de cohérence dans
une synergie internationale à partir de l’émergence dans les années 70 des jeunes
linguistes natifs et non natifs qui ont engagé le combat pour l’avancement des langues
créoles. Combat mené sur tous les plans.:
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%