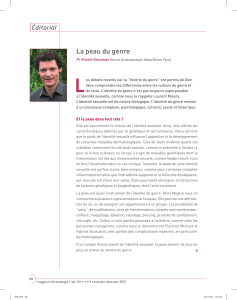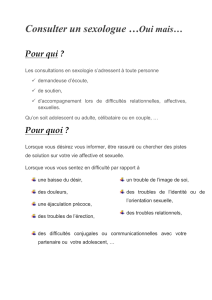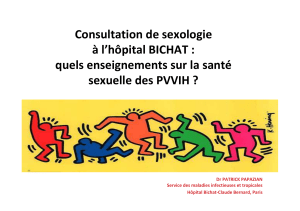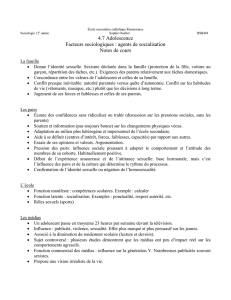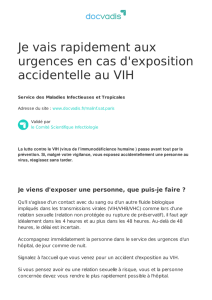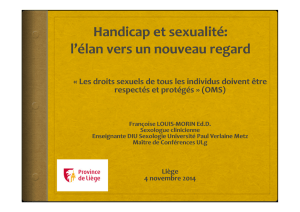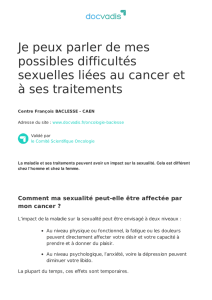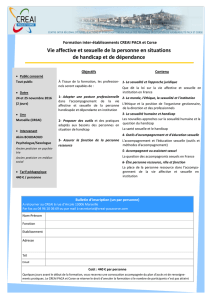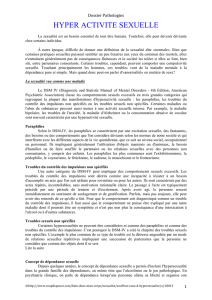Qualité de vie sexuelle chez les personnes vivant avec le VIH

Sexologies (2011) 20, 188—192
ARTICLE ORIGINAL
Qualité de vie sexuelle chez les personnes
vivant avec le VIH夽
M. El Fane (MD)a,∗, R. Bensghir (MD)a, S. Sbai (MD)b, A. Chakib (MD)a,
N. Kadiri (MD)b, A. Ayouch (PhD)a, H. Himmich (MD)a
aService des maladies infectieuses, CHU Ibn Rochd, quartier des hôpitaux, Casablanca 20100, Maroc
bCentre psychiatrique universitaire, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
Disponible sur Internet le 10 mars 2011
MOTS CLÉS
Sexualité ;
Infection à VIH ;
PVVIH ;
Trouble sexuel ;
Prévention
Résumé L’infection à VIH touche les personnes dans leur intimité. Notamment transmis par
voie sexuelle, le virus envahit brusquement la conscience et l’inconscience des personnes
séropositives. Il marque de son empreinte toute leur vie. Depuis l’avènement des thérapies
antirétrovirales et l’allongement de l’espérance de vie, la qualité de vie sexuelle et affective
est une préoccupation pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et pour les soignants. Le
but de notre travail est d’identifier les troubles rencontrés chez les PVVIH et de déterminer les
facteurs influenc¸ant leur sexualité. Un échantillon de 134 patients séropositifs vivant avec le
VIH, suivis au service des maladies infectieuses du centre hospitalo-universitaire Ibn Rochd de
Casablanca a été recruté. Un questionnaire préétabli par les auteurs a permis d’identifier les
caractéristiques sociodémographiques, ainsi que des renseignements concernant l’infection à
VIH, la sexualité et la prévention de la transmission du VIH. Le diagnostic des troubles sexuels a
été fait selon les critères du DSM-IV. Soixante quatre pour cent des hommes inclus affirment ne
pas avoir une activité sexuelle satisfaisante et 80 % rapportent des troubles sexuels, notamment
un dysfonctionnement érectile ; 70 % des patientes affirment ne pas avoir une activité sexuelle
satisfaisante, 69 % rapportent des troubles sexuels, notamment une baisse de la libido, une
anorgasmie et une dyspareunie ; 63 % des personnes interviewées utilisent systématiquement
le préservatif lors des rapports sexuels.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
DOI de l’article original : 10.1016/j.sexol.2010.12.007.
夽This issue also includes an English version: El Fane M, Bensghir R,
Sbai S, Chakib A, Kadiri N, Ayouch A, Himmich H. Quality of sexual
life for people living with HIV (PLWHA).
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (M.E. Fane).
Introduction
La qualité de vie sexuelle des personnes séropositives n’a
rec¸u aucune attention pendant une longue période de
l’épidémie et ce en partie à cause de l’espérance de vie
qui était courte. Il a fallu attendre l’arrivée des thérapies
antirétrovirales hautement efficaces pour que la question
1158-1360/$ – see front matter © 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.sexol.2010.12.006

Qualité de vie sexuelle chez les personnes vivant avec le VIH 189
de la sexualité des personnes séropositives surgisse dans les
thèmes de recherche en sciences sociales et comportemen-
tales (Troussier et Tourette-Turgis, 2006).
Depuis le début des années 1980, les conceptions de
la sexualité des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
ont beaucoup changé. Dans les premières publications
sur ce thème, toute relation sexuelle, même protégée
par un préservatif, était fortement déconseillée (Kaplan
et al., 1985). Actuellement, la qualité de vie est net-
tement meilleure, l’espérance de vie est beaucoup plus
longue, voire équivalente à celle d’une personne séro-
négative ; de plus en plus de chercheurs s’intéressent
à la qualité de vie des PVVIH et soulignent l’intérêt
d’offrir une prise en charge plus globale (Kaplan et al.,
1985).
Le but de notre travail est d’évaluer la prévalence des
troubles sexuels, ainsi que l’impact de l’infection à VIH sur
la qualité de vie sexuelle des PVVIH suivies au service des
maladies infectieuses du centre hospitalo-universitaire Ibn
Rochd de Casablanca.
Patients et méthodes
La population
Cent trente-quatre patients séropositifs pour le VIH suivis
au service des maladies infectieuses du centre hospitalo-
universitaire Ibn Rochd de Casablanca ont accepté de
participer à notre étude.
Les critères d’inclusion
Patients ayant un âge compris entre 18 et 60 ans, infec-
tés par le VIH, ayant consulté à l’hôpital de jour et qui
ont accepté de répondre oralement à un questionnaire. Les
patients suivis pour une maladie psychiatrique sévère (psy-
chose) ou une déficience mentale ont été exclus de notre
étude.
Moyens d’évaluation
Un questionnaire préétabli par les auteurs a per-
mis d’identifier les caractéristiques sociodémographiques,
ainsi que des renseignements concernant l’infection à
VIH, la sexualité et la prévention du VIH. Le diag-
nostic des troubles sexuels est fait selon les critères
du DSM-IV.
Analyse statistique
La saisie et l’analyse des données sont effectuées en utili-
sant le SPSS.
Résultats
Caractéristiques sociodémographiques
La moyenne d’âge était de 38 ans (18—60 ans) avec une
légère prédominance féminine (54 %). Soixante-huit (51 %)
patients étaient sans travail et 39 % analphabètes. Quatre-
vingt-huit patients (66 %) vivaient avec leurs parents ou en
couple.
Résultats liés à l’infection à VIH
La durée moyenne de suivi était de soixante mois (1—12 ans).
Soixante patients (48 %) étaient au stade C de l’infection à
VIH. Cent sept patients (80 %) étaient sous thérapie antiré-
trovirale et 80 % avaient une charge virale indétectable.
Résultats liés à l’addiction
L’addiction au tabac est rapportée surtout par les hommes,
dans 73 % des cas et celle à l’alcool dans 16 % des cas ; 41 %
des femmes avaient un partenaire sexuel stable contre 47 %
des hommes.
Résultats liés à la sexualité
Quatre-vingt-quatre patients de notre étude (70 %) ont
annoncé leur séropositivité à leurs partenaires. Toutes les
femmes qui ont maintenu une activité sexuelle ont des
rapports hétérosexuels et 14,51 % des hommes avaient des
relations sexuelles avec d’autres hommes. La sérologie du
partenaire était inconnue dans la majorité des cas (65 % des
cas), alors qu’elle était connue dans 35 % des cas : positive
dans 16 % des cas et négative dans 19 % des cas.
Une activité sexuelle était maintenue par 56 % des
femmes et 58 % des hommes. Quatre-vingt-quatorze patients
soit 70 % affirment ne pas avoir une activité sexuelle satis-
faisante (Tableau 1). Quarante-deux pour cent des hommes
rapportent l’abstinence sexuelle, liée principalement aux
croyances religieuses et à un sentiment de culpabilité.
Les troubles sexuels ont été dominés par les troubles de
l’éjaculation (18 %) et de l’érection (17 %) qui étaient rap-
portées à l’asthénie physique liée à l’infection à VIH et à la
peur de contaminer le partenaire (Tableau 2).
Cinquante femmes (68 %) rapportent des troubles sexuels
notamment l’abstinence sexuelle, notée dans 44 % des cas
qui était liée aux croyances religieuses dans 28 % des cas et
au sentiment de culpabilité dans 17 % des cas.
Les autres troubles étaient représentés par le trouble du
désir (23 %), suivi par la dyspareunie (12 %). Ces troubles
étaient rapportés essentiellement au fait que la sexualité
leur rappelle la maladie et à la peur de contaminer leur
partenaire (Tableau 3).
Ces troubles existaient avant le diagnostic dans seule-
ment 8 % des cas. Vingt femmes (30 %) affirment que leurs
troubles se sont améliorés après le démarrage du trai-
tement antirétroviral contre six patients (10 %) hommes.
Soixante-dix-neuf patients (59 %) utilisent systématique-
ment le préservatif lors des rapports sexuels.
Le sujet de la sexualité a été abordé par le médecin trai-
tant dans 45 % des cas, par les éducateurs thérapeutiques
dans 50 % des cas et par la psychologue et le psychiatre dans
30 % des cas.

190 M.E. Fane et al.
Tableau 1 Résultats liés à la sexualité.
Femme Homme
Nombre % Nombre %
Partenaire
Unique 29 40,27 29 47
Sans 29 40,27 22 36
Multiple 14 19 10 17
Orientation sexuelle
Hétérosexuel 72 100 53 85,48
Homosexuel 0 0 4 6,45
Bisexuel 0 0 5 8,06
Statut sérologique du partenaire
Négative 12 17 14 22
Positive 9 12 12 20
Maintien d’une activité sexuelle 40 56 36 58
Satisfaction sexuelle 22 30 22 36
Trouble sexuel actuel 50 69 50 80
Trouble sexuel avant le diagnostic 57610
Amélioration des troubles sexuels après ARV 22 30 6 10
Prévention secondaire
Systématique 41 66 38 61,29
Discontinue 21 34 24 38,71
Tableau 2 Troubles sexuels chez les femmes.
Troubles Nombre % Raisons %
Abstinence
sexuelle
32 44 Interdit religieux 28
Sentiment de culpabilité 17
Peur de contaminer le partenaire 10
Difficulté à trouver un partenaire 8
Autres La sexualité rappelle la maladie 21
Trouble de désir 16 22,22 Peur de contaminer le partenaire 18
Dyspareunie 8 11,11 Utilisation du préservatif 16
Absence de plaisir 6 8,33 Précarité 10
Absence d’orgasme 6 8,33 Hostilité envers le partenaire 10
Tableau 3 Troubles sexuels chez les hommes.
Troubles Nombre % Raisons %
Abstinence
sexuelle
26 42 Interdit religieux 25
Sentiment de culpabilité 10
Peur de contaminer le partenaire 5
Autres Asthénie physique liée au VIH 20
Trouble d’éjaculation 11 18 Peur de contaminer le partenaire 18
Trouble érectile 11 17 La sexualité rappelle la maladie 10
Trouble désir 9 15 Utilisation du préservatif 5
Discussion
L’infection à VIH est une maladie chronique affectant tous
les domaines de la vie individuelle et sociale, que ce soit par
le retentissement physique et psychologique de la maladie,
la vie affective et sexuelle, par les difficultés de l’insertion
sociale et professionnelle (Préaua et Morina, 2005).
La sexualité des PVVIH, confrontés aux contraintes
d’une maladie grave, de son traitement et aux risques
de transmission et d’exclusion est fortement perturbée

Qualité de vie sexuelle chez les personnes vivant avec le VIH 191
Tableau 4 Prévalence des troubles sexuels selon les études (Lallemand et al., 2002 ; Lert et al., 2004 ; Troussier et Tourette-
Turgis, 2006).
Lallemand (%) Lert (%) Notre série (%)
Activité sexuelle maintenue — 60 57—
Trouble sexuel actuel 71 35- 44 75
Trouble sexuel avant le diagnostic 18 — 9
Trouble sexuel avant la trithérapie 32 — —
comme l’a montré l’enquête VESPA (Schiltz et al.,
2006).
Les premières études publiées sur la sexualité et la
séropositivité montrent que la séropositivité affecte la vie
sexuelle des personnes séropositives, avec des difficultés
d’annoncer le statut sérologique au partenaire. Quatre-
vingt-quatre patients de notre étude (70 %) ont annoncé leur
séropositivité à leurs partenaires.
Dans notre étude, 64 % des hommes affirment ne pas avoir
une activité sexuelle satisfaisante et 80 % rapportent des
troubles sexuels notamment le dysfonctionnement érectile.
Une étude conduite en France (Lallemand et al., 2002)
auprès de 156 patients de sexe masculin sous traitement
antirétroviral, montre que 71 % rapportent des troubles
sexuels (perte de libido, troubles de l’érection, difficul-
tés lors de l’orgasme) sachant que 18 % d’entre eux avaient
déjà ce problème avant de connaître leur séropositivité et
32,4 % avant la prise d’un traitement antirétroviral. Ce qui
concorde avec nos résultats (Tableau 4).
Dans l’enquête Vespa (Lert et al., 2004) conduite en
France, 35 à 44 % des personnes séropositives sous traite-
ment déclarent avoir des troubles de la sexualité. Soixante
pour cent déclarent avoir des relations sexuelles avec un
partenaire ou une partenaire stable, parmi lesquelles 32 à
45 % disent avoir eu des ruptures de prévention.
Dans la littérature, il y a très peu de données concernant
la sexualité des femmes vivant avec le VIH (Luzi et Guaraldi,
2009). Les femmes consultent principalement autour du
désir d’enfant, peu de consultations concernent la sexualité
et le désir (Rochet, 2006).
Une étude anglaise (Keegan et al., 2005) auprès de
21 femmes séropositives démontre l’impact négatif de la
séropositivité sur la qualité de leur vie sexuelle (baisse de
libido, réduction du plaisir sexuel, difficultés à trouver des
partenaires, ainsi qu’en matière de prévention (difficultés
à négocier l’usage du préservatif, peur du rejet si elles
informent leurs partenaires de leur statut sérologique).
D’autres études ont trouvé que 63,4 % des femmes vivant
avec le VIH déclarent que leurs pratiques sexuelles ont
changé, 74,6 % affirment que leur vie intime est globalement
moins satisfaisante et la moitié des femmes séropositives
ont une vie sexuelle peu ou pas active.
Dans notre étude, 70,5 % des patientes affirment ne
pas avoir une activité sexuelle satisfaisante et 69 % rap-
portent des troubles sexuels, notamment baisse de la
libido, anorgasmie et dyspareunie. Les résultats de notre
étude sont relativement élevés par rapport aux études
menées dans les pays occidentaux, cette légère augmenta-
tion est probablement liée à des considérations religieuses
et sociales qui interdisent toute relation sexuelle hors du
mariage.
Les troubles sexuels peuvent être engendrés par l’impact
psychologique du caractère sexuellement transmissible du
VIH (culpabilité, peur de contaminer), par la baisse du taux
de certaines hormones, par une dépression, ou par les trai-
tements. De possibles carences en vitamines et minéraux
peuvent aggraver la situation (Guaraldi, 2007). Les troubles
sont plus importants chez les personnes traitées quel que
soit la combinaison (Lallemand, 2002). Les troubles érec-
tiles sont plus fréquents chez les hommes traités par les
inhibiteurs de protéase (Moreno-Perez, 2010). L’impact des
traitements antirétroviraux dans ces dysfonctions serait plu-
tôt lié aux effets indésirables globaux et au stress que peut
représenter la prise de médicaments (Lallemand, 2002).
D’autres études ont montré que les changements corpo-
rels sont les déterminants majeurs des dysfonctionnements
sexuels chez les PVVIH (Luzi et Guaraldi, 2009).
Dans notre étude, 73 % des patients hommes ont une
addiction actuelle au tabac, et 16,3 % à l’alcool ce qui peut
expliquer le taux élevés des troubles sexuels car les fumeurs
ont quatre fois plus de risques de devenir «impuissants »que
les non-fumeurs. En plus l’alcool provoque une carence en
vitamines B et une chute du taux de testostérone qui est
nécessaires à la sexualité (Kaplan et al., 1985).
Les messages de prévention mettent l’accent sur les
risques d’infection (ou de surinfection) associés à l’activité
sexuelle et recommandent l’utilisation systématique de pré-
servatifs. Parmi les femmes séropositives, 42 % déclarent
des rapports non protégés avec le partenaire stable et 29 %
des rapports non protégés avec des partenaires occasion-
nels. Parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes, 40 % déclarent des rapports non protégés avec le
partenaire stable et 23 % des rapports non protégés avec des
partenaires occasionnels (Lert et al., 2004).
Une étude conduite en Californie auprès de 145 couples
hétérosexuels sérodiscordants montre que 45 % de ces
couples déclarent avoir eu des relations sexuelles vaginales
ou anales non protégées au cours des derniers six mois
(Buchacz et al., 2001). Dans notre étude 59 % des inclus
seulement utilisent systématiquement le préservatif lors des
rapports sexuels : le recours systématique au préservatif est
souvent vécu comme une limitation frustrante de la spon-
tanéité et de la fantaisie dans les rapports sexuels, ce qui
constitue un grand problème en terme de prévention.
Conclusion
Cette étude témoigne de l’importance des troubles sexuels
chez les PVVIH. Dans le cadre de la prise en charge globale de
ces patients, les cliniciens doivent explorer/interroger leurs
patients quant à leur vie affective et sexuelle. L’existence

192 M.E. Fane et al.
de troubles sexuels qu’ils soient ou non liés au VIH doit être
prise en considération par les soignants afin de réduire leur
impact négatif aussi bien sur la qualité de vie des patients
que sur leurs conduites de prévention.
Conflit d’intérêt
Aucun.
Références
Buchacz K, Van der Straten A, Saul J, Shiboski SC. Sociodemogra-
phic, behavioral, and clinical correlates of inconsistent condom
use in HIV-serodiscordant heterosexual couples. J Acquir Immune
Defic Syndr 2001;28(3):289—97.
Guaraldi G. Sexual dysfunction in HIV-infected men: role of antire-
troviral therapy, hypogonadism and lipodystrophy. Antivir ther
2007;12(7):1059—65.
Kaplan HS, Sager CJ, Schiavi RC. AIDS and the sex therapist. J Sex
Marital Ther 1985;11(4):210—4.
Keegan A, Lambert S, Petrk J. Sex and relationships for HIV-positive
women since HAART: a qualitative study. AIDS Patient Care STDS
2005;19(10):645—54.
Lallemand F, Salhi Y, Linard F, Giami A, Rozenbaum W. Sexual
dysfunction in 156 ambulatory HIV-infected men receiving
highly active antiretroviral therapy combinations with and
without protease inhibitors. J Acquir Immune Defic Syndr
2002;30(2):187—90.
Lert F, Obadia Y, et al. Comment vit-on en France avec le VIH/sida ?
Popul Soc 2004:406.
Luzi K, Guaraldi G. Body image is a major determinant of
sexual dysfunction in stable HIV-infected women. Antivir Ther
2009;14(1):85—92.
Moreno-Perez. Risk factor for sexual and erectile dysfunction
in HIV-infected men/the role of protease inhibitors. AIDS
2010;24(2):255—64.
Préaua N, Morina M. L’évaluation psychosociale de la qualité
de vie des personnes infectées par le VIH. Prat Psychol
2005;11(4):340—87.
Rochet S. Consultation sexologique chez des patients
VIH+ ou co-infectés VHB-VHC. Sexologies 2006;15(3):
210—9.
Schiltz MA, Bouhnik A, Préau M, Spire B. La sexualité des personnes
atteintes par le VIH : l’impact d’une infection sexuellement
transmissible. Sexologies 2006;15(3):157—64.
Troussier T, Tourette-Turgis C. La qualité de la vie sexuelle et affec-
tive favorise la prévention chez les personnes vivant avec le VIH.
Sexologies 2006;15(2):165—75.
1
/
5
100%