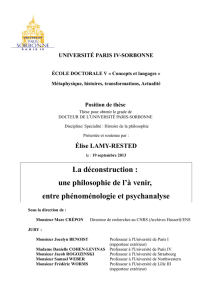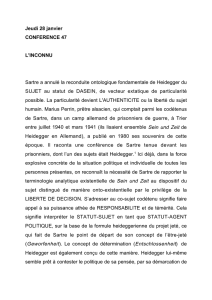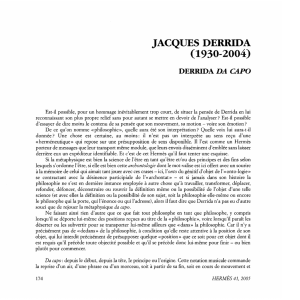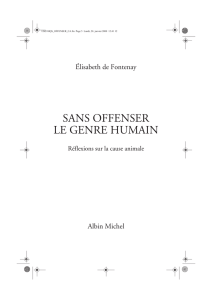DÉCONSTRUCTION :

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II – LE MIRAIL
UNIVERSITÉ CHARLES DE PRAGUE
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
FERNANDO FACO DE ASSIS FONSECA
DÉCONSTRUCTION :
Un geste de résistance
Toulouse 2010

2
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II – LE MIRAIL
UNIVERSITÉ CHARLES DE PRAGUE
UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
Master 2
ERASMUS MUNDUS EUROPHILOSOPHIE
Fernando FACO DE ASSIS FONSECA
DECONSTRUCTION: UN GESTE DE RESISTANCE
Mémoire de recherche dirigé par Jean-Marie Vaysse.
Soutenu le 18 juin 2009.

3
RÉSUMÉ
Il s‟agit de comprendre la déconstruction chez Derrida fondamentalement comme un geste de
résistance contre toute sorte de totalitarisme. En ce sens, dés que l‟objectif présent ici infère
qu‟il y ait déjà un contenu politique propre à la déconstruction, notre tâche consiste, à cet
égard, en travailler cela plutôt comme un point d‟arrivée et non comme un point de partie. En
d‟autres termes, l‟idée générale de cette recherche a pour fonction développer, d‟une façon
bien structurée, un chemin où la déconstruction va être pensée d‟un point de vue foncièrement
politique, ayant toujours comme but de la comprendre comme un mouvement assez particulier
de résistance. Pour tel but il faut, avant tout, comprendre deux autres champs fondamentaux
du travail de la déconstruction, dont un apparemment théorique et l‟autre apparemment
pratique. C‟est pourquoi il faut absolument penser l‟idée de futur en tant qu‟ « à venir » ou
comme promesse, et aussi l‟idée de l‟autre comme une altérité radicale, c'est-à-dire comme
trace. Finalement on peut penser comment la déconstruction s‟engage effectivement dans un
mouvement politique et propose, ainsi, une sorte de résistance qui ne soit pas un mouvement
d‟opposition quelconque, mais essentiellement un mouvement qui déconstruit la
métaphysique (ici formellement identique au système totalitaire) à partir de son propre excès.
Autrement dit, la résistance ne vient pas ici du dehors, comme une sorte de mécanisme
extérieur au système métaphysique, mais plutôt comme la production propre de ce système
qui le conduit à sa propre déconstruction. La déconstruction en tant que résistance signifie, en
un seul mot, la libération du système de son axe central, produisant, ainsi, des différences
avec soi-même et se déplaçant, ainsi, dans un mouvement continuel, au-delà de toute attente,
d‟où il n‟y a ni d‟origine ni de télos.
Mots clés : déconstruction, résistance, altérité, « à venir », promesse.

4
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 6
DE QUEL AVENIR…? LE PROGRAMME ET LA PROMESSE DANS LA PENSÉ DE DERRIDA ............................. 11
L'idée même d' "à venir" ................................................................................................................. 11
Le futur et l“à venir“ .................................................................................................................. 11
La pensée de la présence ............................................................................................................. 12
Ousia et Grammè ....................................................................................................................... 15
La Phoné et l‘Ecriture ................................................................................................................ 16
La dangereuse écriture ............................................................................................................... 17
La trace ................................................................................................................................... 19
La différance ............................................................................................................................. 20
La Promesse d‟un à venir ................................................................................................................ 22
La folle loi ................................................................................................................................ 25
Le devoir devant la loi ................................................................................................................ 28
QUI ARRIVE…? L‟AUTRE ET L‟ÉTHIQUE DE L„IMPOSSIBLE .................................................................. 32
L’arrivée de l‘autre .................................................................................................................... 32
Penser l‘impossible .................................................................................................................... 35
L’autre qui donc je suis ............................................................................................................... 37
De l’hôte à la condition d‘otage .................................................................................................... 39
L’heritage et le “oui“ de la responsabilité ...................................................................................... 41
DE QUEL POLITIQUE…? AMITIÉ, DÉMOCRATIE ET JUSTICE CHEZ DERRIDA ........................................... 43
De passage en Egypte ................................................................................................................. 44
Politique de l‘amitié ................................................................................................................... 46
Ami/Ennemi chez Carl Schmitt ..................................................................................................... 48
L’ennemi pur et ses contradictions ................................................................................................ 50
L’ami pur et ses possibilités ......................................................................................................... 53
Pourquoi la démocratie? ............................................................................................................. 58
Démocratie et sécret ................................................................................................................... 60
Déconstruction et démocratie ....................................................................................................... 61
Droit et justice .......................................................................................................................... 63
Retour à l‘Egypte ............................................................................... Erreur ! Signet non défini.

5
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................ 67
Œuvres de Derrida.................................................................................................................. 67
Littérature secondaire ........................................................................................................... 67
Autres œuvres ........................................................................................................................ 68
Film ........................................................................................................................................ 68
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
1
/
68
100%