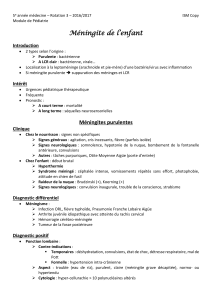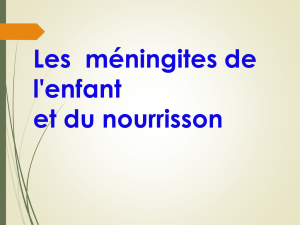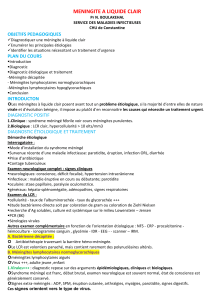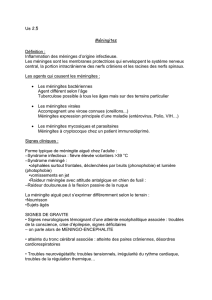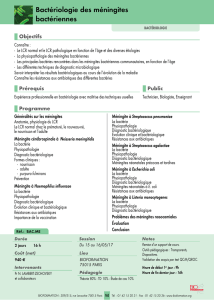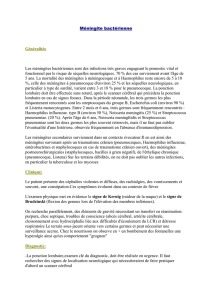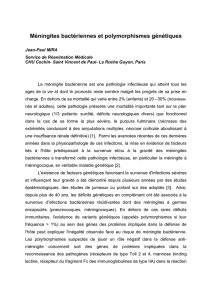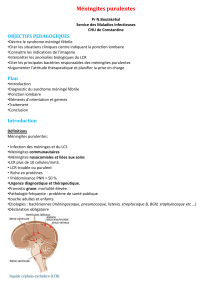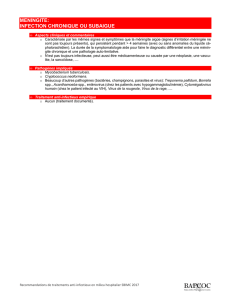Méningites aiguës - Psychologie

Méningites aiguës
F Bruneel
M Wolff
Résumé. –Les méningites aiguës sont toujours une urgence diagnostique et thérapeutique. Les causes de
méningites aiguës sont très nombreuses, en majorité de nature infectieuse, dominées par les méningites
purulentes de par leur gravité potentielle. Nous décrivons dans cet article les principales données actuelles
(étiologie et épidémiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic, traitement) permettant de mieux
comprendre cette maladie afin de tenter d’en améliorer la prise en charge.
©2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Introduction
La méningite aiguë correspond à une inflammation aiguë de
l’arachnoïde, de la pie-mère et du liquide céphalorachidien (LCR).
Ce processus inflammatoire s’étend dans tout l’espace sous-
arachnoïdien du cerveau à la moelle épinière et se caractérise par la
présence d’un nombre augmenté de globules blancs dans le LCR. Le
tableau clinique de méningite aiguë est dominé par un syndrome
méningé fébrile évoluant en quelques heures à quelques jours. Ce
tableau doit être différencié, ce qui se révèle parfois plus théorique
que pratique, du tableau de méningoencéphalite dominé par les
signes cliniques d’encéphalite, mais aussi des méningites chroniques
qui se révèlent en quelques semaines à quelques mois, avec un LCR
restant anormal souvent plus de 1 mois. Cependant, certains micro-
organismes peuvent être à l’origine des trois tableaux, ce qui
souligne les limites et les recouvrements de cette classification. Au
plan étiologique, de nombreux agents infectieux, mais aussi une
multitude de processus non infectieux, peuvent être à l’origine d’un
tableau de méningite aiguë (tableau I). Enfin, le terme de méningite
aseptique, utilisé surtout par les Anglo-Saxons, traduit un tableau
clinique de méningite mais sans qu’il soit possible de mettre en
évidence de bactérie pathogène dans le LCR.
Nous traiterons ici des causes bactériennes et virales les plus
fréquentes des méningites aiguës, à l’exclusion des causes
parasitaires, des méningoencéphalites et des méningites chroniques.
La méningite tuberculeuse et les méningites à spirochètes peuvent
parfois se présenter sous la forme d’une méningite aiguë, mais ne
seront pas traitées en détail. Les cas de l’enfant et du patient
séropositif pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ne
seront pas détaillés dans ce chapitre.
Épidémiologie et étiologie
MÉNINGITES AIGUËS VIRALES
C’est la première cause de méningite aiguë, mais il est difficile
d’avancer des données épidémiologiques précises, compte tenu de
Fabrice Bruneel : Chef de clinique assistant des hôpitaux de Paris.
Michel Wolff : Professeur des Universités, praticien hospitalier des hôpitaux de Paris.
Clinique de réanimation des maladies infectieuses, service du professeur François Vachon, groupe hospitalier
Bichat-Claude Bernard, 46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris cedex 18, France.
l’absence de déclaration obligatoire et d’une probable sous-
estimation en rapport avec une moindre gravité. En pratique, il
s’agit de la première cause de méningite aseptique, le diagnostic
étant fortement suspecté en cas de LCR clair, stérile,
normoglycorachique avec une cellularité à nette prédominance
lymphocytaire. Dans ces cas où l’évolution est le plus souvent
bénigne, on ne réalise que rarement de recherche virale détaillée.
Cependant, l’application des nouvelles techniques, notamment de la
réaction en chaîne de la polymérase (PCR), peut probablement
permettre de trouver l’agent étiologique dans environ 50 % des
cas
[4]
. Les principaux virus en cause sont décrits ci-dessous
[43]
.
¶Entérovirus
C’est la première cause virale de méningite aiguë, puisqu’elle
représente environ 80 % des cas où un pathogène est isolé. Ces virus
se retrouvent dans le monde entier et atteignent plus
particulièrement les petits enfants. Il s’agit essentiellement
d’échovirus (sérotypes 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 30) et de virus Coxsackie
(sérotypes B1, B2, B3, B4, B5, A9).
¶Virus ourlien
Lors de la maladie déclarée, ce qui concerne donc une population
non immunisée, une méningite aiguë symptomatique est retrouvée
dans 10 à 30 % des cas
[43]
.
¶Virus du groupe Herpès
Il s’agit surtout des virus Herpès simplex 1 et 2, du cytomégalovirus
(CMV), du virus Epstein-Barr (EBV), du virus varicelle-zona (VZV)
et du virus Herpès 6 (HHV6 : human herpes virus). Les virus de ce
groupe semblent impliqués dans 0,5 à 3 % des méningites
aseptiques. La méningite aiguë à CMV ou à EBV est volontiers
associée à un syndrome mononucléosique. Les virus Herpès simplex
et EBV peuvent être impliqués dans certains cas de méningites
récurrentes (méningite de Mollaret)
[13]
.
¶Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
Il faut savoir penser, en fonction du contexte, à une primo-infection
par le VIH devant une méningite aiguë virale, puisqu’elle est
présente dans environ 24 % des cas
[31]
.
¶Autres virus
D’autres virus, plus rares en France et en Europe, peuvent être
discutés devant un tableau de méningite virale en fonction du
Encyclopédie Médico-Chirurgicale 17-160-C-10
17-160-C-10
Toute référence à cet article doit porter la mention : Bruneel F et Wolff M. Méningites aiguës. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Neurologie, 17-160-C-10, 2000, 12 p.

contexte et des circonstances : arboviroses, virus de la
chorioméningite lymphocytaire, poliovirus, adénovirus, parvovirus
B19.
MÉNINGITES AIGUËS BACTÉRIENNES OU PURULENTES
¶Méningites purulentes communautaires
On estime actuellement que 1 million de nouveaux cas de
méningites bactériennes communautaires surviennent tous les ans
dans le monde. L’incidence annuelle des méningites purulentes
communautaires en France était estimée à 22,5 cas/million
d’habitants en 1993
[5]
. Les pays en développement connaissent
l’incidence la plus élevée et la mortalité la plus lourde. (mortalité
moyenne de l’ordre de 20 %, dépassant parfois 50 %). En situation
communautaire, les germes les plus fréquents restent Neisseria
meningitidis,Streptococcus pneumoniae,Hæmophilus influenzae, suivis
de Listeria monocytogenes,Escherichia coli et du streptocoque B.
L’incidence de ces différents micro-organismes varie
considérablement en fonction de l’âge. Dans les pays développés et
hors épidémie, chez le nouveau-né, E. coli,L. monocytogenes et le
streptocoque B sont prépondérants (par ordre de fréquence
croissante). Entre 1 mois et 15 ans, H. influenzae prédomine sur le
méningocoque, suivi du pneumocoque. Néanmoins, on peut penser
que la fréquence de l’Hæmophilus risque de baisser dans les années
à venir, en conséquence de l’extension du vaccin contre Hæmophilus
de type B. Chez l’adulte jeune, le pneumocoque devance le
méningocoque. Au-delà de 60 ans, on retrouve surtout le
pneumocoque, prépondérant sur L. monocytogenes et H. influenzae.
Les agents bactériens autres que H. influenzae,S. pneumoniae et N.
meningitidis ne représentent que 20 à 30 % des isolements. Certaines
particularités épidémiologiques concernant les principaux micro-
organismes méritent d’être précisées.
Pneumocoque
La méningite à pneumocoque a une incidence annuelle de 1 à
2/100 000 dans les pays développés, alors qu’elle peut atteindre
jusqu’à 20/100 000 dans les pays en développement. La mortalité
des méningites à pneumocoque est d’environ 20 %. Les
complications sont fréquentes (près de 50 % des cas). Certains
sérotypes, retrouvés aussi plus fréquemment au cours des
bactériémies à pneumocoque, sont responsables des méningites
purulentes. On retrouve souvent d’autres sites d’infection : otite
moyenne aiguë, mastoïdite, sinusite, pneumonie, endocardite. Les
méningites à pneumocoque sont particulièrement graves sur terrain
à risque : splénectomie ou asplénie fonctionnelle (notamment
drépanocytose), alcoolisme, hypogammaglobulinémie, myélome
multiple, cancer, diabète, insuffisance rénale chronique, cirrhose. Le
pneumocoque est la bactérie le plus fréquemment retrouvée lors des
méningites purulentes sur brèche ostéoméningée (volontiers
récidivantes).
L’augmentation des cas de méningites dus à des souches de
pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline (PRP)
(tableau II) est un problème préoccupant
[11]
. La fréquence des
souches de PRP est inégalement répartie en Europe : 0,8 % en Italie,
5 % en Allemagne, jusqu’à 40 % en Espagne et en Hongrie. En
France, l’étude de 1 023 souches de pneumocoque isolées de LCR,
de 1987 à 1994, a permis de mettre en évidence 18,1 % de PRP dont
49,7 % étaient des souches à haut niveau de résistance. De plus, la
fréquence de la résistance augmente progressivement de 1987 (5,7 %
des souches) à 1994 (27,1 % des souches). Parmi les 60 PRP isolés du
LCR en 1994, 35 % sont de résistance à bas niveau à la céfotaxime et
3,3 % sont résistants à haut niveau
[23]
. Les facteurs de risque de PRP
sont :
– l’âge (moins de 15 ans) ;
Tableau I. – Étiologie des méningites aiguës.
• Bactéries
Neisseria meningitidis Staphylococcus epidermidis Acinetobacter baumannii
Streptococcus pneumoniæ Enterococcus faecalis fv;11Salmonella spp.
Hæmophilus influenzæ Propionibacterium acnes Nocardia spp.
Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Mycobacterium tuberculosis
Streptococcus agalactiæ Klebsiella pneumoniæ Brucella spp.
Escherichia coli Pseudomonas æruginosa Mycoplasma spp.
• Méningite bactérienne décapitée
• Virus
Entérovirus Herpès simplex virus 1 et 2
Virus des oreillons VIH1, VIH2 Cytomégalovirus
Adénovirus Poliovirus Epstein-Barr virus
Virus varicelle-zona
• Rickettsies
Rickettsia spp. Ehrlichia spp.
• Spirochètes
Treponema pallidum (syphilis) Borrelia burgdorferi Leptospira spp.
• Champignons
Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum
Coccidioides immitis Candida spp.
• Parasites
Naegleria fowlei Angiostrongylus cantonensis Strongyloides stercoralis
• Autres syndromes infectieux (dont foyers paraméningés)
Abcès cérébral Mastoïdite Ostéomyélite crânienne
Sinusite Empyème Endocardite
Otite Thrombophlébite Syndromes postviraux
Syndromes postvaccination
• Tumeurs et kystes cérébraux
• Médicaments
Cotrimoxazole, ciprofloxacine, b-lactamines, isoniazide carbamazépine, neuroleptiques, cytosine
arabinoside, anti-inflammatoires non stéroïdiens, OKT3,
azathioprine, immunoglobulines polyvalentes
• Maladies systémiques
Lupus érythémateux disséminé Maladie de Behçet Syndrome de Koyanagi-Harada
• Après certaines procédures
Après neurochirurgie Après injection intrathécale
Après injection péridurale Après infiltrations (papaïne)
• Divers
Postconvulsions Néoplasies
Migraine Méningite de Mollaret
VIH : virus de l’immunodéficience humaine.
17-160-C-10 Méningites aiguës Neurologie
2

– l’administration préalable d’antibiotiques notamment de
â-lactamines ;
– l’hospitalisation récente et prolongée ;
– l’immunodépression (dont VIH) ;
– la provenance d’un pays à haut risque (Espagne, Hongrie) ;
– les professions exposées (crèche, école) ;
– l’infection par les sérotypes 14 ou 23.
Hæmophilus influenzae
Les souches responsables de méningite purulente sont capsulées, le
plus souvent de type B (HIB). HIB était l’agent le plus fréquent des
méningites du jeune enfant (hors épidémie). L’incidence générale
annuelle est de1à3/100000. La mortalité est de l’ordre de5à10%,
plus élevée dans les pays en développement. Les séquelles sont
observées dans 10 à 30 % des cas, la plus fréquente étant la surdité.
En termes de résistance aux antibiotiques, le problème principal est
celui de la résistance à l’ampicilline qui est actuellement en France
de l’ordre de 40 à 50 %
[14]
. Cependant, l’introduction dans les pays
développés du vaccin contre HIB a profondément modifié la
physionomie des méningites purulentes, puisque ce vaccin a permis,
dans une étude réalisée aux États-Unis, de diminuer le nombre de
cas de méningite à Hæmophilus de 94 % entre 1986 et 1995, et de
déplacer l’âge médian des patients atteints de méningite purulente
de 15 mois à 25 ans
[45]
. Les conséquences à plus long terme de la
vaccination ne sont pas encore évaluées et vont dépendre de la
qualité de la protection vaccinale : si celle-ci s’atténue avec le temps,
l’incidence de la méningite à H. influenzae pourrait augmenter chez
l’adulte. De plus, l’émergence de souche non capsulées invasives
pourrait être favorisée.
Méningocoque
En situation non épidémique, le méningocoque est la cause de 10 à
40 % des méningites purulentes, avec une incidence annuelle de
0,8/100 000 en France tous âges confondus, de l’ordre de 1 à
5/100 000 dans les pays développés, jusqu’à 20/100 000 dans les
zones arides de l’Afrique sub-saharienne. La mortalité en France est
de l’ordre de 10 %. Le méningocoque du groupe A est la principale
cause des épidémies. Le sérogroupe B est prédominant en Europe
(60 % des souches françaises) et donne la majorité des cas
sporadiques ainsi que quelques bouffées épidémiques. La tendance
actuelle est à l’augmentation de la fréquence du sérogroupe C
depuis 1980 (40 % des souches françaises en 1991). Il pourrait être
associé à une proportion plus élevée de purpura fulminans, voire à
une plus grande létalité
[36]
. Les déficits de certains facteurs du
complément, les déficits en properdine ou en certaines sous-classes
d’immunoglobulines sont des facteurs favorisant la survenue des
méningites à méningocoque
[5]
. Le risque épidémique est maximal
chez les sujets vivant en communautés fermées (pensionnaires,
militaires) puisque les sujets vivant au contact d’un patient atteint
ont un risque 600 à 1 000 fois plus élevé de présenter une infection.
Le méningocoque est une espèce qui reste particulièrement sensible
aux antibiotiques. Néanmoins, certaines souches de méningocoque
(environ 15 % en France, toutes infections comprises) ont une
sensibilité diminuée à la pénicilline
[14]
. Concernant les souches
impliquées dans les méningites, une récente étude française retrouve
22 % de souches de sensibilité modérément diminuée à la
pénicilline
[50]
. Ce phénomène, qui semble s’accroître avec le temps,
mérite une surveillance rapprochée. À noter de plus la mise en
évidence très récemment de 11 souches (dont une en France)
hautement résistantes au chloramphénicol
[20]
.
Listeria
[4, 14, 37]
Dans les méningites de l’adulte, il s’agit le plus souvent du
quatrième germe, responsable d’environ 8 % des méningites
bactériennes avec une incidence annuelle de 0,2/100 000 et une
mortalité de 27 %
[4, 14]
. La population est essentiellement les
nouveau-nés et les sujets de plus de 60 ans
[45]
. Environ un tiers des
infections à L. monocytogenes sont neuroméningées. De 20 à 36 %
des patients sont exempts de pathologie sous-jacente. La présence
d’une leucémie, d’un sida ou d’une greffe rénale multiplie par plus
de 1 000 le risque de listériose
[28]
. L’alimentation peut intervenir
dans les épidémies (fromage en Suisse) mais aussi dans la survenue
de cas sporadiques (consommation de lait non pasteurisé au
Danemark) : ceci justifie une enquête alimentaire, voire
l’identification précise des souches. Il existe de très rares souches
multirésistantes ou résistantes à l’ampicilline in vitro, sans que ce
phénomène n’ait de conséquence clinique. Néanmoins, il faut
rappeler que Listeria est naturellement résistante aux
céphalosporines et aux fluoroquinolones. Par ailleurs, il existe
plusieurs souches résistantes chez d’autres espèces de Listeria
(isolées notamment des aliments), ce qui pourrait constituer un
réservoir de résistance, soulignant un potentiel d’évolution vers la
résistance
[14]
.
Autres germes
En situation communautaire, les autres germes sont rares. Survenant
le plus souvent sur un terrain fragilisé ou dans des circonstances
particulières, il s’agit surtout d’entérobactéries (diabète, alcoolisme,
sujets âgés, états septicémiques, immunodéprimé, anguillulose
maligne) et du staphylocoque doré (diabète, cancer, insuffisance
rénale, endocardite associée). La mortalité de ces méningites est en
règle élevée (20 à 50 %), souvent à rattacher au terrain sous-jacent.
¶Méningites purulentes nosocomiales
C’est une population particulière à ne pas négliger, puisque dans
une étude réalisée à Boston les méningites purulentes nosocomiales
représentent jusqu’à 40 % des épisodes de méningites purulentes,
responsables d’une mortalité de l’ordre de 35 %
[17]
. Les germes en
cause sont essentiellement des bacilles à Gram négatif (pyocyanique,
entérobactéries), fréquents en postopératoire de neurochirurgie ;
mais aussi des staphylocoques (volontiers S. epidermidis),
particulièrement après mise en place d’un cathéter cérébral
intraventriculaire.
Physiopathologie
MÉNINGITE AIGUË VIRALE
[10, 43]
¶Phase initiale de l’infection
Le virus colonise tout d’abord une des muqueuses de l’organisme,
en fonction de son tropisme (par exemple muqueuse orodigestive
pour les entérovirus). S’il réussit ensuite à échapper aux mécanismes
locaux de défense (mécaniques, chimiques, macrophages,
immunoglobulines [Ig] A sécrétoires), il peut alors se répliquer
localement au niveau de la porte d’entrée, dans les cellules de la
muqueuse, dans les capillaires lymphatiques et dans les cellules
endothéliales alentour.
¶Invasion du système nerveux central
Le virus dissémine ensuite par voie sanguine (phase de virémie) et
envahit le parenchyme cérébral en traversant la barrière
Tableau II. – Résistance du pneumocoque aux â-lactamines.
S I (BNR) R (HNR)
Pénicilline G CMI ≤0,06 mg/L [0,12-1 mg/L] >1mg/L
Amoxicilline
Céfuroxime
Céfotaxime
Ceftriaxone
Imipenem
Céfépime
Cefpirome
CMI ≤0,5 mg/L [1-2 mg/L] >2mg/L
S : sensible ; I : intermédiaire ; R : résistant ; CMI : concentration minimale inhibitrice ; BNR : bas niveau de
résistance ;HNR :hautniveauderésistance.Lespneumocoquesditsrésistantsàunantibiotiquesontceuxquisont
IouR.
Neurologie Méningites aiguës 17-160-C-10
3

hématoméningée par plusieurs mécanismes : infection des cellules
endothéliales des vaisseaux cérébraux, infection des cellules de la
glie, traversée de la barrière hématoméningée dans un leucocyte qui
protège ainsi le virus du système immunitaire, infection des cellules
épithéliales des plexus choroïdes. Certains virus (Herpès simplex,
rage) peuvent atteindre le parenchyme cérébral en remontant les
trajets nerveux.
¶Dissémination au sein du système nerveux
Les virus pénètrent dans l’espace sous-arachnoïdien, via les plexus
choroïdes, puis disséminent dans le LCR en infectant les cellules
méningées et épendymaires, puis peuvent envahir les cellules
cérébrales par contiguïté. Il existe d’autres mécanismes d’invasion
du parenchyme cérébral : dissémination extracellulaire entre les
cellules cérébrales, transport le long des ramifications axonales ou
dendritiques, transport dans les cellules inflammatoires. En réponse
au développement viral, l’organisme développe une réponse
immunitaire et inflammatoire spécifique, essentiellement médiée par
les lymphocytes T (immunité cellulaire prédominante). Il en découle
la synthèse de différentes cytokines avec une chronologie variable :
l’interleukine (IL)-6 commence à augmenter dans le LCR 24 heures
après le début de l’infection virale, l’interféron (IFN)-gamma
augmente rapidement à partir du cinquième ou du sixième jour. La
synthèse d’IL-1-âest fréquente dans le LCR des méningites
aseptiques et est corrélée avec la cellularité. Le tumor necrosis factor
(TNF)-alpha est rarement retrouvé.
Après le développement de la réponse inflammatoire au sein du
LCR, les altérations de la barrière hématoencéphalique permettent
un afflux d’immunoglobulines et de protéines sériques, ainsi qu’une
synthèse locale d’immunoglobulines spécifiques du fait de l’afflux
de lymphocytes B. Une réaction immunitaire normale permet la
guérison. En revanche, c’est en cas de déficit immunitaire que
peuvent se développer des infections virales chroniques.
MÉNINGITE PURULENTE
[38, 41, 55]
¶Colonisation muqueuse et passage dans le LCR
Pour développer une méningite purulente, la bactérie doit être
capable d’envahir le LCR, de s’y multiplier et d’y produire une
inflammation. La première étape réside dans la colonisation de la
muqueuse de l’oropharynx par des bactéries devenant, dans
certaines circonstances encore méconnues, invasives (essentiellement
pneumocoque, méningocoque et Hæmophilus). Celle-ci est facilitée
par plusieurs mécanismes : pili à la surface des bactéries
(méningocoque, Hæmophilus) favorisant la fixation à l’épithélium,
polysaccharide de la capsule (pneumocoque, Hæmophilus), synthèse
de protéases détruisant les IgA sécrétoires. On assiste ensuite à une
phase de bactériémie prolongée, favorisée par l’encapsulation qui
permet aux bactéries d’échapper au complément. Les méninges sont
alors ensemencées par voie hématogène et le LCR est envahi, par
franchissement de la barrière hématoméningée, par deux
mécanismes principaux : directement au niveau de l’endothélium
des capillaires méningés ou par franchissement au niveau des plexus
choroïdes. Les mécanismes impliqués dans la spécificité des
bactéries pour la barrière hématoméningée et dans son
franchissement sont mal connus.
¶Inflammation méningée et altération
de la barrière hématoencéphalique
Une fois qu’elles sont dans le LCR, les bactéries se multiplient
facilement, compte tenu de la faiblesse des mécanismes de défense
(concentrations faibles d’immunoglobulines et de complément). Sous
l’influence de plusieurs facteurs de virulence des bactéries
(lipopolysaccharide, peptidoglycane, acide techoïque), les
macrophages des méninges synthétisent in situ des cytokines,
essentiellement IL-1 et TNF mais aussi IL-6 et IL-8. Ces cytokines
vont induire l’expression de plusieurs adhésines à la surface des
polynucléaires neutrophiles et des cellules endothéliales des veinules
méningées, ce qui aboutit à l’adhérence des polynucléaires aux
cellules endothéliales, puis à l’afflux des polynucléaires dans le LCR.
Les adhésines en cause appartiennent aux familles des
immunoglobulines (ICAM1, ICAM2, PECAM1), des intégrines
(Mac1 ou CR3 ou CD11b/CD18, LFA1 ou CD11a/CD18) et des
sélectines (L-sélectine ou LAM1, P-sélectine ou GMP140 ou CD62,
E-sélectine ou ELAM1). L’IL8 favorise l’activation d’une partie de ce
phénomène. On assiste ensuite à l’altération de la barrière
hématoencéphalique qui relève de plusieurs mécanismes :
diminution de son étanchéité médiée surtout par l’IL-1 en synergie
avec le TNF, favorisant le relâchement des jonctions serrées des
capillaires cérébraux, libération par les polynucléaires activés in situ
par les cytokines de plusieurs médiateurs (notamment radicaux
libres). La perméabilité augmentée de la barrière hémato-
encéphalique permet une exsudation d’albumine responsable de
l’hyperprotéinorachie observée en clinique, et favorise l’afflux de
cellules de l’inflammation qui vont contribuer à majorer la réaction
inflammatoire.
¶Événements tardifs
Les événements qui surviennent ultérieurement sont la conséquence
de l’afflux des polynucléaires et des altérations de la barrière
hématoencéphalique. L’hypertension intracrânienne est
essentiellement en relation avec l’œdème cérébral, mais peut aussi
compliquer une hydrocéphalie et/ou une augmentation du débit
sanguin cérébral. L’œdème cérébral est plurifactoriel : vasogénique
(altération de la barrière hématoencéphalique), directement
cytotoxique (substances et médiateurs synthétisés par les bactéries
et les polynucléaires neutrophiles), interstitiel (par défaut de
résorption du LCR au niveau des villosités arachnoïdiennes pouvant
conduire à une hydrocéphalie). Enfin, l’inflammation méningée peut
aboutir à de profondes altérations vasculaires sur les vaisseaux
méningés, réalisant une véritable vascularite participant à l’anoxie
cérébrale et aux altérations du débit sanguin cérébral.
Clinique
MÉNINGITE VIRALE
[43, 53]
¶Présentation générale et signes neurologiques
Les symptômes généraux et les signes cliniques neurologiques sont
semblables quels que soient les virus en cause. Le début de la
maladie est aigu, la méningite pouvant être parfois précédée d’une
phase prodromique pseudogrippale. Le tableau neurologique est
dominé par le syndrome méningé fébrile. Les céphalées sont
intenses ; photophobie, anorexie et nausées sont possibles. La fièvre
est quasi constante, entre 38 et 40 °C, mais peut être masquée par les
antipyrétiques. L’examen retrouve une raideur de nuque à
l’antéflexion, les signes de Kernig et de Brudzinski peuvent manquer
en cas d’irritation méningée minime. L’examen neurologique ne
retrouve pas, en règle générale, de somnolence, de confusion, de
convulsions, de coma ou de signes de localisation. Il faut néanmoins
systématiquement les rechercher, car un tel tableau imposerait
d’envisager immédiatement la méningoencéphalite herpétique.
¶Contexte et signes extraneurologiques
Le contexte peut parfois orienter vers une étiologie virale devant
une méningite aiguë : enfant ou adulte jeune, contexte d’épidémie
dans une collectivité. Certains signes restent peu spécifiques mais
participent au « cortège viral » : myalgies, conjonctivite, pharyngite,
bronchite. La présence de signes extraneurologiques doit être
recherchée, car elle peut orienter. L’absence de vaccination contre
les oreillons, l’existence d’une parotidite (présente dans 50 % des cas
un peu avant les signes neurologiques), les douleurs abdominales
(pancréatite) sont évocatrices d’une méningite ourlienne. Les
éruptions cutanées doivent faire évoquer les Entérovirus, HHV6, le
CMV, le virus VZV (vésicules diffuses). L’herpangine (vésicules de
17-160-C-10 Méningites aiguës Neurologie
4

l’oropharynx postérieur), la présence d’un syndrome main-pied-
bouche ou l’existence d’une pleurodynie évoquent les virus
Coxsackie. L’existence d’une myopéricardite oriente vers les virus
Coxsackie B. L’existence de facteurs de risque pour le VIH doit faire
discuter la méningite de primo-infection, qui peut s’associer à
d’autres signes extraneurologiques : pharyngite, rash, adénopathies,
atteinte pulmonaire
[31]
.
MÉNINGITES BACTÉRIENNES AIGUËS
¶Présentation générale
Le tableau clinique est tout aussi brutal mais plus sévère que dans
la méningite virale. Il associe de manière quasi constante un
syndrome méningé, des céphalées et de la fièvre au cours d’un
syndrome infectieux volontiers marqué. Le syndrome méningé est
souvent évident, mais parfois discret. Les signes de Kernig et de
Brudzinski ne sont retrouvés que dans environ 50 % des cas : leur
absence n’élimine donc pas le diagnostic. À la différence des
méningites virales aiguës, les troubles de la conscience sont
fréquents (environ 70 à 80 %), sous la forme d’une somnolence, d’un
ralentissement, d’une confusion, voire d’un coma. Beaucoup plus
rares sont les convulsions (20 à 30 %) et/ou les signes de localisation
(10 %). Le tableau clinique peut être plus fruste et plus trompeur
aux âges extrêmes de la vie (petits enfants et personnes âgées), ce
qui impose dans ces cas que la ponction lombaire soit réalisée au
moindre doute devant tout syndrome infectieux mal expliqué. Un
œdème papillaire au fond d’œil n’est retrouvé que dans 1 % des cas.
L’examen clinique doit chercher les signes de gravité : état de choc
avec ou sans lésions purpuriques, coma profond, convulsions, signes
neurologiques déficitaires, détresse respiratoire aiguë, anurie. La
recherche d’une porte d’entrée, notamment otite, mastoïdite, sinusite
doit être systématique, particulièrement en cas de méningite à
pneumocoque.
¶Formes cliniques
Méningocoque
[35]
Les facteurs épidémiologiques en sa faveur sont : la survenue
hivernale, la notion d’un déficit en complément, la notion
d’épidémie. Cliniquement, un début volontiers très brutal, la
présence d’un purpura ou d’une atteinte articulaire sont en faveur
du méningocoque.
Le tableau classique du purpura fulminans doit être parfaitement
connu car c’est une urgence absolue. Il s’agit d’une méningite aiguë
avec bactériémie (à méningocoque dans la grande majorité des cas)
caractérisée par un purpura nécrotique rapidement extensif (fig 1) et
par un état de choc grave.
Pneumocoque
[35]
Les facteurs épidémiologiques en sa faveur sont un terrain
prédisposant (alcoolisme chronique, asplénie, antécédents de
traumatisme crânien ou de chirurgie de la base du crâne), un ou des
antécédents de méningite. Cliniquement, un début brutal, l’existence
de troubles de la conscience marqués et rapidement évolutifs, une
rhinorrhée ou une infection des voies aériennes (otite, sinusite,
pneumopathie) sont des arguments en faveur du pneumocoque. Un
purpura, voire un purpura fulminans, sont aussi possibles avec le
pneumocoque, mais plus rarement qu’avec le méningocoque.
Listeria
[9, 35, 37]
Les facteurs épidémiologiques en sa faveur sont l’âge (nouveau-né,
âge supérieur à 60 ans), une grossesse, une immunodépression
cellulaire (chimiothérapie, corticothérapie, greffe d’organe,
néoplasies), une notion d’épidémie. Cliniquement, un début
volontiers subaigu, un tableau infectieux plus modéré et une
évolution progressive des signes cliniques sont en faveur de
l’étiologie listérienne. L’argument le plus classique en faveur de la
listériose réside dans la présence de signes cliniques traduisant une
atteinte (volontiers multiple à prédominance unilatérale) des nerfs
crâniens : paralysies oculomotrices, paralysies faciales périphériques,
troubles de la déglutition, nystagmus, ataxie, syndromes alternes.
Néanmoins, ce tableau de rhombencéphalite est loin d’être constant
et d’authentiques listérioses neuroméningées peuvent se présenter
sans aucun signe de localisation. Une étude récente ne retrouve des
signes de localisation et/ou des convulsions que dans 23 % des cas
de listérioses neuroméningées. En revanche, une altération de la
conscience est fréquente, retrouvée dans 65 % des cas.
Hæmophilus
Les arguments qui peuvent orienter sont un sujet jeune, souvent âgé
de moins de 5 ans, l’absence de vaccination, l’association otite et
conjonctivite. Un purpura est possible, mais rare.
Autres cas
Les méningites communautaires à bacilles à Gram négatif sont plus
fréquentes chez les sujets âgés et/ou immunodéprimés. Une otorrhée
purulente chronique suggérant un cholestéatome doit faire évoquer
l’association bacilles à Gram négatif et anaérobies
[30]
.
En situation nosocomiale, en particulier après un traumatisme
crânien ou un geste neurochirurgical, le diagnostic clinique peut être
difficile : difficultés d’interprétation des signes neurologiques,
nombreuses causes de fièvre. La ponction lombaire sera
systématique au moindre doute. Chez le patient neutropénique, la
réaction inflammatoire au sein des méninges est diminuée. La
symptomatologie clinique est volontiers discrète.
Diagnostic
Devant un tableau clinique de méningite aiguë, l’élément clef du
diagnostic est l’analyse du LCR après ponction lombaire. Les autres
examens complémentaires (imagerie, électroencéphalogramme
[EEG], autres examens biologiques) peuvent parfois s’avérer
nécessaires ou être intéressants. Les données du LCR normal sont
rappelées dans le tableau III.
MÉNINGITE VIRALE
¶Analyse du LCR
L’aspect macroscopique est un LCR clair. Il existe souvent une
hypertension, en règle plus modérée que dans les méningites
1Purpura fulminans à méningocoque (photo F Bruneel).
Tableau III. – Caractéristiques du liquide céphalorachidien (LCR)
normal.
Aspect « eau de roche »
Pression d’ouverture:5à15mmHg (6,5 à 20 cm d’eau)
Globules blancs < 10/mm
3
(5 à 10/mm
3
= suspect)
Contamination sanguine : 1 globule blanc pour 700 globules rouges
(si chiffres normaux de globules rouges et blancs dans le sang)
Protéines : 0,15 à 0,40 g/L (possiblement un peu plus élevé chez le sujet âgé)
Glucose : 50 à 60 % de la glycémie
Stérile
Neurologie Méningites aiguës 17-160-C-10
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%