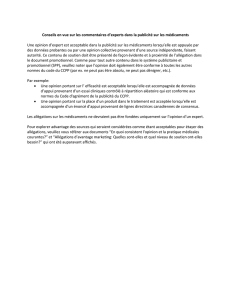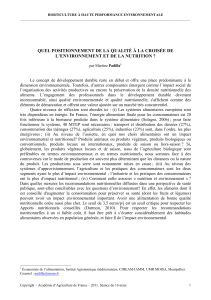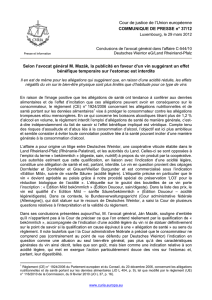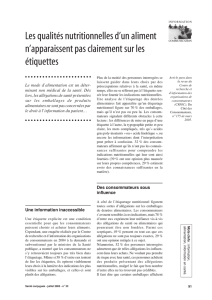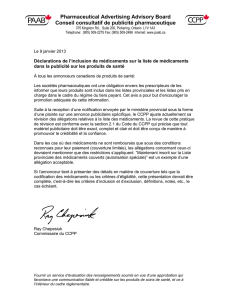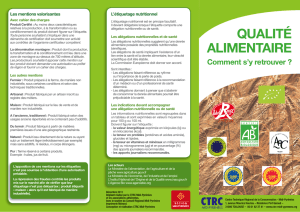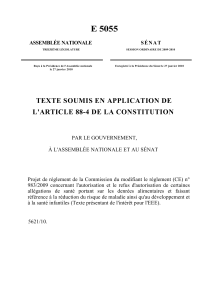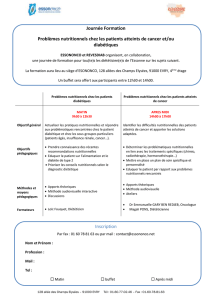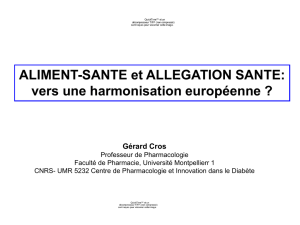1528 - les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires

27 juillet-2 août 2009
No1528
INC Hebdo
I
INC
document
ÉTUDE JURIDIQUE
—————
1Considérant 1 du règlement (CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles
et de santé portant sur les denrées alimentaires, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 décembre 2006.
2Norme du Codex alimentarius CAC/GL 1 de 1979 (rév. 1-1991), voir <www.codexalimentarius.net>.
3Voir l’étude publiée dans le no1362 d’INC Hebdo et téléchargeable à l’adresse < www.conso.net/incdoc/1362-les_allegations_sante_275.pdf>.
L’allégation se définit comme «toute mention qui affirme, sug-
gère ou indique qu’une denrée possède des caractéristiques par-
ticulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature,
sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre
qualité 2».
L’allégation de santé, que ce soit sur l’étiquetage ou dans la publi-
cité faite pour les denrées alimentaires, permet à l’industriel de
faire un lien entre les propriétés nutritives de l’aliment (« riche
en fibres»)et la santé (« facilite le transit intestinal»).
1. LES DIFFÉRENTS TYPES D’ALLÉGATION
Il existe trois types d’allégation3:l’allégation nutritionnelle; l’allé-
gation fonctionnelle et de santé; l’allégation de prévention, de
traitement ou de guérison des maladies humaines.
L’allégation nutritionnelle
Cette allégation apporte des informations quantitatives sur
les nutriments présents dans la denrée alimentaire (décret du
27 septembre 1993). Ainsi, différents nutriments peuvent faire
l’objet d’une allégation nutritionnelle comme les protéines, les
glucides, les lipides, le sodium…
L’allégation fonctionnelle et de santé
L’allégation fonctionnelle décrit le rôle joué par un nutriment
présent dans la denrée alimentaire et un effet présenté de ma-
nière positive sur une fonction normale de l’organisme, mais
pas sur une maladie. Par exemple : «le calcium contribue au dé-
veloppement du tissu osseux» ou «le fluor participe à la solidité
des dents ».
L’allégation de santé est une allégation qui indique, suggère ou
implique qu’une relation existe entreun aliment et un état lié
àla santé ou une modification biologique, mais sans faire réfé-
rence à la maladie. Cette allégation reconnaît aux nutriments
qui composent la denrée alimentaire un effet bénéfique spéci-
fique qui va au-delà de celui qui pourrait être obtenu par l’ali-
mentation. Parmi ces denrées alimentaires (regroupées sous
l’expression d’«alicament»), on trouve par exemple l’huile Pri-
mevère oméga 3 de Cema qui «participe au bon fonctionnement
du système cardiovasculaire».
I – LA NOTION D’ALLÉGATION DE SANTÉ :PETIT RAPPEL
LES PROFILS NUTRITIONNELS
POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Les allégations nutritionnelles et de santé sont fréquemment utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires
au sein de l’Union européenne, et semblent constituer un critère déterminant dans l’achat des produits.
Néanmoins, le développement de ces allégations a conduit à des abus et des dérives inacceptables. Ainsi on a pu lire «Bon pour…»
ou «Riche en…» sur des produits qui étaient pourtant à forte teneur en graisses, sel ou sucre… Ces messages publicitaires contenant
ces allégations non fondées et exagérées peuvent conduire le consommateur à croire à tort que certains aliments présentent
un avantage nutritionnel et un effet bénéfique sur la santé.
« Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il convient que les produits mis sur
le marché soient correctement étiquetés » : ainsi le règlement européen du 20 décembre 2006 1a-t-il subordonné l’usage de ces
allégations au respect de profils nutritionnels. Un produit ne pourra mettre en avant ses atouts nutritionnels («Riche en…», «Allé-
gé en… », etc.) que s’il respecte un certain profil nutritionnel préétabli, c’est-à-dire uniquement si sa composition ne dépasse
pas une certaine quantité de nutriments jugée disqualifiante pour la santé.
Il faut toutefois veiller à ne pas adopter un système trop strict qui empêcherait certains produits de valoriser leur richesse.
1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page i

27 juillet-2 août 2009
No1528
INC Hebdo
II
L’allégation de prévention, de traitement
oude guérison des maladies
Cette allégation se définit comme toute représentation qui in-
dique, suggère ou implique qu’une relation existe entre un ali-
ment, un élément nutritif ou une autre substance contenue dans
un aliment, et une maladie désignée en tant que telle. Ce type
d’allégation est interdit au sein de l’Union européenne. L’in-
dustriel ne peut donc pas prétendre que la denrée alimentaire
qu’il commercialise contient, par exemple, des fibres solubles
qui préviennent le risque de maladies cardiovasculaires.
2. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE
AUX ALLÉGATIONS DE SANTÉ
Les obligations générales s’appliquant à toutes
les denrées alimentaires
• Une obligation de conformité
Cette obligation contraint le vendeur à garantir l’aptitude de la
denrée alimentaire à l’emploi recherché par le consommateur
(article L. 212-1 du code de la consommation). Le responsable
de la première mise sur le marché est tenu de vérifier la con-
formité du produit, notamment au regard des règles du code
civil et du droit de la consommation (article L. 213-1 sur la trom-
perie et article L. 213-3 sur la falsification).
• Une obligation de sécurité
Cette obligation de résultat contraint le professionnel respon-
sable de la première mise sur le marché, comme le vendeur, à
garantir au consommateur que le produit acheté ne présente
aucun danger, ni ne menace sa santé ou sa sécurité.
• Une obligation de justification des vérifications
et contrôles effectués
L’article L. 212-1 alinéa 3 du code de la consommation pose une
obligation générale de justification au responsable de la pre-
mière mise sur le marché, et l’article L. 121-2 établit l’obligation
de justifier toute allégation publicitaire (l’étiquetage d’une den-
rée s’analysant juridiquement comme une publicité).
• Une obligation de ne pas tromper le consommateur
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose qu’«une
pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments
suivants :
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir :
ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son ori-
gine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les condi-
tions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés
et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats
et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués
sur le bien ou le service ;
c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel
duprix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du
bien ou du service ;
d) le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce dé-
tachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procé-
déou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;
g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur».
Les obligations spécifiques aux denrées alimentaires
seprévalant d’une allégation de santé
Les denrées alimentaires se prévalant d’une allégation de san-
té doivent faire l’objet d’un étiquetage nutritionnel approprié
etne pas empiéter sur le domaine du médicament.
• Un étiquetage nutritionnel approprié
Lorsqu’une allégation de santé figurant sur l’emballage d’une
denrée alimentaire est utilisée dans la présentation de cette den-
rée ou fait l’objet d’une mesure de publicité (exception faite des
campagnes publicitaires collectives), elle doit obligatoirement
être accompagnée d’un étiquetage nutritionnel approprié
(directive 90/496/CE du 24 septembre 1990 transposée en droit
français par le décret no93-1130 du 27 septembre 1993 et l’ar-
rêté d’application du 3 décembre 1993).
L’entreprise a le choix entre deux groupes de mentions obliga-
toires.
Le groupe 1
Ilfait mention de :
– la valeur énergétique,
– la quantité de protéines, de glucides et de lipides.
Le groupe 2
Ilapporte une information nutritionnelle plus complète en men-
tionnant :
–la valeur énergétique,
–la quantité de protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras
saturés, fibres alimentaires et sodium.
• Ne pas empiéter sur le domaine du médicament
La denrée alimentaire valorisée par une allégation de santé ne
doit pas empiéter sur le domaine du médicament. L’article R. 112-
7du code de la consommation dispose à cet égard que « l’éti-
quetage d’une denrée alimentairene doit pas faireétat de pro-
priétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie
humaine ni évoquer ces propriétés».
Les principaux textes
•Règlement (CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre2006 concernant les allégations nutri-
tionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires :<eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do >.
• Résolution sur la fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires, adoptée par l’Assemblée nationale le 25 avril
2009 : <www.assembleenationale.fr/13/ta/ta0268.asp>.
•Résolution européenne sur le projet de règlement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires, adop-
tée par le Sénat le 26 mai 2009 : <www.senat.fr/leg/tas08-083.html>.
• Avis no63 du 13 octobre 2008 du Conseil national de l’alimentation sur la mise en œuvre et conséquences d’un système
de profils nutritionnels prévu par le règlement (CE) no1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant
sur les denrées alimentaires : <www.cna-alimentation.fr>.
• Avis no64 du 8 avril 2009 du Conseil national de l’alimentation sur l’éducation alimentaire, la publicité alimentaire, l’information
nutritionnelle et l’évolution des comportements alimentaires : <www.cna-alimentation.fr>.
1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page ii

27 juillet-2 août 2009
No1528
INC Hebdo
III
—————
4Un règlement européen, à la différence d’une directive, est d’application immédiate et directe dans les États membres. Toutefois, ici, l’entrée en
vigueur est échelonnée : 1er juillet 2007 pour les dispositions générales;19 janvier 2009 pour les profils nutritionnels; 31 janvier 2010 pour la liste
des allégations de santé autres que celles faisant référence à une réduction d’un risque de maladie.
5Avis no63 du 13 octobre 2008 du CNA sur la mise en œuvre et conséquences d’un système de profils nutritionnels prévu par le règlement (CE)
no1924/2006.
6Article 4du règlement (CE) no1924/2006 du 20 décembre2006.
7Article 3 du règlement (CE) no1924/2006 du 20 décembre 2006.
1. LES OBJECTIFS DU RÈGLEMENT (CE)
no1924/2006 DU 20 DÉCEMBRE 2006
Face aux abus et aux dérives de la pratique des allégations, l’in-
tervention du législateur était devenue indispensable. Aussi, entré
envigueur en juillet 20074,le règlement européen du 20 décem-
bre 2006 a prévu un encadrement strict des allégations nutrition-
nelles et de santé afin d’éviter qu’elles ne masquent la réalité
nutritionnelle globale du produit.
Pour le Conseil national de l’alimentation (CNA), le règlement
lie de façon indissociable et place sur le même plan hiérarchique
les deux objectifs qu’il se fixe, à savoir :
–garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur au
sein de l’Union européenne, par l’harmonisation des dispositions
des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les den-
rées alimentaires;
–protéger le consommateur par un encadrement de l’étiquetage
des produits alimentaires et des moyens publicitaires ou de com-
munication relatifs à ces allégations5.
L’encadrement de l’utilisation
des allégations
Les allégations sont formulées pour insister sur le fait que les
produits présentent un bénéfice supplémentaire en termes de
santé ou de nutrition. Leurs utilisations doivent donc être rigou-
reusement encadrées.
Jusqu’à présent, une denrée alimentaire riche en sel, sucre ou
matières grasses pouvait quand même utiliser des allégations
du type «riche en vitamine C» ou « riche en fibres», même si ses
bénéfices globaux en termes de santé et de nutrition étaient fai-
bles. Ainsi, on pouvait lire sur les sucettes Chupa Chups qu’elles
contenaient «0 % de matière grasse»… mais rien n’était dit quant
àleur composition en sucre.
Désormais, des conditions strictes pour l’utilisation des alléga-
tions nutritionnelles sont établies.
Pour rendre applicable le règlement (CE) no1924/2006, un dispo-
sitif de profilage nutritionnel des aliments est nécessaire.
La détermination de ces profils nutritionnels consiste à établir,
par famille de produits, une composition limite en certains nu-
triments et à fixer des seuils pour trois éléments : le sodium, le
sucre et les acides gras saturés. Ainsi, lorsque ces seuils sont res-
pectés, le fabricant peut communiquer des allégations de san-
té par voie d’étiquetage et de publicité. En revanche, lorsque ces
seuils sont dépassés, aucune allégation n’est admise.
Le profil nutritionnel est désormais la condition nécessaire pour
pouvoir utiliser des allégations de santé sur les denrées alimen-
taires. Un produit ne pourra mettre en avant ses atouts nutri-
tionnels et utiliser des allégations que s’il respecte un certain
profil préétabli6.
L
’article 4 du règlement du 20 décembre 2006 précise ce qui
doit être pris en compte pour définir un profil nutritionnel.
« Les profils nutritionnels sont établis en prenant en consi-
dération :
– les quantités de certains nutriments et autres substances
contenues dans la denrée alimentaire concernée (par exem-
ple les matières grasses, les acides gras saturés, les acides gras
trans, les sucres et le sel/sodium),
– le rôle et l’importance de la denrée alimentaire (ou des ca-
tégories de denrées alimentaires) et l’apport au régime ali-
mentaire de la population en général ou, s’il y a lieu, de cer-
tains groupes à risque, notamment les enfants,
–la composition nutritionnelle globale de la denrée alimen-
taire et la présence de nutriments reconnus scientifiquement
comme ayant un effet sur la santé. »
L’encadrement de la communication
de ces allégations
Le règlement (CE) no1924/2006 est venu compléter la directive
générale 2000/13/CE sur l’étiquetage et l’interdiction des infor-
mations pouvant induire en erreur le consommateur. Il vise à
harmoniser les règles relatives à l’emploi des allégations nu-
tritionnelles et de santé utilisées dans l’étiquetage, la présenta-
tion et la publicité des aliments.
Pour être utilisées en tant que publicité sur une denrée alimen-
taire, les allégations doivent être conformes aux dispositions
du règlement7.Elles doivent remplir certaines conditions, et
leur utilisation est subordonnée à la compréhension par un con-
sommateur moyen des effets bénéfiques qui sont exposés. Leurs
justifications par des données scientifiques doivent également
être rapportées. Ainsi, ne sont admises que les allégations nu-
tritionnelles relatives à la valeur énergétique, aux nutriments et
aux substances appartenant à l’une des catégories de ces nutri-
ments ou qui en sont les composants.
Le consommateur est de plus en plus démuni face à la diver-
sité des produits, et à la multiplication des messages et des tech-
niques de vente qui les accompagnent. Cela a tendance à accroî-
tre la situation inégalitaire qui existe déjà entre le consommateur
demandeur et le professionnel offrant. Toute cette réglementa-
tion est donc faite pour assurer au consommateur un niveau
élevé de protection, et ainsi faire disparaître la pratique de com-
munication abusive – comme par exemple l’allégation « 0 % de
matière grasse » pour la vente de confiseries.
Ilyaune réelle volonté de fournir au consommateur les infor-
mations nécessaires pour améliorer son alimentation et faire
des choix en connaissance de cause,mais également pour créer
des conditions de concurrence égales pour les entreprises de
l’industrie alimentaire.
Ce texte couvre toutes les allégations nutritionnelles et de santé
formulées dans les communications à caractère commercial
–qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des
denrées alimentaires ou la publicité – dès lors qu’elles sont des-
tinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.
II – LES PROFILS NUTRITIONNELS : CONDITIONS D’UTILISATION
DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ
1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page iii

27 juillet-2 août 2009
No1528
INC Hebdo
IV
—————
8Depuis la réforme du 23 juillet 2008 de la Constitution française, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter une résolution européenne
sur tout document émanant d’une institution de l’Union.
2. LES PROPOSITIONS DE FIXATION
DES PROFILS NUTRITIONNELS
Étant donné l’importance de la nutrition dans la problématique
alimentaire, il est devenu nécessaire de disposer d’un outil d’éva-
luation de la qualité nutritionnelle. Le profil répond à ce besoin.
LeConseil national de l’alimentation (CNA) considère que le pro-
filage nutritionnel doit être envisagé comme un des moyens à
adopter pour atteindre les objectifs du règlement européen (CE)
no1924/2006.
Le profil nutritionnel vise à classer les aliments en fonction d’un
certain nombre de critères, et notamment leur composition
nutritionnelle. Ainsi, il devrait être déterminé avant tout enrichis-
sement du produit pour ne pas masquer le véritable statut nutri-
tionnel de l’aliment et induire en erreur le consommateur.
La proposition de l’Afssa
L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) avait
proposé, le 1er juin 2008, un système de profilage nutritionnel
construit sur le calcul de deux scores :
–le SAIN (score d’adéquation individuel aux recommandations
nutritionnelles). Calculé à partir d’un nombre défini de nutri-
ments dits «qualifiants», ce chiffre représente le pourcentage
moyen de couverture des besoins en ces nutriments d’intérêt.
Ceux qui ont été intégrés dans le calcul du SAIN sont ceux dont
la consommation est à encourager, en ce qu’ils sont insuffisam-
ment consommés au regard des recommandations de santé pu-
blique;
– le LIM (score des nutriments à limiter). Calculé à partir d’un
nombre défini de nutriments dits «disqualifiants», cet indice
correspond au pourcentage moyen de dépassement des recom-
mandations nutritionnelles pour ces nutriments. Sont intégrés
dans cet indice les nutriments dont les apports pour la popula-
tion sont supérieurs aux recommandations de santé publique.
L’accès aux allégations aurait donc été déterminé en fonction
de deux valeurs seuils :une valeur SAIN correspondant à un mi-
nimum à atteindre et une valeur LIM à ne pas dépasser. Mais
cette procédure n’a pas été retenue.
Laproposition de la Commission européenne
Le 13 février 2009, la Direction générale de la santé et de la pro-
tection des consommateurs (DG Sanco) a proposé un projet de
règlement communautaire établissant des seuils nutritionnels
extrêmement stricts, mais très préjudiciables notamment pour
les fromages, les produits de panification et de biscuiterie. En
effet, ce texte définit par catégories de denrées alimentaires les
proportions maximales de sucre, sel et acides gras saturés à res-
pecter pour être autorisé à mentionner des allégations nutri-
tionnelles.
Toutefois, la mise en œuvre de ces profils, ainsi fixés par la DG
Sanco, pourrait avoir des conséquences pénalisantes pour cer-
taines catégories de denrées alimentaires. En effet, ce projet de
réglementation risque de :
– contredire les politiques nationales de nutrition en empêchant
les produits naturels de mettre en avant leurs atouts;
–désinformer le consommateur et brouiller ses repères en sug-
gérant qu’il existe de « bons» et de «mauvais» aliments.
Cette disposition ainsi définie met «hors profil» certains aliments
pourtant très utiles, et leur interdit donc l’accès aux allégations.
Ainsi, un fromage riche en calcium, mais ayant un taux de ma-
tière grasse supérieur aux normes fixées, ne pourra pas utiliser
les allégations relatives au calcium. Alors qu’à l’inverse, un pro-
duit transformé qui ne contiendrait rien en excès, mais présen-
terait une valeur nutritionnelle insuffisante, peut être autorisé
àfaireune allégation sur la base des quelques nutriments po-
sitifs qu’il contient.
Il y a donc un vrai danger que les produits traditionnels soient
injustement écartés au profit de produits formatés uniquement
pour répondre aux profils.
Pour établir le profil nutritionnel d’un aliment, il faut tenir compte
àla fois des nutriments «positifs» qu’il apporte et des éléments
discriminants (quantité d’énergie, de matière grasse, de sucre,
de sel, d’acides gras). En effet, la plupart des aliments ont à la
fois des qualités et des défauts, et c’est l’équilibre entre ces deux
caractéristiques qui détermine sa qualité nutritionnelle globale,
c’est-à-dire son profil nutritionnel.
L
’objectif du règlement, qui est de garantir aux consommateurs
un étiquetage plus clair et plus précis pour éviter les allégations
nutritionnelles et de santé trompeuses sur des produits à forte
teneur en graisses, sel ou sucre, a semble-t-il été perdu de vue.
Cette proposition de profils nutritionnels fait en réalité prévaloir
les intérêts de l’industrie sur la santé des consommateurs.
3. L’OPPOSITION À LA PROPOSITION
EUROPÉENNE
En France, deux propositions de résolutions, présentées pour
l’une par le sénateur Jean Bizet et pour l’autre par le député Hervé
Gaymard, ont été adoptées8.
Tout d’abord, le 25 avril 2009, l’Assemblée nationale a consi-
déré comme définitivela résolution de la commission des af-
faires économiques, de l’environnement et du territoire sur la
fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires. Elle
demande à la Commission européenne d’élever les seuils pour
l’établissement des profils nutritionnels notamment des fro-
mages, du lait entier et des matières grasses. Ce texte condamne
les modalités de fixation de ces profils, étant donné que ces dis-
positions risquent de pénaliser tout un secteur d’activité, notam-
ment les fabrications fromagères.
Ledispositif de profilage nutritionnel des aliments doit être
réalisé par la Commission européenne selon la procédure
de«comitologie».
Cette procédure se fait en plusieurs temps :
–la Commission prépare un projet de règlement,
–ce projet est soumis à l’avis d’un comité d’experts des
différents États membres,
– si le comité l’approuve, le texte ne sera pas soumis au
Conseil et au Parlement pour approbation mais pour con-
trôle, ce qui peut se traduire par une opposition.
Ce dispositif permet d’encadrer la Commission dans
l’exercice de ses pouvoirs d’exécution, délégués par le Con-
seil de l’Union et par des comités composés de représen-
tants des États membres.
Le comité de réglementation chargé d’examiner et de vali-
der le projet de règlement européen est le Comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA),
relevant de la Direction générale de la santé et de la pro-
tection des consommateurs (DG Sanco).
1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page iv

27 juillet-2 août 2009
No1528
INC Hebdo
V
L’impact de l’établissement des profils doit être compatible avec
les principes rappelés dans le règlement, notamment la nécessité
d’encourager une alimentation variée et équilibrée. Pour cela,
il est essentiel que la fixation de ces profils n’exclue aucune caté-
gorie d’aliments. Ils ne doivent donc pas conduire à la stigma-
tisation de certains aliments qui ne «passeraient» pas les pro-
fils. Ils doivent être établis dans l’unique but de déterminer si un
aliment peut ou non porter une allégation nutritionnelle ou de
santé.
Certains établissements se sont déjà engagés à améliorer et trans-
mettre une information nutritionnelle simple et claire. Cette ini-
tiative ne résulte pas de l’établissement de profils nutritionnels,
mais elle suit le même objectif : ce système d’étiquetage nutri-
tionnel, appelé «Nutri-pass», met en avant des codes couleurs
pour les nutriments à surveiller (sel, sucre, matières grasses) et
àprivilégier (fer, calcium, vitamines). Il y a une volonté de déve-
lopper la communication et l’information nutritionnelle.
Les préoccupations relatives à l’équilibre nutritionnel sont né-
cessaires et légitimes. Cependant, cet équilibre ne se résume pas
àla consommation d’un seul produit mais à l’association des
différentes denrées alimentaires : l’équilibre nutritionnel est un
ensemble. Pour les associations de consommateurs, la multi-
plication des allégations soumet le consommateur à des choix
contraints. Faut-il préférer le calcium aux vitamines, réduire le
lactose ou accroîtrele magnésium?Les profils ne doivent pas
imposer une standardisation des aliments et un modèle uni-
que de comportement.
Alors que les professionnels mettent en avant des allégations
avantageuses sur certains nutriments du produit pour accroî-
tre leurs ventes, ne pourrait-on pas user d’un autre moyen que
le marketing commercial pour montrer l’importance d’une ali-
mentation variée et équilibrée?
Par ailleurs, le profilage nutritionnel est uniquement destiné
àautoriser les allégations. Il ne doit donc pas, en principe, néces-
sairement figurer sur l’étiquette. Toutefois, rien n’empêche un
État membre de le demander. Nous pouvons alors craindre, dans
ce cas-là, une illisibilité totale en raison d’un excès d’informations
(composition du produit, apports énergétiques, allergènes, poids,
etc.). Le consommateur risque fortde ne pas s’y retrouver dans
cette masse d’indications. Faudra-t-il agrandir la taille des em-
ballages pour pouvoir répondreàl’ensemble de ces exigences?
Marine Terreygeol
III – EN CONCLUSION
L’Assemblée nationale demande en outre de tenir compte des
spécificités et de la diversité des traditions alimentaires propres
àchaque État membre. En effet, les autres pays de l’Union euro-
péenne veulent eux aussi préserver leurs habitudes alimentaires.
Ainsi, les boulangers allemands ont défendu avec vigueur une
dérogation aux profils nutritionnels pour les produits tradition-
nels tels que le bretzel.
Par la suite, le 26 mai 2009, le Sénat a adopté la résolution euro-
péenne de la commission des affaires économiques sur le projet
derèglement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les
denrées alimentaires. Il demande au gouvernement de s’opposer
àde nouvelles propositions de seuils de nutriments inadaptés
àcertaines denrées ou favorisant la consommation des produits
standardisés issus de l’industrie agroalimentaire.
Le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) a
également réagi à cette proposition de fixation des profils nu-
tritionnels et a demandé à la Commission européenne et aux
États membres de «rétablir des profils nutritionnels réalistes et
efficaces pour aider les consommateurs européens à faire des choix
plus sains et contribuer à la lutte contre l’obésité».
Devant l’ensemble de ces contestations, le président de la Com-
mission européenne a décidé de retravailler sur le sujet pour un
assouplissement des règles. Il a ainsi retiré la proposition de l’or-
dre du jour de la réunion du 27 mars 2009 et a considéré qu’un
certain nombre de dérogations étaient nécessaires pour les fruits
etlégumes, la viande, le poisson, le lait, les œufs et les pains tradi-
tionnels. Une plus grande liberté d’affichage serait donc donnée
àcertains produits traditionnels, qui échapperaient alors aux
profils nutritionnels.
Ce dispositif devait entrer en vigueur avant le 19 janvier 2009.
Mais les propositions ayant été rejetées, du retard a été pris. En
raison du récent scrutin européen, il faudra attendre l’automne
prochain pour qu’une nouvelle proposition soit présentée et
analysée par la nouvelle composition du Parlement européen.
Ilsera intéressant d’apprécier si l’ensemble des remarques et
des objections qui ont été faites au sujet des profils nutritionnels
ont été prises en considération pour établir le texte final.
1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page v
 6
6
1
/
6
100%