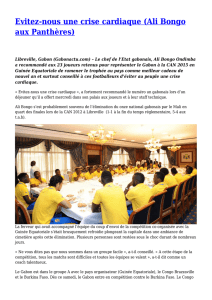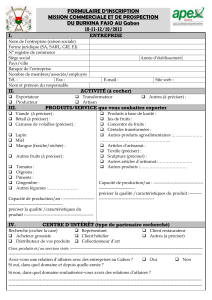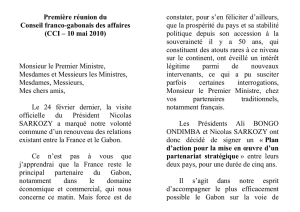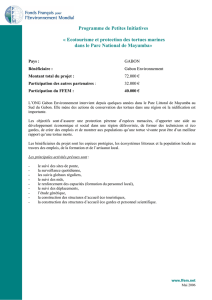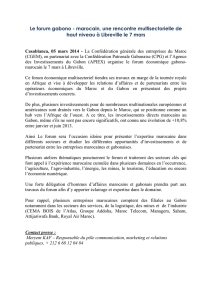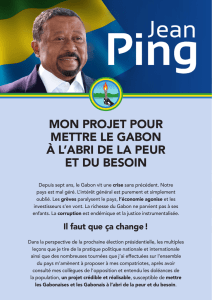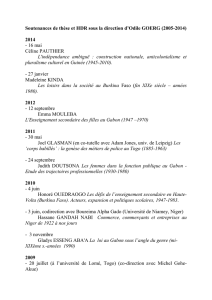Résumé Après avoir étudié le contexte de ralliement du territoire du

L’APPORT ECONOMIQUE DU GABON A LA FRANCE LORS DU SECOND CONFLIT MONDIAL :
1939-1945
Antoine-Denis N’DIMINA-MOUGALA
Ecole Normale Supérieure
Libreville (GABON)
Résumé
Après avoir étudié le contexte de ralliement du territoire du Gabon aux forces de la
France libre, l’article analyse également, en dernier ressort, le substantiel apport économique
du Gabon à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de l’effort de guerre
alors demandé aux Gabonais.
Mots-clés : Gabon, Guerre, Deuxième Guerre mondiale, Incidences, Apport économique.
Abstract
The economic contribution of Gabon to France during the second world war conflict. After having
studied the joining context of the territory of Gabon, to the free France forces, this article is analysing in the
last part, the economic substantial contribution of Gabon to France during the second world war, in the field
of the war required to the gabonese people
Key-words: Gabon, War, World war two, Consequences, Economic contribution.
Introduction
S’intéresser un tant soi peu à la problématique de la guerre comme vous y invite la
présente publication, revient à s’approprier de façon critique, les enjeux, pour ne pas dire les
tenants et les aboutissants, qui sous-tendent et donnent un sens à la dite problématique à travers
ses manifestations contemporaines. S’il est une constante et une régularité dans l’action et
l’histoire humaines, c’est bien la guerre. Tout se passe comme si les hommes étaient incapables
de résoudre leurs différends sans prendre les armes. Dans cet ordre d’idée, on peut arguer que
la guerre est au cœur de l’homme, qu’elle est « la source, la mère de toutes choses », si l’on tient
compte de l’assertion du grec Héraclite. Par ailleurs, celle-ci n’a épargné aucune civilisation.
C’est par elle également qu’ont péri presque toutes les civilisations. Elle permet aussi
l’affirmation, l’essor et l’entrée dans l’histoire de la plupart des civilisations nouvelles
(Bouthoul, 1991 : 6). La guerre trouve sa justification par le fait que « l’homme peut être défini
comme un animal conflictuel » (Bouthoul, 1976 : 8).
Toute guerre est par certain côté, une entreprise économique ; elle commence par une
accumulation du capital, monnaie ou matière. Chaque guerre pose donc avant tout des
problèmes de financement (Id, 1953 : 35-36). Cette analyse n’est pas éloignée de celle du
Maréchal de France le Comte Maurice de Saxe1. Car selon lui, « pour faire la guerre, il faut trois
choses : premièrement : de l’argent ; deuxièmement : de l’argent ; troisièmement : de l’argent ». La guerre
a donc un coût, comme on peut aisément en convenir. Cette préoccupation n’est pas nouvelle.
Elle était déjà présente dans l’Antiquité2, notamment en Chine ancienne. Sun Tzu3 pour qui
1 Né en 1696 à Goslar et mort à Chambord en 1750, le Maréchal Maurice de SAXE a publié un seul ouvrage intitulé les
Rêveries. Il était d’origine saxonne. C’était un partisan de la guerre d’usure
2 Beaucoup de cités antiques détenaient un trésor de guerre déposé dans les temples. Par ailleurs, la puissance militaire
d’Athènes s’accrut après la découverte des mines d’argent du Laurion

« la guerre est une affaire d’une importance vitale pour l’Etat, la province de la vie et de la mort, la voie
de la survie ou de l’anéantissement pour le pays » (1972 : 91), préfère la stratégie de la ruse, de la
création d’apparences trompeuses, et des stratagèmes. En d’autres termes, il ne s’agit pas
contrairement au point de vue stratégique de Carl von Clausewitz4 adopté par l’Occident, de
triompher avec gloire et en prônant notamment « …l’anéantissement des forces armées de l’ennemi
afin de lui ôter toute volonté et toute capacité de résistance », mais sans effort ruineux pour l’Etat. Car
lorsque l’armée s’engage dans des campagnes prolongées, les ressources de l’Etat ne suffisent
pas. En conséquence, l’armée doit vaincre l’adversaire le plus rapidement possible (Id : 66-67 &
102). Le but du présent article, qui est loin d’être l’exposé d’une thèse achevée, mais plutôt
une simple et modeste réflexion à plume vive parmi d’autres possibles, se propose d’analyser le
ralliement de la colonie du Gabon à la guerre, et surtout la réalité de l’apport économique et
financier du Gabon à la France lors de ce conflit. Pour ce faire, trois questions rythment le
propos : Quel est le contexte de ralliement du territoire du Gabon à la guerre de 1939-1945 ?
Quel a été réellement l’apport économique et financier de la colonie du Gabon à la France
pendant ce conflit ?
I. Le ralliement du Gabon à la France Libre
La Deuxième Guerre mondiale a eu des retombées en France métropolitaine, ainsi qu’au
niveau de l’Outre-Mer, notamment dans les territoires d’Afrique et singulièrement dans la
colonie du Gabon
I. 1. Les conséquences de la défaite militaire française de 1940
Après avoir conquis la Pologne, Hitler se tourne vers l’Ouest. En avril 1940, il attaque le
Danemark et la Norvège pour s’assurer le contrôle du fer suédois. A Narvik, Anglais et Français,
qui ont débarqué au secours des Norvégiens, se heurtent pour la première fois aux Allemands,
et sont contraints de se replier. Le 10 mai 1940, il déclenche la Blitzkrieg ou guerre éclair en
direction de la France en passant par les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, défaits en
quelques jours. Le 13 mai les Allemands franchissent les Ardennes. L’armée française
commandée par les généraux Gamelin et Weygand est coupée en deux. Une partie, isolée à
l’Est, affronte les Allemands et les Italiens, qui entrent en guerre le 10 juin aux côtés de
l’Allemagne. Une autre partie talonnée par les Allemands, réussit à gagner Dunkerque et à
s’embarquer pour l’Angleterre, abandonnant sur place une quantité considérable d’armes et de
matériels. Après six semaines d’engagements Pétain demande l’armistice : 100. 000 soldats
français sont morts, 200. 000 sont blessés, deux millions sont faits prisonniers (Carol,
Garrigues, & Ivernel, 1993 : 88).
Après le déclenchement des hostilités, le second conflit mondial connut donc un premier
tournant décisif au mois de juin 1940 : la déroute de l’armée française vaincue par les forces
nazies, et l’occupation du pays par les forces allemandes. Cette débâcle déboucha sur deux
choses. Militairement, c’est la signature le 22 juin 1940 de l’armistice entre la France et
l’Allemagne, politiquement et sociologiquement, c’est la division de la France entre partisans de
3 Le chinois Sun Tzu ou Sun Zi est le père de la stratégie. Il est l’auteur de l’Art de la guerre , qu’on peut considérer comme le
plus ancien traité de stratégie connu.
4 C’était un général et théoricien militaire prussien né en 1780 à Burg et mort en 1831 à Breslau. Il fut un analyste de la
guerre, de ses finalités, de ses moyens et de tous ses aspects. Il a écrit De la guerre.

l’Etat français basé à Vichy, dont le chef de file est le Maréchal Pétain, appelés pétainistes5 et les
gaullistes6, dirigés par le Général de Gaulle et basés à Londres. Peu après les débuts de
l’occupation, certains Français commencent à collaborer avec les Allemands. Ainsi, le Maréchal
Pétain va décider une collaboration d’Etat avec l’Allemagne à la suite de la rencontre conçue et
organisée par Laval7 entre lui et Hitler en gare de Montoire, le 30 octobre 1940 ; il affirme
qu’aider l’Allemagne est la seule façon de maintenir la souveraineté de la France et d’obtenir des
concessions du Reich (Id : 219).
Ces évènements provoquèrent dans les colonies les mêmes conséquences qu’en
Métropole. Dans un premier temps, l’Afrique Equatoriale Française va répondre favorablement
au camp gaulliste. Cependant, la colonie du Gabon va briser la solidarité qui l’unissait aux autres
territoires en changeant d’avis, avant que la force ne le ramène dans le camp gaulliste.
I. 2. Les affrontements entre Gabonais ou la guerre entre pétainistes et gaullistes
Le ralliement du territoire du Gabon s’est fait au terme d’une lutte fratricide. Avant
celui-ci, précisons d’abord qu’ en juin 1940, la France est au bord de l’effondrement. Les forces
nazies après l’avoir envahie ont pris possession de son territoire. Face à ce désastre, deux voix
vont se faire entendre : celle du général de Gaulle dont l’adresse appelle à la résistance et suscite
l’espoir, d’une part : « …Croyez-moi…. Rien n’est perdu pour la France… La France n’est pas seule !
Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle…Quoi qu’il arrive, la flamme
de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas… » (Appel radiodiffusé de Londres
du 18 juin 1940) et celle du Maréchal Pétain qui appelle à la capitulation, d’autre part: « En ces
heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés…C’est le cœur serré que je vous dis qu’il faut tenter
de cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher
avec nous, entre soldats, après la lutte dans l’Honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités »
(Discours radiodiffusé du 17 Juin 1940).
Répondant à l’appel de de Gaulle, « les anciens combattants noirs et blancs adressèrent
un télégramme au Gouverneur Général Boisson à Brazzaville l’invitant à la résistance, à la
poursuite de la lutte contre l’Allemagne avec l’aide de l’Angleterre » (Métegué-N’nah, 1994 :
431). A travers ce télégramme, les anciens combattants gabonais unanimement choisissent la
bravoure. Ce qui signifie que ce discours a eu un impact sur la fibre patriotique des gabonais.
Ainsi, cette adresse du futur Chef d’Etat français est une invite à la défense de la patrie en
danger. C’est une exhortation à l’honneur de la France éternelle. Par ailleurs, il faut dire que
stratégiquement dans l’esprit du général de Gaulle, le mythe de l’Empire représente et incarne
la puissance de la France libre puisque l’Afrique est une base de départ dans le développement
de la guerre. D’une certaine façon, les enjeux stratégiques de la politique africaine du fondateur
de la Ve République commencent avec ce conflit. Les ressources de l’Empire en terres et en
hommes représentent la première contribution de la France à la victoire. A partir de cet instant,
l’Afrique apparaît comme un instrument de politique internationale et interne de l’ancien sous-
secrétaire à la Défense (Mabileau & Quantin, 1980 : 62-64). Ce qu’il confirme d’une certaine
manière lorsqu’il déclare : « Si nous restons passifs en Afrique, nos adversaires, tôt ou tard
5 Les pétainistes signataires de l’armistice étaient favorables à la cessation des combats et favorables à la paix avec
l’Allemagne.
6 Contrairement aux vichystes, les gaullistes étaient pour la reprise des hostilités en vue de libérer le sol national des mains
des forces de l’Allemagne nazie..
7 Né à Chateldon, Pierre Lavaél était avocat. Socialiste à l’origine, il s’est par la suite rapproché de la droite. Plusieurs fois
ministres, il devint président du Conseil de 1931 à 1932. Partisan de la collaboration active avec l’Allemagne, il a été
condamné à mort et fusillé en 1945.

s’attribueraient certaines de nos possessions, tandis que nos alliés seraient amenés à se saisir, à mesure des
opérations de tels de nos territoires nécessaires à leur stratégie. Participer avec des forces et des terres
africaines à la bataille d’Afrique, c’était faire entrer dans la guerre comme un morceau de la France. C’était
autant que possible détourner l’Angleterre et, peut être un jour l’Amérique, de la tentation de s’en assurer
elles mêmes pour leur compte. C’était enfin arracher la France à l’exil et l’installer en toute souveraineté en
territoire national » (de Gaulle, 1954 : 90).
Face à la réponse gabonaise pleine d’enthousiasme, le gouverneur du Gabon, Masson,
donna son accord à de Gaulle sur l’adhésion des gabonais à la France libre le 28 octobre 1940.
Cependant, deux jours après, sous la triple pression de monseigneur Louis Tardy, de hauts
fonctionnaires, du commandant Poncelet, envoyé supérieur des troupes de l’Afrique Equatoriale
Française pour appuyer l’action des vichystes, le gouverneur Masson revint sur sa décision de
ralliement à la France résistante. Face à cette situation, le nouveau gouverneur de l’A.E.F, le
général de Larminat après une propagande par T.S. F, diffusion de tracts, promesses de place,
distribution d’argent, c’est à dire l’échec du ralliement pacifique, se résolut à faire la guerre aux
vichystes. Il lança deux colonnes à l’assaut du Gabon : la première en provenance du Cameroun,
commandée par le capitaine Dio ; la seconde provenant du Moyen Congo, sous le
commandement du colonel Parant. Les forces des deux camps qui prirent part à la bataille du
Gabon étaient quasiment inégales. Les forces vichystes étaient au nombre de 1. 200
combattants. Les gaullistes, sous l’appellation de « Forces Françaises Libres » étaient estimés à
1.700 hommes de la Légion Etrangère et de la Légion du Cameroun (Mordal, 1951 : 94). En
dépit de la modération des ordres de part et d’autre, d’éviter l’effusion de sang8, la campagne du
Gabon donna lieu à quelques combats meurtriers. Le 15 septembre 1940, la deuxième colonne
arriva au poste de Mayumba qui se rendit sans combattre. Le général de Larminat, visiblement
satisfait de cette victoire rapide fit cette déclaration : « Il ne paraît pas que la dissidence de ce qui
reste du Gabon, dissidence toute artificielle imposée par des marins de passage, puisse se maintenir
longtemps » (Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence, carton 897, dossier 5).
Partis de Mayumba avec ses hommes, le colonel Parant et ceux-ci gagnèrent la Ngounié
où ils affrontèrent le 22 septembre 1940 les vichystes dans la région de Fougamou-Sindara, alors
défendue par deux sections de tirailleurs gabonais qui opposèrent une résistance vite submergée
par les gaullistes commandés par le capitaine Boissoudy. Après ces premiers succès militaires, les
gaullistes sous la conduite de l’adjudant Suzin eurent fort à faire à Ngomo, non loin de
Lambaréné les 16 et 17 octobre 1940. Ils se heurtèrent à plusieurs reprises à trois unités de la
flotille vichyste, dirigée par le Capitaine de Corvette Maistre, qui fut blessé avec d’autres soldats
lors de violents combats. Lambaréné tomba après la capitulation des pétainistes le 5 novembre
1940. Le révérend Père Talabardon trouva la mort au cours de ces combats. La bataille de
Lambaréné fut sanglante. En témoignent ces propos : « L’aviation gaulliste employait à Lambaréné
des bombes de 10 kilos et a également été ravitaillée en bombes de 50 kilos » (Id). Parallèlement, la
première colonne celle dirigée par le Capitaine Dio, avançait en direction de Mitzic qui tomba le
29 octobre 1940. La ville de Libreville ne tarda pas à tomber à son tour aux mains des gaullistes
après des combats aériens et des engagements très violents entre marsouins des deux camps.
L’acte de reddition des pétainistes fut signé par le colonel Crochu et le capitaine de corvette
8 Il est difficile d’éviter une effusion de sang lorsqu’il y a guerre. Cette vision des choses est sujette à caution dans la mesure
où lorsqu’il y a guerre il y a forcément des pertes humaines au niveau des soldats comme au niveau collatéral. La traduction
actuelle de cette approche est celle des Américains qui parlent de guerre avec « zéro mort ». Pour en savoir davantage sur cette
question, on se référera utilement à Bressy (B. de) : « La guerre zéro mort : un rêve américain ? », Défense Nationale, 4,
1999, 22-29.

Roux, le 10 novembre 1940. Les troupes gaullistes firent une entrée triomphale dans la capitale
du Gabon. A leur tour, Port-Gentil et Kango tombèrent le 14 novembre 1940. Défait et amer,
le gouverneur Masson se suicida dans sa cabine du navire le Savorgnan de Brazza où il était
interné. La campagne du Gabon causa la mort d’environ 30 personnes (Mordal, op.cit : 99-104
& de Benoist, 1940 : 13).
Ces dernières victoires consolidèrent la mainmise de la France libre sur l’ensemble de
l’A.E.F. Au regard de ce qui précède, on peut dire que la colonie du Gabon prit une part active
aux côtés du général de Gaulle lors du second conflit mondial. En réalité, le territoire du Gabon
n’a pas attendu ces combats pour entrer en guerre aux côtés de la France, puisqu’en juin 1940,
un officier gabonais, le vaillant capitaine Charles N’tchoreré a commandé non sans bravoure la 7e
compagnie du 53e Régiment d’infanterie coloniale mixte. Cet officier gabonais qui était diplômé
de l’Ecole militaire de Saint-Cyr, est mort au champ d’honneur le 7 juin 1940, fusillé par les
troupes allemandes à Airaines, dans la région française de Picardie, et plus exactement dans le
Département de la Somme9 lors de la reddition de son unité. Une fois aux mains des gaullistes,
le territoire du Gabon apporta sa modeste contribution économique à la France lors de ce
conflit.
II. La contribution économique du Gabon à la France pendant la Seconde Guerre
mondiale
Avant d’analyser l’assistance économique réelle du Gabon à la France durant le second
conflit mondial, arrêtons nous un instant pour des commodités d’analyse, à l’utilité économique
des colonies pour la Métropole.
II. 1. De l’utilité économique des colonies
« Un peuple qui veut conserver sa vitalité doit s’étendre et essaimer. L’Afrique nous est ouverte. La
vocation coloniale était la seule véritable vocation de la France ». Ce message véhiculé par les théories
de Leroy-Beaulieu était plus patriotique et non économique. Aussi ne fut-il pas compris par ceux
auxquels il s’adressait en premier lieu. Il était de notoriété publique que les capitalistes français
s’étaient toujours refusés à investir en Afrique. Ils préféraient la sécurité des rentes et des
obligations. En 1914, les investissements français en Afrique subsaharienne ne représentaient au
total que 4 % environ de l’ensemble des investissements français à l’étranger. Ce point de vue a
fini par évoluer. Ainsi, Jules Ferry, sur le plan économique partageait les thèses de Leroy-
Beaulieu. Et préconisait une colonisation moderne, c’est-à-dire l’exportation des capitaux et des
biens. Dans son esprit, la première fonction économique d’une colonie était d’être un débouché
pour les produits manufacturés de la Métropole (Wesseling, 1994 : 31-35).
C. R Agéron (1973 : 9), souscrit à cette thèse car pour lui, l’utilité économique des
colonies était de contribuer au grand essor du commerce de la Métropole, d’activer,
d’entretenir son industrie, et de fournir aux habitants de la Mère-Patrie, industriels, ouvriers,
consommateurs un accroissement de profits, de salaires et de jouissances. A travers ces propos,
le constat qu’on peut faire, c’est que les colonies10 sont pour la France des pourvoyeurs de
richesses, notamment en termes de débouchés pour son industrie, de profits substantiels pour
ses entreprises, des salaires intéressants pour ses travailleurs et des gains conséquents pour ses
9 Le département de la Somme a pour chef lieu la ville d’Amiens, qui est aussi le chef-lieu de la Région de
Picardie.
10 D’une certaine façon, les colonies étaient les vaches à lait de la France. L’effort de guerre lors du second conflit mondial
demandé aux territoires de l’Afrique Equatoriale Française et notamment au Gabon a confirmé cette perception des choses.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%