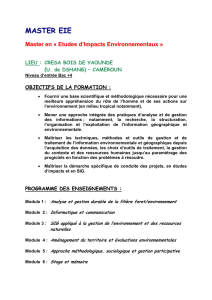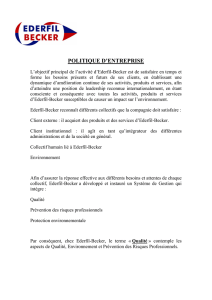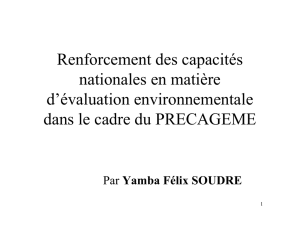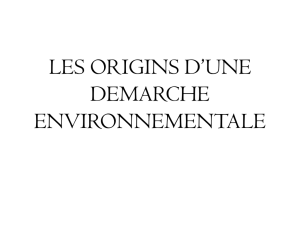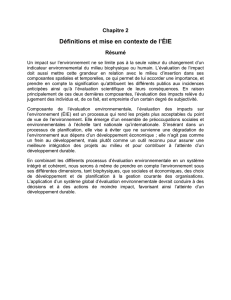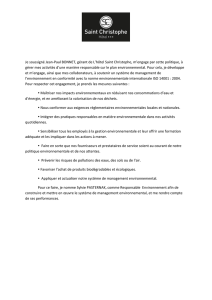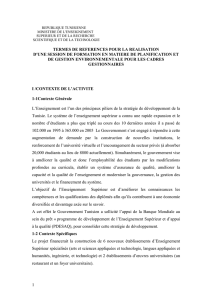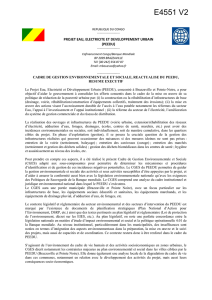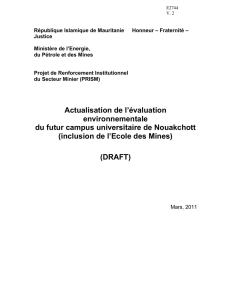Rapport atelier formation PRAPS BM finale - PRAPS

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice
Ministère de l’Elevage
UNITE DE COORDINATION DU PROJET REGIONAL
D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (UCP-PRAPS)
Accord de Don N° D0660-MR
Rapport de formation sur les mesures
de sauvegardes environnementales et
sociales de la Banque Mondiale
Etabli par Mohamed Abdellahi SELME, Consultant
Juillet/Août 2016

2
I. Contexte de la formation
Les importants changements que connaissent les pays du Sahel, qu’ils soient climatiques,
socio-économiques, agro-écologiques ou institutionnels, bouleversent le pastoralisme et sont
aussi à l’origine de nombreuses évolutions qui appellent à renforcer la résilience des
communautés pastorales.
Le renforcement de cette résilience, à l’échelon de la bande sahélienne, implique de travailler
sur un certain nombre d’actions intégrant des interventions préventives (systèmes d’alerte
précoce), des mesures humanitaires (dispositifs de protection sociale), ainsi que des actions de
développement.
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme en Mauritanie (PRAPS-MR) vise l’amélioration
des moyens et services de production essentiels et l’accès aux marchés pour les pasteurs et
agropasteurs dans les zones ciblées par le projet ainsi que l’amélioration de la capacité
nationale à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgence.
La décision d’élaboration du projet découle de la déclaration de Nouakchott sur le
pastoralisme, adoptée le 29 octobre 2013, par les dirigeants de six pays du Sahel (Burkina,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad).
Le PRAPS-MR a une durée de 6 ans et comporte 5 composantes complémentaires et
interdépendantes :
(a) Améliorer la santé animale,
(b) Améliorer la gestion des ressources naturelles,
(c) Faciliter l’accès aux marchés,
(d) Améliorer la gestion des crises pastorales et
(e) la Gestion du Projet.
Le PRAPS a l’ambition de financer et de mettre en œuvre des infrastructures pastorales tels
que les parcs de vaccination, les réserves pastorales, des marchés à bétail, des aires de repos
pour les transhumants, des centres de collectes de lait et des mini laiteries, des aires
d’abattages, des puits, forages, mares sur creusées, des grandes quantités de doses de vaccins
et campagnes de vaccinations à grandes échelles, des postes de surveillances
épidémiologiques.
La mise en œuvre des sous-projets du PRAPS va engendrer des impacts positifs sur le plan
socioéconomique mais risque également d’engendrer des impacts négatifs potentiels sur les
ressources naturelles, sur l’environnement et sur les populations. Elle doit être en conformité
avec les règlementations environnementales des pays bénéficiaires et aussi avec les politiques
de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale.
Une pré-évaluation environnementale et sociale a été effectuée lors de la préparation du projet
ayant abouti au classement de tout le projet en B, et les instruments de sauvegardes appropriés
liés à la nature des interventions ont été élaborés : un Cadre de Gestion Environnementale et
Sociale (CGES) et un Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP).

3
L’objectif de ces instruments est d’aider les bénéficiaires à identifier les risques potentiels des
interventions/activités du projet, proposer les mesures de mitigation y afférentes, les
arrangements institutionnels à prendre en compte, les mesures de suivi évaluation à
considérer, le mécanisme d’implication, de concertation et de communication requis pour la
mise en œuvre du CGES et du CPRP.
II. Objectifs de la formation
L’objectif principal de cet atelier est le renforcement des capacités des partenaires impliqués
dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PRAPS-MR relatives à l’application des
instruments de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque Mondiale et la
règlementation environnementale nationale. Il s’agira d’octroyer aux différents partenaires,
institutions, la société civile impliquées dans la mise en œuvre du PRAPS-MR, les
informations et outils nécessaires sur les dispositions et procédures contenues dans le CGES
et le CPRP, l’Evaluation environnementale au niveau national afin d’en assurer une meilleure
application.
Pour ce faire les objectifs spécifiques poursuivis sont les suivants :
Brève présentation sur le processus d’Evaluation Environnementale et Social au
niveau national et des politiques de la Banque mondiale ;
Présentation succincte du projet et illustration avec des études des cas en évaluation
environnementale et sociale dans le secteur de l’élevage (impacts potentiels et mesures
de mitigation) ;
Présentation détaillée du CGES et CPRP et des différentes institutions impliquées
dans la mise en œuvre, les rôles et responsabilité, les arrangements institutionnels, le
suivi et évaluation, les indicateurs de suivi, du CGES et du CPRP.
III. Approche méthodologique et déroulement de la formation
Les trois ateliers, le premier à Nouakchott et les deux autres à Kaédi et Aioun, se sont
déroulés sur deux jours chacun selon l’approche suivante (voir diagramme ci-dessous) :
Une mise à niveau sur le plan théorique pour permettre à l’assistance d’avoir les
éléments nécessaires pour appréhender les actions à prendre en vue de maintenir les
impacts négatifs des sous-projets du PRAPS à un seuil tolérable par les milieux
récepteurs ;
Deux présentations, l’une relative au projet PRAPS-MR lui-même et les instruments
de sauvegarde environnementale et sociale qu’il a déclenchés qui devraient être mis en
adéquation avec la règlementation environnementale nationale en vue d’assurer une
mise en œuvre des sous-projets tout en respectant les aspects environnementaux et
sociaux et l’autre est une illustration d’un projet mis en œuvre dans prise en compte de
la dimension environnementale, il s’agit de l’Abattoir de Tenweich.

4
L’atelier de Nouakchott, qui s’est déroulé les 16 et 17 août 2016, a regroupé les institutions de
l’Etat concernées par la mise en œuvre du PRAPS-MR. Il s’agit, en plus des directions
centrales et des centres de recherche du ministère de l’Elevage, de la Direction du Contrôle
Environnemental qui suit administrativement et techniquement la validation des EIE et des
NIE au sein du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Des institutions
(Direction de l’Hydraulique, Direction de la Protection de l’Environnement) et des
organisations non gouvernementales et socio-professionnelles (AMAD, GNAP, FNCBM) ont
été également invitées à participer activement à l’atelier de Nouakchott. L’atelier a vu la
participation de 26 personnes formées.
Les ateliers de Kaédi et d’Aioun se sont déroulés respectivement les 22 et 23 et 25 et 26 août
2016. L’atelier de Kaédi a regroupé les services techniques des ministères de l’Elevage, de
l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Hydraulique des wilayas du Trarza, du Guidimaka,
de Brakna et du Gorgol en plus des ONG et des organisations socioprofessionnelles du
secteur de l’Elevage. L’atelier d’Aioun a regroupé les services techniques des mêmes
ministères à l’Assaba et aux deux Hodhs en plus des ONG et des organisations
socioprofessionnelles du secteur de l’Elevage au sein de ces trois wilayas.
Le nombre total de personnes formées est respectivement de 26 à Kaédi et 25 à Aioun.
IV. Contenu de la formation
Le PRAPS-MR finance des sous-projets qui ont des impacts positifs sur le plan
socioéconomique mais risquent d’être négatifs sur les ressources naturelles, sur
l’environnement et sur les populations. Il doit être en conformité avec la règlementation
environnementale nationale et les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de

5
la Banque Mondiale. Il a déjà bénéficié d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(CGES) et un Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP).
IV.1. Le processus national de l’évaluation environnementale
La Mauritanie dispose d’une loi-cadre sur l’environnement (Loi N°2000-045 du 26 Juillet
2000 portant Code de l’Environnement) et ses décrets d’application (Décret 2004-094 du 8
novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement modifié et complété par le
Décret 2007-105 du 13 avril 2007.
Selon l’annexe du Décret 2007-105, les projets peuvent être classés soit en catégorie A,
catégorie B ou hors catégorie (voir figure ci-dessous). La catégorie A nécessite une étude
d’impact sur l’environnement (EIE), la catégorie B nécessite une Notice d’impact sur
l’environnement (NIE) qui n’est rien d’autre qu’une EIE allégée et les projets hors catégorie
ne nécessitent aucune mesures environnementale ou sociale.
La procédure de l’EIE :
Le promoteur déclenche la procédure par l’élaboration des termes de référence (TdR) de l’EIE
du projet et les transmet au ministère chargé de l'environnement et au ministre compétent aux
fins du cadrage de l'étude. Le cadrage vise à identifier les éléments de l'environnement qui
peuvent être affectés par le projet et pour lesquels une préoccupation publique,
professionnelle ou légale se manifeste. Il s’agit, en outre, de vérifier que les modalités
d'information et de participation du public sont clairement définies.
Les TdR doivent contenir au moins les points suivants :
o Une description de l'Avant-Projet Sommaire (APS) ou de l'Étude de Préfaisabilité
(EPF) du Projet ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%