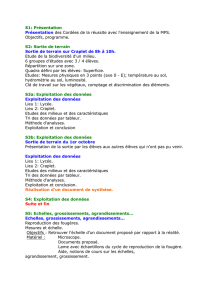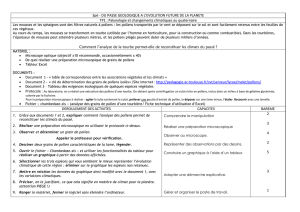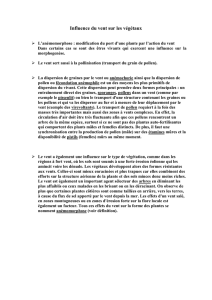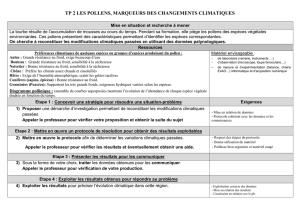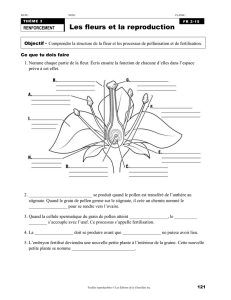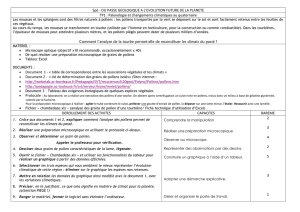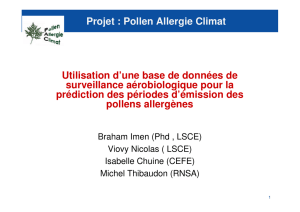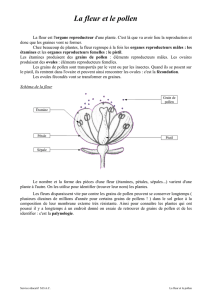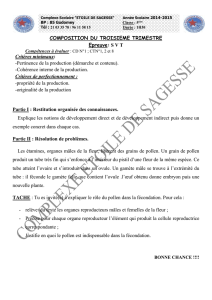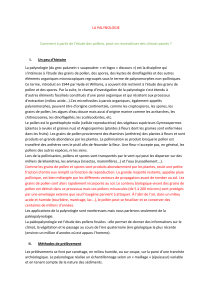fiche enseignant-2014

Fiche enseignant
Extrait du programme de Terminales S spécialité
Enjeux planétaires contemporains
« Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir »
Les bulles d'air contenues dans les glaces permettent d'étudier la composition de l'air durant
les 800 000 dernières années y compris des polluants d'origine humaine. La composition isotopique
des glaces et d'autres indices (par exemple la palynologie) permettent de retracer les évolutions
climatiques de cette période.
Extrait du texte d'accompagnement des programmes
L’utilisation de données paléontologiques
Pour reconstituer l’évolution des climats, on peut utiliser des « paléothermomètres » biologiques.
Certains groupes d'animaux ou de végétaux donnent une bonne indication du climat car ils ne vivent que
dans des climats chauds ou froids. Les coraux, par exemple, sont d'excellents indicateurs biologiques : ils
ne se développent que dans les mers chaudes des zones tropicales. En milieu continental, les grains de
pollen produits par les plantes à fleurs et les spores produites par d’autres végétaux peuvent se conserver
durant des milliers d'années dans des tourbières ou dans des grottes, et donner ainsi des renseignements
sur la flore qui existait à cette période, et donc sur le climat de l'époque.
Pour les derniers milliers d'années, l'étude de l'épaisseur des anneaux de croissance des arbres
permet de repérer les moments de croissance particulièrement faibles, c'est-à-dire les années très froides.
Cependant, la majorité des dépôts anciens ne contient pas de fossiles simples à interpréter. De plus, les
indicateurs biologiques reflètent un climat local et il n'est pas toujours aisé de le mettre en relation avec le
climat global.
Les spores et les grains de pollen sont disséminés par les plantes et se conservent durant des
centaines de milliers d'années quand ils sont enfouis dans les sédiments de milieux humides (lacs,
tourbières, océan ...). Les sédiments archivent de cette manière les états successifs de la végétation
environnante. La palynologie permet d'identifier les plantes qui émettent le pollen à partir de la forme des
grains et par là de reconstituer le paysage végétal correspondant. Cette reconstitution nécessite de
connaître la relation entre les types de végétation et leur production de pollen ainsi que la dispersion de ce
dernier. Cette question fait l'objet de nombreuses études. Le palynologue mesure l'abondance des
différents taxons identifiés dans chaque niveau du sédiment et établit ainsi un « assemblage » ou encore
«spectre » pollinique à chaque étape du passé. Ce sont les fluctuations de ces assemblages le long d'un
profil sédimentaire, représentées sous forme d'un diagramme pollinique, qui sont utilisées pour reconstituer
l'histoire de la végétation à proximité du site de prélèvement. Des techniques statistiques appropriées
permettent d'en déduire l'histoire du climat.
En Europe, des milliers de diagrammes polliniques couvrant l'histoire de la végétation passée
depuis des milliers d'années ont été établis depuis des décennies. Afin de préserver ces archives et surtout
de pouvoir établir des synthèses à l'échelle du continent, il a été décidé en 1989 d'établir une base
européenne de données polliniques (EPD). Cela suppose un cadre informatique bien établi et un important
effort d'harmonisation des données, en particulier du point de vue de la nomenclature taxonomique.
Activités envisageables :
Mise en évidence de la variabilité climatique du quaternaire récent dans les sédiments continentaux des
lacs et tourbières : sédimentologie et analyse des pollens dans des séries sédimentaires actuelles et
passées.
Présentation de l’activité :

Cette activité porte sur l’utilisation de diagrammes polliniques pour la reconstitution de l’évolution du
paléoenvironnement et des climats du quaternaire de l’Auvergne.
Supports didactiques :
• Fiche activité élève (doc 1)
• Fichiers EXCEL des résultats bruts (EPD) des relevés polliniques 5 et 3 de la tourbière de
CHAMBEDAZE
• Diagramme pollinique simplifié de CHAMBEDAZE (doc 2)
• Préférendums écologiques des végétaux
• Lames de grains de pollen de référence et en mélange
• lames de grains de pollen fossiles
• Clé de détermination des grains de pollen (doc 3)
• Clé USB «Reconstitution du paléoenvironnement et des climats en Auvergne au quaternaire»
L’activité proposée comprend quatre parties :
1. Découverte des pollens
• L'organe de reproduction --> Etude de la place du grain de pollen dans la reproduction des plantes
à fleurs.
• La structure d’un grain de pollen --> Schéma annoté d’un grain de pollen.
2. Diversité des pollens
• Détermination de grains de pollens actuels et/ou fossiles : Observation de pollens en mélange :
identification des espèces en référence à l'aide d'une clé de détermination et/ou d'un atlas (Clé)
3. Utilisation de relevés bruts et réalisation de spectres polliniques simplifiés
• Utilisation d'un fichier EXCEL de données brutes et réalisation d'un spectre pollinique simplifié
(choix judicieux des taxons à utiliser en fonction des espèces proposées et des espèces de
référence)
4. Analyse et mise en relation des documents réalisés
• Analyse et mise en relation des diagrammes simplifiés de CHAMBEDAZE 3, CHAMBEDAZE 5 et
Reconstitution de l’évolution climatique de la région sur les derniers 13 000 ans
1
/
2
100%