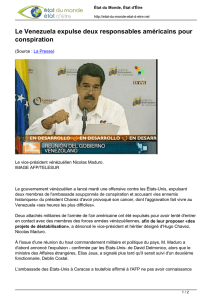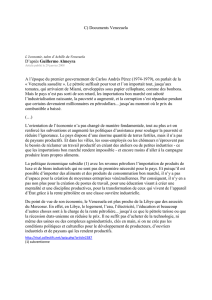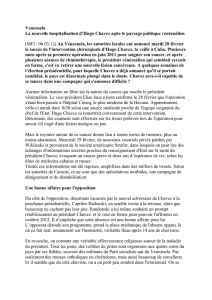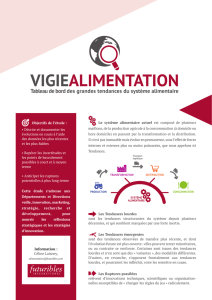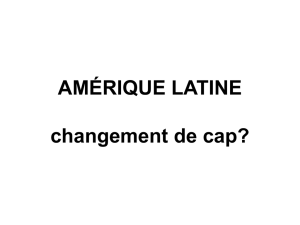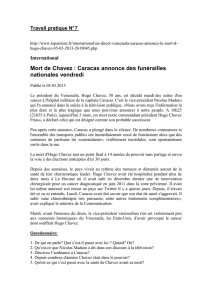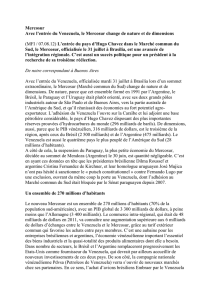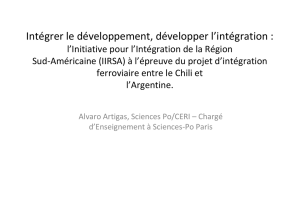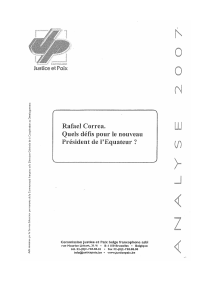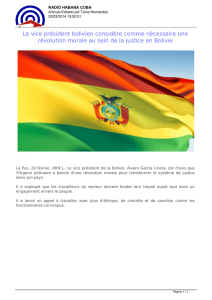Brève Vigie, 1er juillet 20009 L`Union des nations sud

© Futuribles, Système Vigie, 1er juillet 2009
Brève Vigie, 1er juillet 20009
L’Union des nations sud-américaines : quelles perspectives ?
À l’occasion du premier anniversaire de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR), sa
présidence tournante change en juin 2009. Le président équatorien Rafael Correa remplace
ainsi la présidente chilienne Michelle Bachelet. Cette succession arrive alors que la jeune
UNASUR peine à se développer et que son futur président apparaît d’ores et déjà comme une
personnalité moins consensuelle que son prédécesseur, notamment en raison de son alliance
avec le Vénézuélien Hugo Chavez et le Bolivien Evo Morales au sein de la « trinité
socialiste ».
Issue de l’accord de Cuzco du 8 décembre 2004 visant à réunir le Mercosur (1), la
Communauté andine (2), le Chili, le Guyana et le Surinam, l’UNASUR naît formellement le
23 mai 2008. Elle rassemble les 12 pays d’Amérique du Sud ; Panama et le Mexique
deviennent pays observateurs. Cette organisation supranationale se veut alors économique et
politique.
Économique d’abord puisqu’elle a pour objectif la suppression de 90 % des droits de douane
existants et la mise en place d’une union douanière entre tous les pays d’Amérique du Sud.
Comme l’Europe des origines, l’Amérique du Sud se construit sur l’énergie. Un enjeu
important compte tenu des richesses de la région (pétrole, gaz, agrocarburants, lithium). Un
Conseil de l’énergie devrait ainsi être constitué pour mettre en valeur les ressources, les
utiliser de façon durable et solidaire à l’intérieur de l’UNASUR, et se présenter comme un
acteur majeur de ce secteur sur la scène mondiale. S’inspirant de l’Union européenne, son
modèle revendiqué, l’UNASUR souhaite disposer d’une banque et d’une monnaie communes.
La mise en place d’une monnaie commune devrait prendre du temps, mais la création de la
banque pourrait être plus rapide. Proposée par le Venezuela, cette Banque du Sud serait un
fonds monétaire et un organisme de prêt finançant programmes sociaux et construction

© Futuribles, Système Vigie, 1er juillet 2009
d’infrastructures, avec à sa tête un conseil d’administration composé des ministres de
l’Économie d’Amérique du Sud. En mars 2009, les pays ont fixé les montants des
contributions qu’ils apporteraient au capital de départ de la banque (14 millions de dollars
US), qui doit être basée à Caracas (Venezuela).
Tenant compte des limites d’une intégration uniquement économique et désireux de parler
d’une seule voix qui serait mieux écoutée par les instances internationales, les pays
d’Amérique du Sud ont fait de l’UNASUR une organisation également politique. Outre le
Conseil des chefs d’État et de gouvernement, le Conseil des ministres des Affaires étrangères
et le Secrétariat général (situé à Quito, Équateur), ses trois organes principaux, l’UNASUR
dispose depuis peu d’un Conseil sud-américain de défense (CSD). Lancé en mars 2009, ce
dernier a pour mandat de favoriser le dialogue et la coopération entre les forces armées sud-
américaines. S’il est susceptible de donner lieu à l’élaboration d’une politique de défense
commune, il ne vise pas à la création d’une armée conjointe. En outre, l’UNASUR envisage
la mise en place d’une citoyenneté commune, ainsi que d’un Parlement sud-américain dont le
traité constitutif de l’UNASUR ne précise que sa future localisation, à Cochabamba en
Bolivie. La création du Parlement doit attendre un protocole additionnel qui devra notamment
préciser sa composition.
Plusieurs obstacles expliquent le développement relativement lent de l’UNASUR, au-delà du
frein conjoncturel qu’est la crise économique. L’Union souffre de mécanismes de décision
faibles, qu’il s’agisse de la règle du consensus ou de l’absence de véritables compétences
supranationales. Il faut également ajouter les querelles de personnes et le poids de l’histoire :
tensions entre la Bolivie et le Chili issues de la guerre du Pacifique (1879-1884), « guerre du
papier » entre l’Argentine et l’Uruguay (3), escalade verbale entre les présidents du
Venezuela et de l’Équateur d’une part, et celui de la Colombie d’autre part.
Mais le principal handicap de l’UNASUR semble être l’antagonisme entre les modèles de
société proposés. Si le consensus européen autour de l’économie sociale de marché est
relativement suivi par la majorité des pays d’Amérique du Sud, il est combattu par la gauche
radicale au pouvoir au Venezuela, en Équateur et en Bolivie, ce que certains nomment la
« trinité socialiste ». Cette proximité entre les trois chefs d’État se base sur leur choix du
« socialisme du XXIe siècle » (plus grande mainmise de l’État sur l’économie et les
programmes sociaux) et leur méfiance à l’égard des États-Unis. L’accès à la présidence de
l’UNASUR de l’un d’eux, l’Équatorien Rafael Correa, pourrait souligner et accentuer les
dissensions internes de celle-ci. Fin mai, il déclarait ainsi vouloir proposer à l’Union un
organisme de défense des citoyens et des gouvernements face aux abus de la presse.
Largement soutenue par Hugo Chavez et Evo Morales, cette proposition sonne comme une
menace pour la liberté de la presse alors que Rafael Correa a déjà fait fermer trois chaînes de
télévision et une de radio, dans son pays, en 2008.
Si l’avenir de la jeune UNASUR peut sembler incertain en raison de faiblesses internes, sa
création reste importante car, pour la première fois, l’intégration régionale apparaît comme la
meilleure issue à la plupart des pays sud-américains. Dans l’hypothèse où cette union
économique, politique et monétaire se réaliserait, elle serait alors la plus vaste du monde
(360 millions d’habitants sur 17 millions de km2) et pourrait encore s’accroître. En effet, à
partir de 2013, les États d’Amérique centrale et des Caraïbes auront le droit d’y adhérer.
Théoriquement, l’UNASUR pourrait donc s’étendre jusqu’à la frontière sud des États-Unis.
Claire Lescoffit, Futuribles International

© Futuribles, Système Vigie, 1er juillet 2009
Sources : MINZONI Antonio. « UNASUR en movimiento ». El Universal, 1er juin 2009 ;
« De Cuzco (2004) à Brasilia (2008). UNASUR : lente et ambitieuse Union des nations sud-
américaines ». Latinreporters.com, 30 mai 2008 ; KHABOU Ben. « Le virage “à gauche” de
l’Amérique latine ». Agoravox, 27 mai 2009 ; OUALALOU Lamia. « L’UNASUR fête un an
d’existence ». Mediapart, 25 mai 2009 ; « Chavez, Correa et Morales ressoudent leur “trinité
socialiste” ». Lepoint.fr, 25 mai 2009 ; « Chavez et Correa veulent créer un organisme de
défense de la presse ». Agence France Presse, 24 mai 2009 ; MAZZUCHI Nicolas.
« UNASUR : la fin de l’hégémonie des États-Unis en Amérique ? » Matrices stratégiques, 17
avril 2009 ; « Le Conseil sud-américain de défense est inauguré ». Québec : Centre d’études
interaméricaines (université de Laval), 11 mars 2009.
(1) Le Mercosur (ou marché commun du Sud) est une communauté économique née en 1991
réunissant cinq pays d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela).
(2) La Communauté andine est une communauté économique née en 1996 réunissant quatre
pays andins (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou).
(3) Nom donné au contentieux concernant la construction de deux grandes usines de
production de papier sur les rives du fleuve Uruguay, du côté uruguayen de la frontière entre
les deux pays et à laquelle l’Argentine s’oppose en raison des risques de pollution.
Catégories : 01. Géopolitique mondiale / 02. Géoéconomie et finances / 05. Institutions,
politiques publiques et gouvernance
Mots-clefs : Amérique du Sud / Coopération économique / Géopolitique
1
/
3
100%