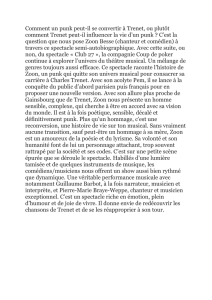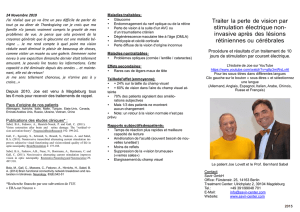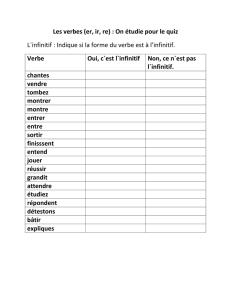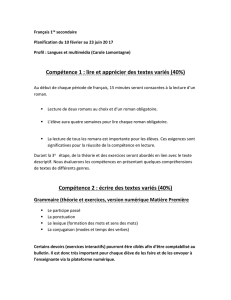12/07/2016 11:14:05\\PC-09516PC-09516\\PC

Eté 1977. Slough, banlieue de Londres.
Trois accords de guitare, riffs hargneux, deux minutes trente de pure adrénaline, le punk rock des Sex Pistols ou des Clash ne s’embarrasse
pas de fioritures et de leçons de solfège pour dégommer les Yes et autres Genesis. Les paroles invitent à l’émeute, l’énergie électrise un été
torride et Joe, 15 ans, s’éveille à la vie. Le punk l’exalte, le révèle, le trouve : « Et c’est ce qui est génial avec la musique, surtout avec les
nouveaux groupes, parce qu’ils mettent en mots tout ce qu’on pense. Comme l’album The Clash. Les chansons, elles résument notre vie. Ce
disque, il était déjà là, en nous, il attendait juste que quelqu’un l’écrive. » Joe est un bon petit gars. Il a des parents, des embrouilles, des
espoirs. Il occupe ses journées à cueillir des cerises pour quelques livres afin de pouvoir se payer des disques et les superbes Doc Martens
dix œillets dont il rêve. Quelques pintes au pub, il faut bien grandir. Des concerts magiques, tout regarder, tout noter pour ne rien oublier.
Un pote avec qui se marrer. La vie, quoi. L’univers de Joe s’écroule au cours d’une soirée où, lui et son ami Smiles tombent sur une bande
de types qui, sous prétexte de se faire des petits punks, les dérouillent et les jettent dans le canal. Smiles est déjà peu gâté par l’existence ;
sa mère s’est suicidée quand il était gamin et il est élevé par un père surnommé « Staline » pour ses méthodes d’enseignement. Joe se tire
bien physiquement de cette agression, mais Smiles met plus de temps à remonter, plonge dans le coma quelques jours et garde de graves
séquelles. Joe, psychologiquement, s’en remet difficilement. Il passe plusieurs années à se reconstruire. Etouffé par la culpabilité d’avoir
mieux résisté que son copain, il s’exile. Il lui faudra atteindre l’Asie pour se retrouver. A son retour à Londres, il monte son entreprise de
disques d’occasion et fait le DJ dans des pubs. Human punk est Le roman punk et Le roman sur l’adolescence. Roman à la sensibilité
exacerbée, le trait est délicat, le ton est juste quand il s’agit d’évoquer les émois propres à cet âge qui arrache à l’enfance et fait
douloureusement prendre conscience des injustices du monde. Roman social, presque naturaliste, il raconte aussi l’époque, à travers les
yeux du petit punk, témoin des bouleversements qui agitent l’Angleterre de cette fin des 70’s, du début des 80’s : les attentats de l’IRA font
des morts ; le National Front gagne du terrain, la gauche se radicalise dans un dernier sursaut avant l’arrivée prochaine de la dame de fer.
Respect des différences, autodérision, conscience et méfiance politiques, la philosophie punk est noble, loin des clichés rances sur les
crêteux décérébrés amateurs de bière tiède et de slogans faciles. Roman à consonances fortement autobiographiques, comment ne pas
entendre John dans les mots de Joe ? : « L’école ne nous apportait rien. Le punk, c’était ça notre éducation, les paroles qui reflétaient ce
qu’on vivait, visaient droit dans les choses qu’on voyait, pensait, les noms des gens qui avaient droit à notre respect parce qu’ils écrivaient
de l’intérieur sur l’extérieur, et non pas de l’extérieur, comme la plupart du temps. Tout ce que nous offrait l’école, c’était un disque rayé,
l’aiguille coincée sur des dates de batailles et des hommes politiques, les têtes de nos seigneurs et maîtres soigneusement reproduites, leurs
vêtements richement colorés, écrasant de leurs donjons la lie au-dehors, la masse des paysans tout gris parqués dans des cabanes au-delà
des remparts de la ville, des serfs sans visage nourris de navets.(…) C’était si ennuyeux, si hors de la réalité qu’on finissait par croire les
profs qui nous disaient qu’on était incapables d’assimiler la culture (…) Certaines personnes trouvent leurs idées dans les livres, mais pour
nous, des gens comme Rotten, Strummer, Pursey et Weller étaient les plus grands auteurs, ceux qui produisaient une littérature qui nous
parlait de nos vies. Ils n’avaient besoin de rien contrefaire, d’aucune recherche, ils écrivaient simplement sur ce qui s’agitait en eux, et
parlaient à des millions d’autres gens qui ressentaient la même chose. C’étaient des auteurs authentiques, contemporains, ceux qui parlent
de la vie de tous les jours, comme on en a si peu eu en Angleterre, des auteurs qui parlaient sous forme de musique parce qu’ils n’avaient
jamais songé à le faire sous forme de livre, étant complètement hors de la sphère littéraire, sans aucune des références classiques. Et c’est
ça qui les rendait si particuliers, c’est que leurs références étaient les nôtres, elles se trouvaient là, dans nos vies, et non dans la Grèce
antique, à des milliers de kilomètres, à des milliers d’années de nous ».
Marianne Peyronnet
1
/
1
100%