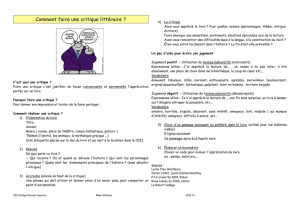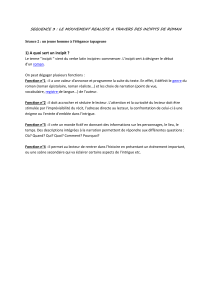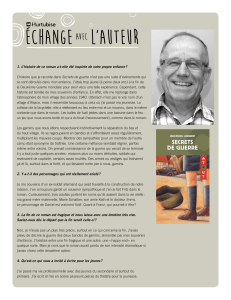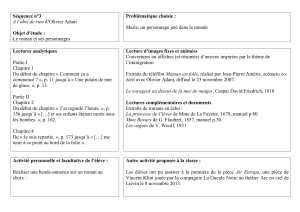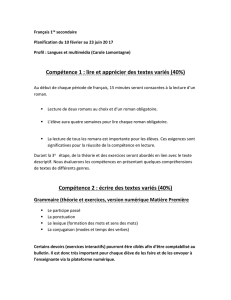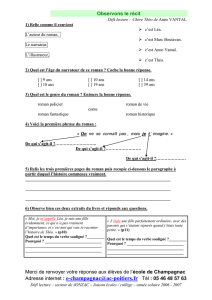Word - Le Château d`Avanton

Si
la
littérature
ne
bouscule
pas
à
quoi
sert-elle
?
(
Essai
de
Viviane
Youx)
Elle apparait déjà fortement amputée, puisque le roman a tendance à phagocyter les autres genres au point que
lire et écrire en deviennent presque des verbes intransitifs :Implicitement lire et écrire se réfèrent à un roman
(éventuellement quelquefois un recueil de nouvelles : on a bien vu le succès populaire d’Anna Gavalda avec «
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part »).
Alors, si nous nous cantonnons à cet implicite et nous en tenons au roman, qu’allons-nous chercher dans ces
fictions narratives ? Que l’on nous raconte des histoires, mais rien de plus facile ! Parents, nous avons chaque
soir endormi nos enfants avec des contes, pour retrouver peut-être ce fil narratif suspendu depuis notre propre
enfance. Et aujourd’hui, la publicité commerciale, la propagande politique racontent ; rien ne marche aussi bien
que l’identification à une image populaire, l’émotion utilisée pour soutenir une idée. Les faits ne suffisent plus,
soit ils sont tellement bruts qu’ils en paraissent irréels, soit nous les voyons sans vraiment les intégrer, ils nous
restent étrangers. Non, si l’on veut nous faire « comprendre », entrainer notre adhésion, rien ne vaut une
romance.
A tel point que nous nous finissons par valoriser le superficiel, le "bien écrit", le scénario qui se tient, l’intrigue
moralisatrice au détriment de la littérature. Qu’un écrivain se hasarde à une langue heurtée, avec les mots qui
s’entrechoquent de ceux qui ont du mal à se dire, qu’il ne donne pas les clés des questions qu’il pose, et là
nous aurons l’impression que l’intrigue tourne à vide, que nous sommes trompés.
Et pourtant !
Il peut arriver qu’un texte simple devienne un « best-seller » par le bouche-à-oreille : ce fut le cas de "Matin
Brun" de Franck Pavloff, une nouvelle qui fonctionne, assez simple pour être compréhensible par tous, assez
métaphorique pour ne pas tomber dans la mièvrerie.
Mais, malgré tout, souvent, les vrais textes sont ceux qui résistent, dont la première lecture ne livre pas tout.
Les "Ames Grises" de Philippe Claudel, par exemple, vous demande d’arriver à la fin pour comprendre qui est
le narrateur ; et comment ne pas voir alors que toute votre lecture, échafaudée sur des hypothèses hasardeuses,
tombe et nécessite d’être reprise ?Si vous en restez au premier degré, comment ne pas hurler quand, à la fin de
"Fever", de Leslie Kaplan, les deux lycéens qui ont commis un crime gratuit digne de Gide, passent leur bac
presque tranquillement et continuent à « courir » ; si vous voulez y voir un fait divers, c’est évidemment
inadmissible ; si vous creusez et y comprenez la métaphore du nazisme, vous ne pouvez imaginer que l’auteure
aurait pu donner une fin moralisatrice à son roman qui n’aurait plus aucun sens.
Imaginez que Nancy Huston ait écrit "Lignes de faille" en s’en tenant à une construction classique, et à une
langue uniforme : toute la force de son roman vient bien de cette mise en abyme, de cette plongée progressive
de point de vue en point de vue, depuis l’enfant-roi tyran américain, jusqu’à la petite fille juive ; et là aussi,
même si vous percevez peu à peu la construction, le texte résiste, et vous force à des retours en arrière
indispensables à la compréhension.
Rien de tel chez Amélie Nothomb, la plupart du temps, en tout cas dans son dernier roman. Dans "Les
Combustibles", ou dans "Stupeur et Tremblements", même si la narration était simple, elle touchait des thèmes
plus profonds qui pouvaient bousculer le lecteur : l’anéantissement d’êtres humains broyés par la guerre, par

une culture d’entreprise. Mais, même si elle raconte bien, si elle est évidemment populaire car facile à lire,
comment ne pas être inquiet de la voir chaque année produire un nouveau roman sur le même modèle que le
précédent ?
Il faut bien qu’elle vive, certes ; si l’on considère l’écriture comme un commerce comme un autre, pourquoi pas
? Ce qui me gêne le plus, c’est que l’édition soit monopolisée par quelques auteurs très médiatisés, dont on sait
que, quoi qu’ils écrivent, ils seront achetés, on a même vu cette année Pennac obtenir le Goncourt pour un
essai, comme s’il avait besoin de cela pour vendre, alors que nombre d’auteurs, plus novateurs, avec une
véritable écriture et des questions qui bousculent, ont bien du mal à passer la barre. Si la littérature consiste
seulement à savoir bien tourner des histoires dans une langue fluide, alors autant regarder des séries télévisées,
c’est moins fatigant!
Viviane Youx
Vous pouvez lire les commentaires et ajouter le votre sur le format parchemin du site internet.
1
/
2
100%