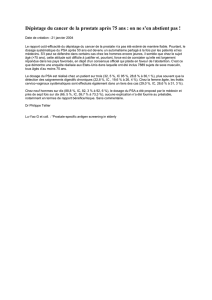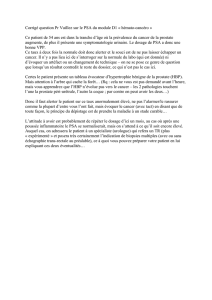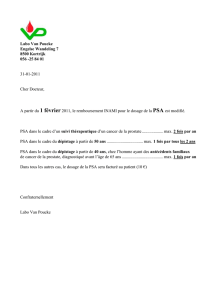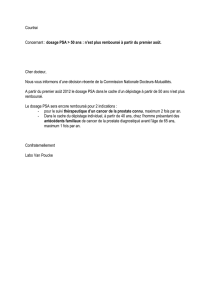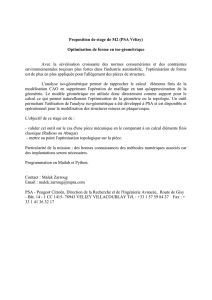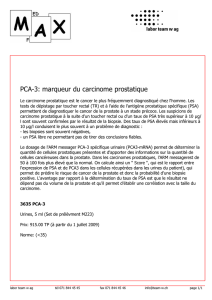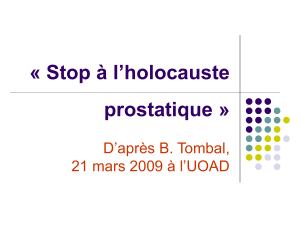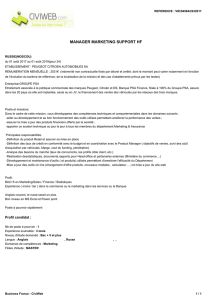PSA et pathologies prostatiques_FE PREST 1062 (01)

INTRODUCTION
Le PSA (Antigène Spécifique de la Prostate) est le marqueur sérique le
plus fiable dont on dispose actuellement dans le cancer de la prostate. Il
présente un intérêt au moment du diagnostic mais aussi en suivi
thérapeutique dans la détection des récidives. Il faut cependant en
connaître les limites.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES PATHOLOGIES QUI AFFECTENT
LA GLANDE PROSTATIQUE ?
Toutes les maladies de la prostate sont susceptibles d'élever la
concentration sérique du PSA. Trois pathologies principales se partagent la
majorité de ces affections :
- La prostatite : elle peut survenir à tout âge. Elle est surtout gênante par
son caractère récidivant et le risque important de complications de type
orchite. Cliniquement, le diagnostic est évoqué devant une hyperthermie
avec frissons, des brûlures à la miction, des urines troubles. La
cytobactériologie des urines confirme la pyurie et la bactériurie.
- L'adénome ou hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) entraîne
chez plus d'un million de nos compatriotes des troubles urinaires souvent
modérés caractérisés par le syndrome prostatique (pollakiurie, dysurie). Il
n'a pas été retrouvé de facteurs favorisants pour cette pathologie.
- Le cancer : deuxième tumeur maligne en fréquence dans le monde, le
nombre absolu de cancers prostatiques augmente régulièrement, d'une
part du fait du vieillissement de la population, et d'autre part du fait du
développement de son dépistage (30 000 nouveaux cas par an en France).
Le cancer de la prostate, non traité, abrège d'environ 9 ans la durée de vie
de celui qui en est atteint. Une étude autopsique révèle que des foyers
cancéreux microscopiques sont retrouvés chez 20% des hommes à 50
ans, 30% à 60 ans et 70% après 80 ans. En fait, après 50 ans, seuls 8%
des hommes auront une manifestation clinique.
QUEL EST LE ROLE ET L’ORIGINE DU PSA ?
Le PSA est une protéase de la famille des kallikréines, secrétée par les
acini prostatiques. Il semble que, sous le contrôle des androgènes, il
participe à la liquéfaction du sperme en scindant des molécules de haut
poids moléculaire.
Une étude récente a mis en évidence que le PSA inhibe la prolifération des
cellules endothéliales et diminue leur capacité migratrice. Cet effet
inhibiteur sur la prolifération des vaisseaux sanguins fait l'objet de
recherches dans l'espoir de découvrir de nouvelles molécules anti-
cancéreuses capables d'assécher les tumeurs, faute d'artères nourricières.
Le PSA pourrait ainsi être utilisé comme médicament anti-tumoral et anti-
métastatique …
L'activité protéolytique du PSA au niveau sanguin est inhibée par des
inhibiteurs des protéases sériques : alpha-1-antichymotrypsine et alpha-2-
macroglobuline.
Il existe 3 formes circulantes de PSA : le PSA lié à l’alpha-1-
antichymotrypsine (PSA-ACT) , le PSA lié à l’alpha-2-macroglobuline
(PSA-MG) et le PSA libre (PSA-L).
L'alpha-2-macroglobuline est une énorme protéine qui englobe toute la
molécule de PSA et masque tous les sites épitopiques. Le PSA-MG est
donc immunologiquement inactif.
Le PSA total (PSA-T) correspond aux seules formes immunoréactives dans
le sérum, c’est à dire à la somme du PSA-ACT et du PSA-L. La
standardisation actuelle du dosage définie à Standford repose sur un
étalon comportant 90% de PSA-ACT et 10% de PSA-L.
CHOIX DU SEUIL ET VALEURS DE REFERENCE
Le seuil retenu chez le sujet sain varie selon les réactifs de dosage utilisés,
chaque fabricant mentionnant celui-ci avec son protocole opératoire. Le
choix de ce seuil est un choix de compromis entre sensibilité et spécificité.
Valeurs de référence au laboratoire (technique MEIA – AXSYM ABBOTT) :
AGE (ans) 40-49 50-59 60-69 70-79
PSA-T (ng/ml) < 2,5 < 3,5 < 4,5 < 5,5
L'augmentation des valeurs de référence de PSA avec l'âge est due à
l'augmentation du volume de la prostate à partir de 40 ans. Il existe une
relation directe entre âge et volume de la prostate.
L'utilisation de valeurs de référence de PSA en fonction de l'âge permet
d'améliorer la sensibilité chez les hommes jeunes et la spécificité chez les
hommes âgés.
Variations du PSA non liées directement à une pathologie prostatique :
L’effet du toucher rectal sur les concentrations sériques de PSA est
diversement apprécié. Il n’induirait une variation significative que lors des
touchers rectaux « très appuyés ». Par contre, les manipulations
instrumentales (cystoscopie, résection endoscopique et biopsie à l’aiguille)
provoquent une élévation transitoire du PSA. Il existe d'autres causes
d'élévation transitoire du PSA (effort physique intense, bicyclette, rapports
sexuels). L’heure du prélèvement n’a pas d’influence sur les concentrations
sériques de PSA.
Comparaison des résultats obtenus avec des réactifs différents :
Toutes les trousses de dosage classique du PSA dosent le PSA-ACT et le
PSA-L. Mais, certaines trousses peuvent privilégier l'une ou l'autre des 2
formes si elles ne sont pas équimolaires.
En cas de dosages sériques itératifs du PSA, il est recommandé d'effectuer
les dosages avec les mêmes trousses d'un même fabricant.
PSA ET PATHOLOGIES PROSTATIQUES
Outre son utilisation dans le suivi des patients traités, le PSA tient une
place importante dans le diagnostic du cancer de la prostate. En effet, le
diagnostic précoce du cancer de la prostate est rendu difficile par l'absence
de signes cliniques dans les tumeurs localisées. L'association du toucher

rectal avec un dosage de PSA permet une détection plus précoce de ces
formes de cancer.
Le PSA est un marqueur de l'épithélium sécrétoire normal ou tumoral et il
existe un chevauchement très important des valeurs de référence si l'on
s'intéresse aux deux pathologies prostatiques que sont l'hypertrophie
bénigne de prostate (HBP) et le cancer.
Hormis l'utilisation de valeurs de références liées à l'âge, d'autres
méthodes ont été proposées pour augmenter l'utilité clinique du PSA :
- la densité de PSA (PSA-D) : définie comme le rapport de la
concentration sérique de PSA en ng/ml sur le volume prostatique mesuré
par échographie. Ce rapport augmente la spécificité du PSA en tenant
compte de l'augmentation de volume souvent trouvée dans les HBP. La
limite à cette méthode est essentiellement la mesure de la taille de la
prostate qui se fait par échographie.
- la cinétique du PSA (PSA vélocité) : le tissu cancéreux a une
production de PSA 10 fois plus importante que le tissu hyperplasique à
volume de prostate égal. On recommande de se fonder sur une
augmentation maximale de 0,75 ng/ml et par an.
- le ratio PSA libre/PSA total : la majorité du PSA présent dans
le sérum est sous forme complexée (80 à 90%), une petite partie est sous
forme libre. Les patients porteurs de cancer ont un pourcentage de PSA
libre faible comparé à celui des porteurs d'HBP.
La zone de concentration de PSA habituellement admise comme zone
d'indication de PSA libre (encore appelée "zone réflexe") est de 4 à 10
ng/ml. Cette zone peut être élargie de 2 à 10 ng/ml afin d'augmenter la
sensibilité clinique vis à vis du cancer prostatique.
Si le rapport PSA-L/PSA-T est supérieur à 25%, ceci est en faveur d'une
HBP dans 95% des cas et permet d'éviter jusqu'à 30% de biopsies.
Inversement si ce rapport est inférieur à 10%, la probabilité pour que le
patient soit atteint d'un cancer de la prostate est de 60%.
-PSA et dépistage de masse du cancer de la prostate
Contrairement au cancer du sein pour lequel le dépistage par
mammographie est clairement bénéfique, le dépistage de masse du cancer
de la prostate, rejeté actuellement, est un sujet de polémique.
Le diagnostic du cancer de la prostate, une des premières causes de
décès par cancer chez l’homme âgé, est fait dans 50 à 70% des cas à un
stade d’extension loco-régionale ou métastasique, c’est à dire un stade trop
avancé pour que l’on puisse entreprendre autre chose qu’un traitement
palliatif. On comprend donc l’intérêt d’un dépistage précoce permettant, lui,
un traitement curatif. Les avis sont partagés sur l’intérêt de la détermination
du PSA comme examen de routine dans le dépistage du cancer de la
prostate à cause de son manque de spécificité (fréquence des HBP à partir
de 50 ans).
Les avantages réels d’un tel dépistage sont difficiles à apprécier :
-le dépistage de masse coûte cher
-un excès de diagnostic et de traitement pourrait dépasser les bénéfices du
dépistage. Il amènerait à traiter des patients porteurs de cancers
microscopiques ou peu évolutifs, qui ne se seraient jamais manifestés.
D'autre part, la chirurgie et la radiothérapie utilisées dans le traitement de
ces cancers peuvent laisser les hommes impuissants et incapables de
contrôler leur vessie.
Par contre, le dépistage individuel est devenu une pratique médicale. Dans
ce cas, le dosage du PSA doit être associé au toucher rectal.
-PSA et diagnostic du cancer de la prostate
Au moment du diagnostic, le PSA est un indicateur potentiel de la présence
d’un cancer. Son utilisation doit être combinée avec le toucher rectal et
l’échographie transrectale qui fait partie du schéma diagnostique amenant
à la biopsie dont l’examen microscopique permet d’affirmer l’existence d’un
cancer de la prostate.
L’élévation du PSA est proportionnelle au volume tumoral et à l’existence
de foyers à distance (métastases ganglionnaires ou osseuses surtout). Par
contre, un taux normal n'exclut pas le diagnostic de tumeur limitée de la
prostate.
Le dosage du PSA présente en outre un intérêt dans la recherche d’une
néoplasie primitive devant une métastase, en particulier osseuse. Dans ce
cas, un taux de PSA élevé fera suspecter un cancer de la prostate.
- Intérêt pronostique du PSA dans le cancer de la prostate
On peut attribuer au dosage pré-opératoire du PSA un intérêt pronostique.
Aucune métastase n’est retrouvée généralement pour des taux inférieurs à
10 ng/ml et deux patients sur trois présentent des métastases
ganglionnaires pour des taux de PSA supérieurs à 50 ng/ml. Toutefois, la
détermination des concentrations sériques de PSA ne peut pas être
retenue comme seul critère de curabilité à l’échelle individuelle du cancer
de la prostate. Il faut toujours associer, dans le cas des cancers de stades
avancés, le dosage du PSA et des phosphatases acides prostatiques
(PAP). En effet, les PAP constituent un remarquable marqueur de la
probabilité de dissémination donc de métastases osseuses en évolution
mais ne permettent pas le diagnostic ni le suivi des pathologies bénignes
ou des cancers localisés de la prostate. Le dosage des LDH est également
intéressant dans les stades avancés.
- Suivi thérapeutique et dosage du PSA
Différentes formes de traitement peuvent être envisagées dans le cancer
de la prostate, en fonction du stade clinique : prostatectomie, traitement
hormonal palliatif ou radiothérapie.
La demi-vie du PSA est de 3 jours. Après prostatectomie radicale, lorsque
le cancer est localisé, on constate une chute rapide du PSA fonction de la
valeur initiale (environ 2 à 4 semaines), après radiothérapie la
décroissance est plus lente à se mettre en place (près de 1 an). Après
traitement hormonal, les profils de chute du PSA sont très variés car ils
dépendent de la masse tumorale et de l'hormono-sensibilité (sous
hormonothérapie, la baisse des concentrations est le reflet du statut
hormonal plus qu’une baisse du volume tumoral).
La persistance après traitement d'un taux de PSA élevé implique une
évolution clinique.
Une augmentation du taux de PSA sous-entend une évolution
pathologique, soit au niveau loco-régional, soit au niveau systémique. La
scintigraphie osseuse (qui est l'examen de référence pour faire le
diagnostic des métastases osseuses lors du bilan pré-thérapeutique) est
accessoire lors du suivi de la maladie, le dosage du PSA devenant
l'examen de référence.
Les patients qui après traitement loco-régional normalisent dans les 6 mois
un PSA initialement élevé ont en règle général un meilleur pronostic.
Remarque : La mise au point de dosages dits ultrasensibles permet de
définir un seuil de sensibilité analytique à 0,06 ng/ml. Un mois après
prostatectomie radicale, un taux supérieur indique la présence de tissu
résiduel ou la récurrence du cancer. Le dosage du PSA effectué
régulièrement permet de détecter toute récidive dès son origine et de
gagner plusieurs mois sur le diagnostic d’évolutivité, avant l’apparition des
signes cliniques. Cependant, l’impact thérapeutique et l’utilité réelle d’une
telle sensibilité restent à déterminer.
QU'APPORTE L'ANATOMOPATHOLOGIE ?
Le rôle de l'anatomopathologiste par l'examen des biopsies est d'une part
de porter le diagnostic définitif de cancer et d'éliminer une affection bénigne
(prostatite ou hyperplasie adénomateuse), d'autre part, d'évaluer le
pronostic évolutif de la tumeur. Ce pronostic histologique est basé sur
l'appréciation de la différenciation tumorale gradée par le score de
GLEASON (le score 7 étant un score charnière) et de l'extension tumorale,
exprimée par la classification internationale T.N.M. (Tumor Node
Metastasis). Ceci conduit, en intégrant les facteurs pronostiques, cliniques
et biologiques, à classer les patients en deux groupes :
- ceux ayant une maladie agressive mais encore limitée à la prostate,
justifiant d'un traitement radical curatif,
- et ceux ayant une maladie, à progression lente, ou trop extensive,
bénéficiant d'une surveillance ou d'un traitement palliatif.
CONCLUSION
Le PSA est l'un des marqueurs tumoraux dont l'utilité se vérifie dès le
dépistage individuel et contribue ensuite à accompagner les gestes du
clinicien dans la prise en charge du patient. Toute consultation d'un homme
de plus de 50 ans doit comporter un questionnaire sur la qualité des
mictions et toute anomalie décrite devrait faire pratiquer un toucher rectal.
En pratique, lorsque le patient consulte pour un mal de gorge, ceci est loin
d'être évident et un dosage du PSA est alors licite.
Olivier FLEURQUIN – Régine BOSC
prochain sujet :
Cryptosporidium et Blastocystis hominis : des protozoaires fécaux à ne pas
méconnaître
1
/
2
100%