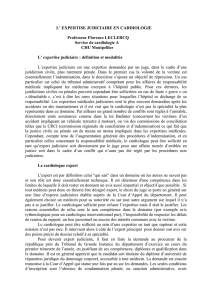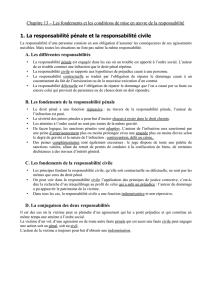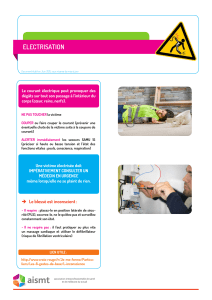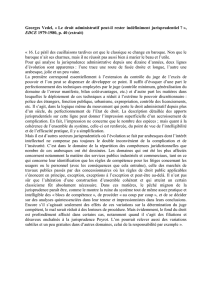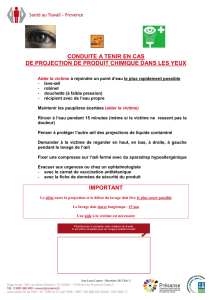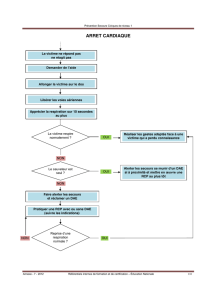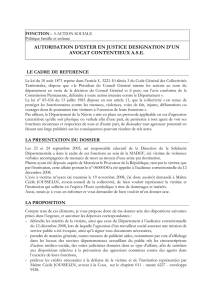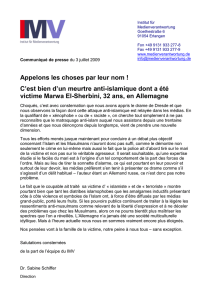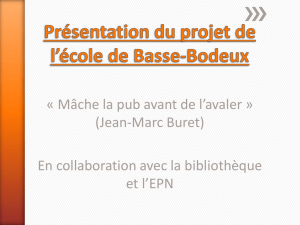Télécharger l`ensemble des contributions (pdf

ANALYSE ÉCONOMIQUE
DU DROIT :
QUELQUES POINTS
D’ACCROCHE
CYCLE CHAIRE RÉGULATION/COUR DE CASSATION
Sous la direction scientifique
de Guy Canivet, Bruno Deffains
et Marie-Anne Frison-Roche
www.petites-affiches.com
Petites affiches
2, rue Montesquieu 75041 Paris Cedex 01
Tél.:0142615614 Fax:0147039202
Le Quotidien Juridique
12, rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris
Tél.:0149490649 Fax:0149490650
La Loi
Archives Commerciales de la France
33, rue des Jeûneurs 75002 Paris
Tél.:0142345234 Fax:0146341970
ARCHIVES COMMERCIALES DE LA FRANCE
Le Quotidien Juridique
394
e
année 19 MAI 2005 N
o
99 10 7
NUMÉRO SPÉCIAL
JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS DE PARIS, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE
ÉDITION QUOTIDIENNE DES JOURNAUX JUDICIAIRES ASSOCIÉS

ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT :
QUELQUES POINTS D’ACCROCHE
CYCLE CHAIRE RÉGULATION/COUR DE CASSATION
Sous la direction scientifique de Guy Canivet, Bruno Deffains
et Marie-Anne Frison-Roche
SOMMAIRE
4
AVANT-PROPOS,PAR RICHARD DECOINGS
L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT : PERSPECTIVES GÉNÉRALES
6BRUNO DEFFAINS
LE DÉFI DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT :LE POINT DE VUE
DE L’ÉCONOMISTE
15 MARIE-ANNE FRISON-ROCHE
L’INTÉRÊT POUR LE SYSTÈME JURIDIQUE DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE
DU DROIT
23
GUY CANIVET
LA PERTINENCE DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT :LE POINT DE VUE
DU JUGE
L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT : L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
29
RÉGIS BLAZY
LA PERTINENCE ÉCONOMIQUE DE L’INCRIMINATION DE L’ABUS DE BIENS
SOCIAUX
36 FRÉDÉRIC STASIAK
LA RÉCEPTION ET LA COHÉRENCE DES CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES
RELATIVES À L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT : LE CONTRAT
43
ÉRIC BROUSSEAU
LA SANCTION ADÉQUATE EN MATIÈRE CONTRACTUELLE :UNE ANALYSE
ÉCONOMIQUE
2-Petites affiches - 19 MAI 2005 - N
o
99
Directeur de la publication :
Bruno Vergé
Rédactrice en chef :
Emmanuelle Filiberti
Comité de rédaction :
Pierre Bézard, président honoraire
de la chambre commerciale de la Cour
de cassation
Euric Bonnet, directeur de la rédaction
de la Gazette du Palais
Jean-Pierre Camby, conseiller des
services de l’Assemblée nationale
Jean-Marie Coulon, premier président
honoraire de la Cour d’appel de Paris
Alain Couret, professeur à l’Université
Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Maurice Cozian, professeur émérite à
l’Université de Bourgogne
Fernand Derrida, professeur honoraire
à la faculté de droit de l’Université
d’Alger
Michel Grimaldi, professeur à
l’Université Paris II (Panthéon-Assas)
Jean-François Guillemin, secrétaire
général, groupe Bouygues
Paul Le Cannu, professeur à
l’Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne)
Jacques Massip, conseiller doyen
honoraire à la Cour de cassation
Denis Mazeaud, professeur à
l’Université Paris II (Panthéon-Assas)
Nicolas Molfessis, professeur à
l’Université Paris II (Panthéon-Assas)
Jacqueline Morand-Deviller,
professeur à l’Université Paris I
(Panthéon-Sorbonne)
Bernard Reynis, notaire, président
honoraire de la Chambre des notaires
de Paris
Alain Sauret, avocat conseil en droit
social, J. Barthélémy et Associés.
Rédaction : 2, rue Montesquieu,
75041 Paris Cedex 01
Tél. : 01 42 61 87 87
Fax : 01 42 86 09 37
E-mail :
Tout projet d’article, accompagné
de sa disquette, doit être adressé
à Emmanuelle Filiberti, à l’adresse
ci-dessus.
Diffusion :
Tél. : 01 42 61 88 00
Fax : 01 42 92 03 91
E-mail :
Rédaction (p. 1 à 96)
Publicité légale : Annonces pour
les départements 75, 92, 93, 94
(p. 97 à 128)
ABONNEMENTS
1anFrance(TTC)
Journal seul ............................ 125 Q
Journal + Lextenso.fr ........ 182,41 Q
1 an Étranger (HT)
CEE .................................... 284,28 Q
Hors CEE ........................... 543,48 Q
Pour tarifs particuliers
(enseignants, étudiants, ...) nous consulter
Direction Artistique : GRAPHIR DESIGN

54
CHRISTOPHE JAMIN
QUE RÉPONDRE À ÉRIC BROUSSEAU ?
(JEN’AI PRESQUE RIEN À DIRE À UN ÉCONOMISTE)
L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT : LA BANQUE
60 JEAN-PAUL BETBÈZE
LA BANQUE,LE JUGE,LES RUPTURES DE CRÉDIT ET LE FONCTIONNEMENT
DU MARCHÉ
65 MICHEL GERMAIN
INTERROGATIONS JURIDIQUES
L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT : LES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES
67 JEAN TIROLE
QUELLES FINALITÉS POUR LES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES ?
75 MICHEL VIVANT
ÉCONOMIE ET DROIT OU UNE INTERROGATION SUR LES LOIS :
LE POINT DE VUE DU JURISTE
L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT : LA RESPONSABILITÉ
78 MAURICE NUSSENBAUM
L’APPRÉCIATION DU PRÉJUDICE
89 GENEVIÈVE VINEY
L’APPRÉCIATION DU PRÉJUDICE
Petites affiches - 19 MAI 2005 - N
o
99 - 3

A
VANT-PROPOS
Sciences Po est honoré et heureux d’être associé à la Cour de cassation, à travers
notamment la Chaire régulation qui coorganise ce programme autour de droit,
justice, économie avec la Cour de cassation. Cette initiative s’insère dans le dévelop-
pement d’une coopération qui sera de plus en plus étroite et traduit l’importance de
la recherche et de la réflexion sur le droit à Sciences Po.
Le droit a toujours occupé une place importante à Sciences Po, depuis sa création.
Pendant longtemps, cette place a surtout été occupée par le droit public, disons même
le droit administratif. Les frontières aujourd’hui ont tendance à être plus floues et je
ne sais pas si les clivages disciplinaires ont encore une raison d’être. Cela a notam-
ment justifié le développement du droit à Sciences Po, au-delà de notre tradition
d’enseignement du droit administratif et du droit public. Pour l’ensemble des ensei-
gnements, depuis les premiers cycles jusqu’aux masters, sans prétendre délivrer de
diplôme de droit, ce pour quoi nous n’avons pas demandé d’habilitation, nous consi-
dérons que tout élève qui passe une partie de sa scolarité à Sciences Po doit recevoir
un enseignement juridique fondamental, et celui-ci prend désormais une place beau-
coup plus importance que naguère.
Dans un mouvement convergent, nous avons décidé depuis plusieurs années d’inves-
tir beaucoup, et cette fois-ci non seulement en matière d’enseignement mais égale-
ment en matière de recherche, sur les questions de régulation. Cette perspective cor-
respond à une évolution considérable de nos systèmes de droit et de nos systèmes de
gouvernance, produisant un impact essentiel sur nos sociétés. Je pense que nous man-
querions intellectuellement, conceptuellement, cette évolution si nous n’investissions
dans ce domaine. Grâce, notamment à Marie-Anne Frison-Roche, nous avons créé
une chaire consacrée aux questions de régulation. Une chaire pour nous n’est pas
simplement un emploi de professeur des Universités, c’est un ensemble que nous
espérons cohérent, de recherche, d’enseignement (aussi bien l’enseignement initial
que la formation continue), de constitution progressive d’un centre de documenta-
tion, local et à distance et de tout ce qui peut s’attacher à rendre fructueux cette
recherche et cet enseignement. Naturellement, le cycle de conférences construit entre
la Chaire régulation et la Cour de cassation, qui donne lieu aujourd’hui à une publi-
cation ordonnée, et qui va continuer dans les années à venir, est l’une des illustrations
de cette volonté commune.
L’approfondissement des relations entre la recherche et l’enseignement dans ce do-
maine des relations entre le droit, la justice et l’économie est un projet à long terme
pour Sciences Po. Cela est d’autant plus important qu’un nombre croissant de nos
diplômés se destinent aux carrières juridiques, qu’il s’agisse de carrières de la magis-
trature (un nombre croissant de nos diplômés passent et réussissent le concours de
l’École nationale de la magistrature) ou du barreau (un nombre croissant de nos
diplômés sont recrutés dans des cabinets d’avocats). Et s’il y a cette appétence de la
part de nos élèves, à laquelle correspond cette demande de la part des employeurs,
c’est en raison d’une tradition à Sciences Po correspondant bien à cet état de la
réflexion et de la demande sociale : la pluridisciplinarité. Nous avons toujours fait en
4-Petites affiches - 19 MAI 2005 - N
o
99

sorte que nos élèves soient astreints au grand sens de la rigueur intellectuelle à des
disciplines aussi différentes que l’économie, le droit mais aussi la sociologie, la science
politique ou l’histoire. Grâce à ces disciplines, grâce à leur croisement, grâce aux
discussions que ce cycle de conférences et cette publication illustrent, ces questions
essentielles de droit, de justice et d’économie, peuvent être approchées plus posément
que dans une perspective disciplinaire unilatérale. Les fruits de cette réflexion seront
utiles à tous et je vous remercie au nom de tous les professeurs et de tous les élèves de
Sciences Po de l’opportunité qui leur est ainsi offerte.
Richard DECOINGS
Directeur de l’Institut d’études politiques de Paris
Petites affiches - 19 MAI 2005 - N
o
99 - 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
1
/
96
100%