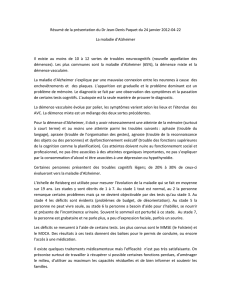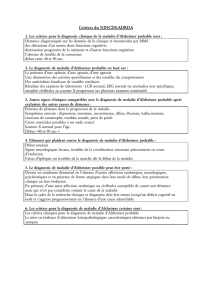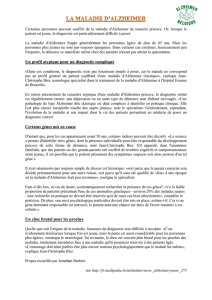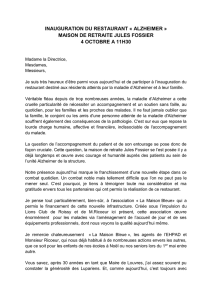La gestion et la prise en charge des troubles du

Centre de la mémoire, centre médical des monts de Flandre
59270 Bailleul.
Tra
v
ai
l
r
é
al is
é
d a
n
s le
c
a
d
r
e
d e
l
’é qu ip e
d
’a
c
c uei
l
2 96 1 du Mini s
t
è re d
e
l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie (MNERT).
Article reçu le 18.09.2002 - Accepté le 10.10.02.
ARTICLE ORIGINAL
La gestion et la prise en char
ge des tr
oubles
du comportement dans la maladie d’Alzheimer
Management of behavioral symptoms in Alzheimer’s disease
F
lorence
LEBERT
La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1
JANVIER 2003
37
L
es troubles du comportement sont au sujet âgé,
ce qu’est la fièvre au nourrisson, c’est-à-dire un
symptôme et non une m
a
ladie. La déme nce
dont la maladie d
’
Alzheime r est la cause la plus fré-
quente, est le premier facteur de risque de survenue de
tro uble s du compor te
m
ent du sujet âgé,
m
ais là
encore, facteur de risque n’est pas obligatoireme nt
synonyme d’étiologie. Traiter sérieusement un trouble
du co
m
portement né cessite obligatoirement d’en
connaître la cause, ce qui nécessite de s’en donner les
moyens. On considérera dans l’article le diagnostic de
mal
a
die d’Alzheimer co
m
me acquis
e
xcluant par là-
même les autres diagnostics de démence.
LA DÉMARCHE DE DÉBROUILLAGE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Après s’être assuré que le malade ou l’entourage ne
s
ont pas en situation de danger im
m
inent, les pre-
mières questions sont à adresser à l’entourage, si pos
-
sible proche, afin de connaître :
●La durée et la brutalité ou non de survenue des
troubles
●
L’existence ou non d’une aggravation de l’état cogni
-
tif, ce qui devra être ensuite évalué par un MMS avec
comparaison si possible avec un score précédent
●
La présence de symptômes plaidant pour une confu
-
sion (inversion nycthé
m
éral
e
, troubles de vigilance,
RÉSUMÉ
___________________________________
La ges
t
ion des
t
roub
l
es du comport
e
men
t
du suje
t
âgé ayan t une
m
aladie d ’Al
z
hei
m
er ne peu
t
être
adaptée que si elle es
t
précédée d’une analyse
s
émio
-
lo giq u e d e la situ a
t
io n.
N
o us p rop oso n
s
u ne
dé
m
arche dans le diagnos
t
ic e
t
dans la prise en char
-
ge de
s
situa
t
ion
s
de crises com
m
e des
s
ymp
t
ô
m
es
co
m
por
t
emen
t
aux
et psychologique
s
de la dé
m
ence.
M
o
t
s
-
c
l
é
s
:
Troubles du co
m
por
t
e
m
en
t
-
S
C
PD
-
Démence - Maladie d’Alzheimer.
SUMMAR
Y
_________________________________
Th e
m
anage
m
en t o f behavioral
s
ymp
t
o
m
s
in
A
lzhei
m
er’s pa
t
ients neces
s
i
t
a
t
es a se
m
iological analy
-
sis o
f
the crisis.
W
e propose guideline
s
for diagno
s
i
s
o
f
t
he behavioral crisis and
t
o
m
anage agi
t
ation, behavio
-
ral and
p
s
ychological sy
m
p
t
o
m
s in de
m
entia.
Revue de Gériatrie 2008;28:37-42
K
e
y
w
o
r
d
s
: Beh avioral sy
m
p
t
o m
s
-
BPSD -
Dementia - Alzheimer’s disease.

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer
La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1
JANVIER 2003
38
Figure 1 : Arbre décisionnel devant un trouble du comportement lors de maladie d’Alzheimer.
Figure 1 : Disruptive behaviours in Alzheimer’s disease : decision making diagram.
troubles de perception, modifications de l’état psycho
-
moteur, perplexité anxieuse, fluctuation).
Deva nt un état d
’
agita tion, une
s
o
m
nolence, une
insomnie, des hallucinations, ou une instabilité psycho
-
motrice
a
vec fugues, de survenue brutale avec déclin
cognitif et présence d’au moins quelques symptô
m
es
évocateurs de confusion, la maladie d’Alzheimer ne
devra pas être incriminée dans l’origine des troubles du
comportement mais il faudra rechercher une cause sur
-
ajoutée
(figure 1).
Il sera alors nécessaire d’interroger
l
e
s proches sur les antécédents du patient, les sy
m
p-
tô
m
es physiques récents, les traite
m
ents habituels et
récents, la prise d’alcool, d’examiner et de s’entretenir
avec le patient à la recherche d’une maladie physique
ou d’une douleur, de réaliser systé
m
atique
m
ent un
bilan biologique et radiologique simple
(tableau 1).
Ces
premiers examen et entretien doivent se faire dans un
lieu calme pour accueillir le patient et son entourage.
L’utilisation de sédatifs se fera seulement soit pour
pouvoir examiner le patient trop agité soit pour le pro
-
téger ou son entourage de comportements potentielle
-
ment dangereux. Le choix se fera vers un produit à
demi-vie courte. L’expérience de plusieurs équipes fait
reco
m
mander le méproba
m
ate en premièr
e
intention
(1, 2)
. Si cela n’est pas suffisant, des benzodiazépines à
demi-vie courte pourront être utilisées ponctuellement
ou de l
’
hydroxyzine
m
ais un risque
a
nticholinergique
lors de fortes doses est à craindre. Aucun neurol
e
p-
tique ne doit être utilisé dans l’urgence pour éviter
l’aggravation d’un état confusionnel, éviter
de
m
asquer
- Apparition récente des tr
oubles
du comportement
- Déclin cognitif brutal
- Signes de confusion
m
ala
d
ie
s
o
m
atiq
u
e
no
n
n
e
u
r
o l o g i q u e
maladie neur
ologique non dégénérative
(ex : A
VC, épilepsie..)
iatr
ogénie
douleur
Antécédents de maladie psychiatrique ? oui
non r
echute ?
- pr
ogr
essif,
- pas d’aggravation brutale de
l’état cognitif
Symptômes comportementaux et
psychologiques de démence
Désaf
fér
entation sensorielle
Envir
onnement défavorable
Démence (neuropsychologie-autonomie)
Imagerie

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer
La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1
JANVIER 2003
39
Tableau 1 : Bilan minimal à réaliser en l’absence de point
d’appel lors d’une aggravation récente des troubles du com
-
portement.
Table 1 : Recent worsening of disruptive behaviours : Minimum test
in the absence of significant elements.
une cause somatique et aussi car généralement cela
n’apporte que peu d’amélioration ce qui est biologique-
m
ent explicable par l’absence d’altération
m
ajeure du sys-
tè
m
e dopa
m
inergique dans l
a
confusion ( 3 ). Le traitement
le plus efficace est le traite
m
ent d
e
la cause justifiant une
m
ise en route rapide de la réalisation des bilans.
Si en revanche la survenue des troubles du comporte
-
ment est progressive, après avoir éliminé une rechute
d’une maladie psychiatrique ant
é
rieure à la maladie
d’Alzheimer, un environnement défavorable (caractéris
-
tiques du lieu de vie, maltraitance verbale ou physique)
et les conséquences d’une désafférentation sensorielle,
souvent il s’agira alors d’un symptôme comportemental
ou
psychologique de dé
m
ence
(
S
C
PD), c’est-à-dire
d’une
m
anifestation comporte
m
entale de la maladie
d’Alzheimer.
GESTION DES ÉT
A
TS DE CRISE LORS DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La pre
m
ière question concern
e
le choix du lieu de la
gestion de la crise. Quatre paramètres nous paraissent
devoir être pris en compte prioritairement pour le choi
-
sir : la dangerosité des troubles, la connaissa nce ou
non de la c
a
use de la crise, la réponse aux psycho-
tropes, le degré d’épuisement des proches. Les unités
de soins Alzheimer sont les lieux qui doivent prendre
en charge ces patients lorsque la gestion n’est pas pos
-
sible à leur lieu de vie habi
t
uel. Une unité de soins
Alzhe im
e
r doit répondre aux critères de Volicer ( 4 ),
mais doit a ussi avoir assez d
’
expérience pour savoir
peser le pour et le contre de soins plus lourds utilisés
très ponctuellement (sonde gastrique, perfusions IV ou
centrales, contention suivant les recommandations de
l’ANAES…), savoir remettre chaque jour en cause les
choix et disposer d’un ratio soignants/malades suffisant
pour gérer les états d’agitation et leur traite
m
ent. La
correction de s états d’agitation passe aussi par des
actions de prévention de la dénutrition, de la déshydra
-
tation, de la p athologie thrombo-e
m
bo lique, des
escarres…
GESTION DES SCPD DANS LA MALADIE
D’ALZHEIMER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le terme de S
C
PD a été donné par l’
I
nternational
Psychogeriatric Association pour définir les symptômes
comportementaux dus aux lésions cérébrales causant la
démence. Les SCPD comprennent : délires et troubles
d
e
l'identification, hallucinations, agitation, instabilité
psycho
m
otrice, co
m
pulsions, désinhibition, apathie,
hyperémotivité et réactions
catastrophes, manifesta-
tions dépressives, anxiété, troubles du som
m
eil et du
rythme circadien, troubles des conduites alimentaires et
troubles des conduites sexuelles. Leur recherche peut
se faire par entretien semi-structuré com
m
e a vec
l’inventaire neuropsychiatrique disponible en français
(5)
ou par questionnaire à remettre à une pe rsonne de
l’entourage com
m
e avec le questionnaire de dyscon-
trôle comportemental
(6).
Traitements pharmacologiques
Les signes comporte
m
entaux sont accessibles aux psy-
chotropes du fait de leur origine neurobiologique.
Cependant les modifications neurobiologiques dans les
démences diffèrent
de celles des pathologies psychia-
triques
m
ême si elles génèrent des sy
m
ptô
m
es iden-
tiques. Cela explique la nécessité de règles
t
hérapeu-
tiques spécifiques lors de dé
m
ences. D
e
puis 1 997, il
existe une référenc
e
internationale consensuelle de
l’A
m
erican Psychiatric Association
(
APA
)
( 7 ) sur les trai-
tements des démences, y co
m
pris des manifestations
affectives et comporte
m
entales. Pour traiter les S
C
PD,
4 classes phar
m
acologiques sont utilisables au vu des
résultats de la littérature ( 8 ) : les inhibiteurs de la recap-
●
Numération formule
●
Ionogramme, urée, créatinine
●
Bilan hépatique
●
CRP - vs
●
Calcémie
●
CPK - Troponine (si possible)
●
Glycémie
●
TSH (si celle-ci n’a pas été dosée pendant
l’année écoulée)
●ECBU
●
Un abdomen sans préparation
●
Une radio de poumons
●ECG

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer
La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1
JANVIER 2003
40
ture de la sérotonine (
I
RS
)
, les thy
m
orégulateurs, le
s
nouveaux antipsychotiques, e t l
e
s anticholinestéra-
siques. Le
t
ableau 2 résu
m
e leur utilisation. Le mépro-
bamate et les benzodiazépines à demi-vie courte sont
des
t
raitements d’appoint per
m
ettant
d’attendre l’effica-
cité des classes précitées. Les neuroleptiques classiques
n’ont plus aucune indic
a
tion aujourd’hui en raison du
mauvais rapport bénéfices
/
risques.
C
ertains sy
m
ptô
m
es
ne font pas l’objet de reco
m
mandations spécifiques
dans la maladie d’Alzheimer com
m
e les troubles du
som
m
eil. Les hypnotiques doivent être prescrits au
m
ini
m
um avec les recom
m
andations d’utilisation du
sujet âgé ( 9 ). Le risque de troubles du so
m
meil secon-
daires est encore plus i
m
portant lors de dé
m
ence, il faut
éli
m
iner l’inversion nycthé
m
érale de la confusion, un
s
yndro
m
e algique, un syndrome d
’
apnées du som
m
eil,
une dysuri
e
, un abus d’alcool ou un effet secondaire
d’un médicament com
m
e les anticholinestérasiques,
avant de choisir une imidazopyridine ou à défaut une
benzodiazépine à de
m
i-vie courte. Les essais pharmaco-
logiques de la mélatonine dans les troubles du som
m
eil
de la maladie d’Alzh
e
imer n
’
ont pas donné de résultats
suffisamment concluants.
S
u
ivi
s
o matiqu
e
:
s
urv
e
illa
n
ce
du
r
e
tenti
ss
e
-
ment physique des SCPD
- Poids : l’instabilité psychomotrice, les phobies alimen
-
taires peuvent favoriser une dénutrition à combattre
dans une maladie déjà source
d’amaigrissement. Les
IRS peuvent favoriser une anorexie, mais rarement en
être totalement responsables.
Tableau 2 : Indications des molécules dans le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence *.
Table 2 : Indications of the molecules for treatment of behavourial and psychological symptoms in patients with dementia.
Classes pharmacologiques
Indications
Posologies recommandées
Agents sérotoninergiques :
Antidépresseurs
- Fluoxétine
- Fluvoxamine
- Citalopram
- Sertraline
- Trazodone
Symptômes dépressifs, anxiété,
irritabilité,
+ Idées délirantes
Instabilité psychomotrice
20 -
40 mg/J
50 - 150 mg/J
10 -
30 mg/J
20 -
50 mg/J
70 - 300
mg/J
Thymorégulateurs :
- Carbamazépine
- Valproate de sodium
Agitation
Hostilité
100 mg/J, jusqu’à obtenir taux
sanguin de 8 à 12 ng/ml
125 mg/J, jusqu’à obtenir taux
sanguin de 50-60 ng/ml
Antipsychotiques atypiques :
- Rispéridone
- Olanzapine
Agressivité, idées délirantes
Agitation/agressivité + délire et
hallucinations
0.5 - 2 mg/J
5 mg/J
Inhibiteurs de la cholinestérase
Prévention de la survenue
d’hallucinations, d’apathie,
d’anxiété
Posologies efficaces sur les troubles
cognitifs
* Extrait de la littérature

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer
La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1
JANVIER 2003
41
- Métabolisme : un grignotage sucré peut favoriser un
diabète, l’agitation une déshydratation.
- Plaies, traumatismes : l’instabilité psychomotrice peut
favoriser des traumatismes qui ne seront pas obligatoi
-
rement limités par la douleur. Une observation et une
protection sont à proposer.
- Infections : le manque d’hygiène par opposition à la
toilette est souvent source d’infections urinaire s et
gynécologiques et de problèmes dentaires.
- Equilibre, chutes : l’instabili
t
é psychomotrice pourra
aboutir après des heures de déambulation à un épuise
-
ment et à des chutes. Ces troubles de l’équilibre pour
-
ront être aggravés par les psychotropes sédatifs
- Réponses inadaptées à un SCPD : la survenue d’hal
-
lucinations auditives peut par exemple être à l’origine
d’utilisation de bouchons d’oreille ou de coton pouvant
être source de surdité et d’infection.
Aide psychologique
- L’anxiété, les manifestations dépressives et l’irritabilité
réactionnelle à la perte des
m
oyens nécessitent une
revalorisation de la personne à travers des entretiens et
aussi à travers des activités positives
m
ettant en é vi-
dence la persistance de capacités. Le bilan neuropsy-
chologique peut aussi être un support à la revalorisa-
tion.
- Les symptômes frontaux comme l’apathie, la désinhi
-
bition, la négligence physique peuvent être accessibles
à des actions cognitivo-comportementalistes comme les
techniques de renforcement.
Mesures médico-sociales
- Cert
a
in es p rises en charge sp écialisées com
m
e
l’orthophonie, l
’
ergoth
é
rapie, la kinésithérapie propo-
sées pour des déficits ponctuels de la maladie ont par
-
fois un retentisse
m
ent plus général en particulier sur
l’humeur, l’apathie et l’anxiété.
- L’accueil de jour peut aussi être une aide sur le même
type de SCPD.
- Le
s
gardes à do
m
icile et de nuit peuvent être pré-
cieuses lors du phénomène de coucher de soleil ou lors
de troubles du sommeil.
- Les aides soignantes ou infirmières sont parfois indis
-
pensables pour des toilettes difficiles, lorsqu’il existe
par exemple des troubles de perception rendant la vue
de
m
iroirs perturbant
e
ou lors d’hallucinations cénes-
thésiques.
- Une protection des biens (sauvegarde de justice, cura
-
telle, tutelle) peut être utile lors de désinhibition com
-
portementale par exe
m
p le à l’origine de dépenses
inconsidérées.
Limites du maintien dans le lieu de vie habituel
Comm
e
dans les situations de crise, il faudra recon-
naître les limites du maintien dans le lieu de vie sur : la
dangerosité des troubles, l’existence d
’
un doute sur
l’existence de facteurs surajou
t
és à la maladie favori-
sant les troubles, la faible réponse aux psychotropes, le
degré d’épuisement des proches. L’évalua tion de la
dangerosité doit prendre en compte le type de SCPD
et aussi le li
e
u et les conditions de survenue, par
exemple, des fugues la nuit chez un patient vivant seul
seront plus dangereuses que le jour chez un patient
accompagné toujours d’un proche. Le médecin aura à
décider l’orient
a
tion entre 3 lieux de soins, une unité
de vie Alzheimer dans un EHPAD, une unité de soins
Alzheime r en co urt o u long séjour . Le Co mité
Alzheimer et Maladies Apparentées (CAMA) a fait des
recommandations sur les indications des unités de vie
Alzheimer en matière de troubles du comportement
(10).
“L’admission en unité de vie Alzhei
m
er rép ond à
l
’
impossibilité du maintien à do
m
icile, à la non-tolé-
rance du patient dans une maison de retraite” classique
“
e
n raison de sy
m
ptô
m
es comportementaux secon-
daires à la maladie neurologique dont l’intensité ne jus
-
tifie pas un avis de spécialiste régulier ou une présence
de soignants constante”, en revanche l’aggravation
brutale des troubles du comportement est une contre-
indication à une admission en unité de vie Alzheimer.
Si des adaptations thérapeutiques et la présence d’un
ratio soignants
/
m
alades élevé paraissent nécessaires
une orientation en unité de soins sera à recommander.
Formation de l’équipe
La compéte nce d’une équipe dans la gestion des
troubles du comportement est fonction de ses capacités
à :
- Savoir observer et se renseigner sur l’état du patient
et des changements.
- Savoir s’adapte r aux troubles du comporte
m
ent et
non attendre l’inverse.
- Savoir protéger l
e
patient de sa dangerosité ou d
e
celle des autres patients.
- Savoir se protéger.
EDUCA
TION ET SOUTIEN DE L’ENTOURAGE
_ _
L’infor
m
ation sur la
m
aladie est la pre
m
ière étape
indispensable de la rencontre avec les proches d
’
un
malade. Elle doit comprendre une explication détaillée
sur les SCPD afin d’éviter les nombreuses fausses inter
-
prétations et la culpabilité qui en découle, comme les
 6
6
1
/
6
100%