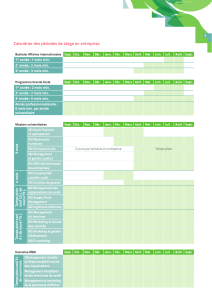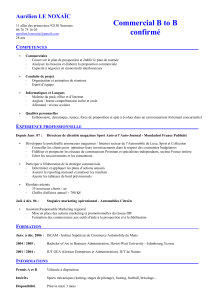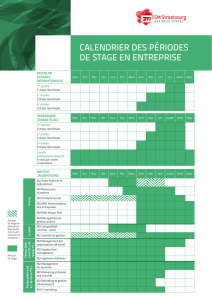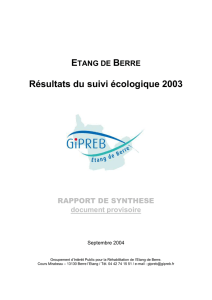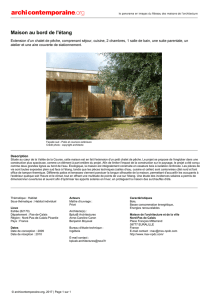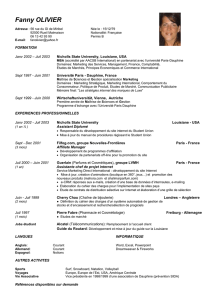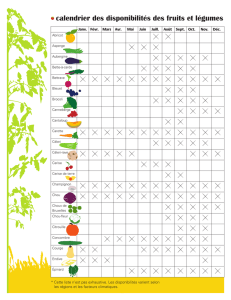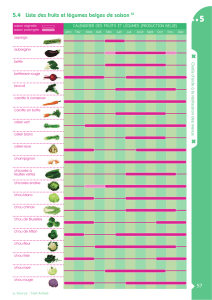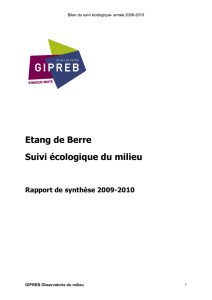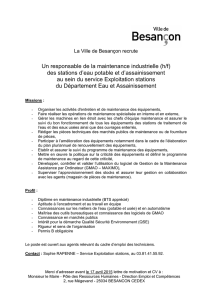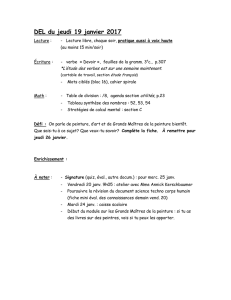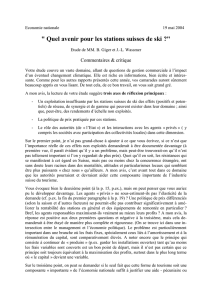Etang de Berre Suivi écologique du milieu

Bilan du suivi écologique- année 2008
GIPREB
1
Etang de Berre
Suivi écologique du milieu
Rapport de synthèse 2008

Bilan du suivi écologique- année 2008
GIPREB
2
SOMMAIRE
1 Introduction.................................................................................................................... 3
2 Description de la qualité du milieu et évolution des indicateurs écologiques en 2008.... 3
2.1 Apports.................................................................................................................. 3
2.2 Qualité de l’eau et eutrophisation........................................................................... 4
2.3 Populations phytoplanctoniques............................................................................. 5
2.4 Macrophytes et herbiers de Zostères..................................................................... 5
2.5 Macrofaune benthique........................................................................................... 6
2.6 Ichtyofaune............................................................................................................ 7
3 Résultats détaillés pour l’année 2008............................................................................ 9
3.1 Apports.................................................................................................................. 9
3.2 Qualité de l’eau et eutrophisation..........................................................................14
3.3 Populations phytoplanctoniques............................................................................24
3.4 Macrophytes et herbiers de Zostères....................................................................26
3.5 Macrofaune benthique..........................................................................................29
3.6 Ichtyofaune...........................................................................................................33

Bilan du suivi écologique- année 2008
GIPREB
3
Remarque liminaire
Le présent rapport est organisé en deux parties : la première partie fait la synthèse générale des
observations effectuées au cours de l‘année 2008 pour les différents compartiments de
l’écosystème et leur évolution récente ; la seconde partie regroupe, sous forme de tableaux et
figures, l’ensemble des résultats numériques recueillis en 2008.
1 Introduction
Depuis 2006 et la mise en œuvre de l’expérimentation des nouvelles modalités de rejets de la
centrale de Saint Chamas, le suivi écologique réalisé par le GIPREB est divisé en deux parties :
- le suivi écologique à long terme, qui permet au GIPREB de répondre à sa vocation d’observatoire
de la qualité du milieu et de son évolution. Les paramètres qui le composent sont suivis depuis
1994.
- un suivi écologique dit « exceptionnel », mis en œuvre depuis 2006 dans le cadre de
l’expérimentation et défini dans le règlement d’eau. La plupart des indicateurs sont, toutefois,
communs aux deux suivis.
Ce rapport présente les résultats du suivi écologique pour l’année 2008. Il porte sur les paramètres
physico-chimique de la masse d’eau ainsi que sur trois indicateurs biologiques : le phytoplancton,
les macrophytes et herbiers de Zostères, la macrofaune benthique de substrat meuble. Il présente
également les premiers éléments d’inventaire de l’ichtyofaune de l’étang de Berre. En effet, ce
volet d’acquisition, réalisé dans le cadre du suivi exceptionnel, permettra d’améliorer la
connaissance du fonctionnement de l’écosystème, avec un compartiment qui restait mal connu.
2 Description de la qualité du milieu et évolution des indicateurs
écologiques en 2008
2.1 Apports
Comme pour tout milieu lagunaire, l’écosystème de l’étang de Berre est largement conditionné par
la nature et la quantité des apports en provenance de son bassin versant : eau douce, limons,
nutriments, contaminants. Les apports d’eau douce proviennent à la fois des eaux de pluies qui
arrivent jusqu’à l’étang via le bassin versant et ses tributaires mais aussi des apports de la
Durance via le canal usinier EDF.
Après trois années marquées par des conditions hydro-météorologiques sèches, 2008 a connu
une hydrologie nettement plus élevée. Le cumul annuel de précipitation a été de 642 mm (Fig. 1),
ce qui, sur la surface de l’étang de Berre, correspond approximativement à un volume de 100
millions de m
3
en apports pluviaux. Les tributaires naturels ont également vus leurs apports en eau
augmenter, avec des contributions respectives de 134, 26 et 80 millions de m
3
pour l’Arc, la
Cadière et la Touloubre, avec de forts épisodes de crues en fin d’année 2008 (Tab. 1 ; Fig. 2).
Enfin, les apports en eau de la Durance par le canal usinier ont été de 772 millions de m
3
entre
janvier 2008 et décembre 2008 (Fig. 3).

Bilan du suivi écologique- année 2008
GIPREB
4
La plus grande hydraulicité observée en 2008 a eu pour conséquence des apports accrus en
matières solides. L’arc, la Cadière et la Touloubre ont ainsi apporté 80 500 tonnes de matières en
suspension, sans toutefois prendre en compte les épisodes de crues (qui peuvent constituer
jusqu’à 99% des flux de matières en suspension par les tributaires naturels). Sur la même période,
les apports en limons par le canal usinier ont été de 74 700 tonnes (Tab. 1 ; Tab. 2).
Des trois tributaires naturels, l’Arc a été le principal contributeur en sels nutritifs, apportant ainsi à
l’étang près de 370 tonnes de N-NO
3
et 20 tonnes de P-PO
4
, soit 2 à 3 fois plus que la Touloubre
et 3 à 10 fois plus que la Cadière. Les apports en nutriments par le canal usinier ne sont pas bien
connus pour 2008, seule une série de mesures ponctuelles ayant été réalisées (Tab. 3). En 2006,
année de sécheresse, les apports de la Durance représentaient le double de ceux des tributaires
naturels.
Les apports à l’étang concernent également les apports atmosphériques (estimés à 77t d’azote et
2t de phosphore en 1990), les eaux de ruissellement (estimés à 35t de phosphore et 100t d’azote
en 1994) et les apports diffus par la nappe fluviatile de l’Arc (estimés à 40t de N-NO3 en 2001)
1
.
2.2 Qualité de l’eau et eutrophisation
La répartition spatiale et temporelle de la salinité dans l’étang de Berre permet de distinguer 2
grandes masses d’eau. Depuis 2005 et la mise en place des nouvelles modalités de rejets d’eau
douce de la centrale EDF, cette structure s’est maintenue. C’est encore le cas en 2008 : la couche
1-6 m est très homogène au cours de l’année avec une salinité comprise entre 23 et 30 et au-delà
de 7 m de profondeur la stratification haline isole la couche de fond plus salée (salinité de 36 au
maximum). Ponctuellement, sous l’effet d’apports d’eau douce accrus, en janvier et février, la
salinité a été plus faible (entre 15 et 20) dans le premier mètre de la couche de surface (Fig. 5 ;
Fig. 6).
La stratification haline, en isolant physiquement la masse d’eau de fond, réduit les échanges diffus
et contribue au maintien de conditions hypoxiques, voire anoxique, à partir de 7 m de profondeur
(Fig. 7). En outre, en période estivale, les phénomènes biologiques (production primaire) peuvent
générer une consommation accrue d’oxygène dans les couches d’eau moins profondes. Ainsi, à
partir du mois de juillet 2008 et jusqu’à octobre, des diminutions d’oxygène notables ont été
observées à des profondeurs relativement faibles (2.5 m). Durant cette période, des épisodes
d’anoxie complète, qui ont duré jusqu’à 5 jours, ont pu être mesurés notamment dans l’anse du
Ranquet, à 4 m de profondeur seulement (Fig. 8 ; Fig. 9).
L’étang de Berre reste un milieu globalement eutrophe. Les valeurs médianes des teneurs en
nitrates, phosphates, azote total et phosphore total ont été respectivement de 2.3 µM (max 52.8),
0.2 µM (max 7.4), 32.2 µM (max 86.2) et 0.8 µM (max 5.3) au cours de l’année 2008 (Fig. 10 ; Fig.
11). L’azote minéral composé des nitrates, nitrites et ammonium, constitue le stock susceptible
d’être assimilé par le phytoplancton. Par ailleurs, les phosphates, également source d’énergie pour
le phytoplancton, sont considérés comme de bons indicateurs du caractère anoxique des eaux de
fond. La variabilité saisonnière est importante, les plus fortes valeurs en nitrates ont été relevées
en hiver (à la suite d’apports accrus par les tributaires), tandis que l’ammonium (produit de la
dégradation) est plus abondant en période chaude. Les concentrations en azote et phosphore
total, témoins du niveau trophique, sont également plus fortes en période chaude (jusqu’à la fin de
1
les valeurs des rejets urbains et industriels ne sont pas encore disponibles pour l’année 2008.

Bilan du suivi écologique- année 2008
GIPREB
5
l’automne). On note, en revanche, une relative homogénéité des concentrations entre la surface et
le fond (y compris pour les phosphates). Plus globalement, la diminution des teneurs en sels
nutritifs dans l’étang amorcée au début des années 2000 se confirme en 2008.
Les teneurs en chlorophylle-a suivent cette tendance, elles sont restées comprises entre 1 et 18
µg.l
-1
au cours de l’année 2008 (Fig. 12 ; Fig. 13 ; Fig. 14)). En période chaude, cependant, les
concentrations en chlorophylle-a ont été plus élevées, les valeurs maximales ont été atteintes, en
août.
La transparence de l’eau est directement conditionnée à la charge en matière particulaire
(phytoplancton notamment). A l’échelle de l’étang, la turbidité a été plus élevée en août et
septembre 2008 ; la couche euphotique (1% de la lumière incidente) n’atteignait plus que 4m de
profondeur en septembre (Tab. 4). Pour autant, la diminution de la turbidité au cours des années
récentes se confirme en 2008 (Fig. 15).
Sur la base des indices retenus par le RSL (Réseau de Suvi Lagunaire en Languedoc-Roussillon)
et par la DCE, l’étang de Berre est classé, en 2008 encore, dans un état
« passable » à
« médiocre » en terme d’eutrophisation (Tab. 5 ; Tab. 6).
Le principal paramètre déclassant reste la
biomasse chlorophyllienne.
2.3 Populations phytoplanctoniques
Les communautés phytoplanctoniques de l’étang de Berre sont composées d'espèces marines
néritiques et saumâtres dominées par des espèces de petite taille tout au long de l'année. En
2008, les diatomées ont encore dominé le peuplement les plus abondantes sont des espèces de
petite taille (i.e. Skeletonema costatum, Cyclotella sp., Phaeodactylum tricornutum, Cylindrotheca
closterium). Les dinoflagellés présents (essentiellement au mois de mai) sont également des
espèces de petite taille (des genres Gymnodinium et Gyrodinium).
Après une diminution marquée, de 2004 à 2006, des abondances phytoplanctoniques dans l’étang
de Berre, 2007 et 2008 ont montré des abondances en augmentation (Fig. 16 ; Fig. 17). Ainsi, d’un
point de vue quantitatif, les principales efflorescences ont été observées à partir du mois de mai,
avec des concentrations dépassant 15.10
6
cel.L
-1
. Les concentrations sont restées élevées
(supérieures à 10.10
6
cel.L
-1
) pendant l'été et ont encore augmenté en octobre pour dépasser
20.10
6
cel.L
-1
, le maximum observé en 2008 (Fig. 18).
En ce qui concerne les dinoflagellés potentiellement toxiques, des espèces du genre
Gymnodinium ont été identifiés tout au long de l’année, avec des abondances supérieures au mois
de mai (Fig. 19). Ces concentrations sont, toutefois, restées faibles au regard des densités des
autres espèces. G. catenatum, espèce considérée comme inféodée à la zone sud de la
Méditerranée semble faire partie désormais des communautés propres à l'étang de Berre et
confirme l'extension de sa zone d'influence jusqu'au nord de la Méditerranée occidentale. Des
chaînes de Pseudonitzschia sp. ont également été observées au mois de novembre.
2.4 Macrophytes et herbiers de Zostères
Les peuplements de macrophytes de l’étang de Berre présentent des signes d’importantes
perturbations. Les herbiers de magnoliophytes (phanérogames) ont fortement régressé, ils ne sont
plus présents qu’à l’état de vestige et ne constituent plus de peuplement fonctionnel. Les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%