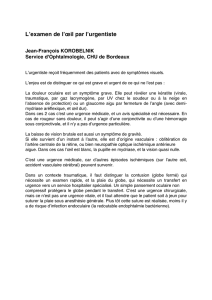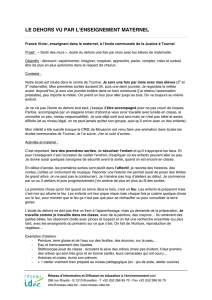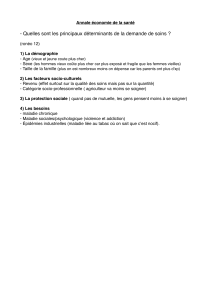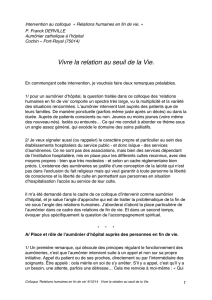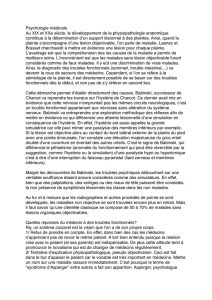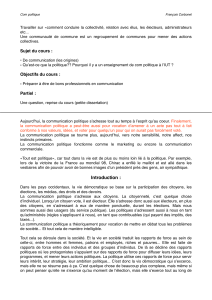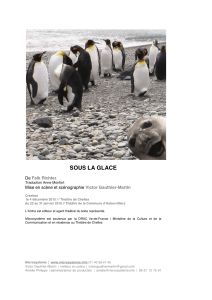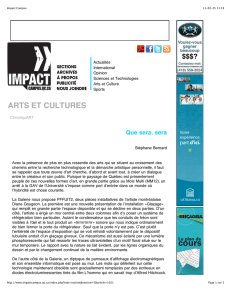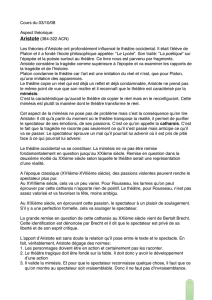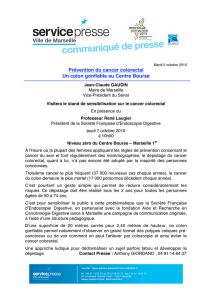Science politique générale

Science politique générale.
Introduction.
La science politique, telle quʼelle est définie dans le dictionnaire, est la discipline qui a
pour vocation dʼétudier et mettre en relation les différentes dimensions de la vie politique :
idéologies, théories, valeurs, institutions, organisations, comportements politiques...
La science politique a fait son entrée dans les facs de droit en 1954. Cʼest une matière qui
diffère de ce quʼon peut trouver dans ces fac. Lʼobjet de la discipline peut poser problème,
dans le sens où cet objet, lʼétudiant a lʼimpression de déjà le connaître. Cʼest ce quʼon
appelle lʼillusion du savoir immédiat.
1. Lʼillusion du savoir immédiat.
Ce quʼon appelle aussi les prénotions (Durkheim), que dʼautres ont pu également appeler
la connaissance vulgaire, le sens commun (opposition entre savoir savant et savoir
spontané (Bourdieu). Il suffirait dʼobserver avec attention un phénomène pour faire oeuvre
scientifique. Or ce nʼest pas lʼobjet qui fait la science, mais le choix des méthodes. Pour
faire de la science politique il faut être en mesure de distinguer lʼobservation scientifique
de lʼobservation intuitive. Il faut aussi être en mesure de distinguer la science politique du
journalisme politique (attention : pas de jugement de valeur), même si il y a aujourdʼhui
une confusion certaine entre les deux (Alain Duhamel, Olivier Duhamel).
Nous avons des convictions héritées de notre histoire familiale, personnelle : nous avons
été socialisés. Nous partageons tous, de façon plus ou moins consciente, une certaine
idéologie, nous sommes détenteurs dʼune certaine culture politique.
2. La socialisation politique.
Processus dʼinculcation de normes et de valeurs qui va permettre à une société dʼintégrer
ses membres.
Braud : Sociologie politique (plutôt ouvert à lʼécole bourdieusienne)
Jean Baudouin : Introduction à la sociologie politique (plutôt hostile)
A consulter en parallèle. Deux points de vue différents.
Braud : «Processus dʼinculcation de normes et de valeurs qui organise les perceptions par
les agents sociaux du pouvoir politique (dimension verticale) et du groupe (dimension
horizontale).»
En France, Annick Percheron et Anne Muxel ont travaillé sur la socialisation politique.
Cette socialisation permet lʼintériorisation de normes et de croyances collectives. Elle est
utile aux gouvernants et aux gouvernés. Aux gouvernants, pour légitimer leur pouvoir
auprès des gouvernés. Ce qui signifie obtenir leur consentement à lʼobéissance. Elle est
utile également aux gouvernés, dʼun point de vue psychologique. Parce quʼelle leur donne
lʼimpression quʼen obéissant aux gouvernants ils conservent leur liberté. Parce quʼen
définitive par ce mécanisme ils ont lʼimpression dʼobéir non pas à la personne des
gouvernants mais à un principe supérieur. Selon les régimes, obéir à la volonté générale,

à la Loi, au principe de la Justice, à la Nation, à la Patrie, bref quelque chose qui les
dépasse. Ce travail de socialisation politique est effectué par divers vecteurs quʼon divise
en deux : des milieux, et des agents de socialisation.
Les milieux.
La famille (voir Percheron et Muxel). On a une identité dans le choix électoral
enfant-parent de 50%. Cette identité est encore plus forte que 50% si lʼaccord sur le
choix électoral est exprimé devant lʼenfant. Les amis, les groupes dʼamis, les
voisins aussi (surtout dans les pays anglo-saxons, en France cʼest moins vrai sauf
peut-être en banlieue). Lʼécole est un milieu important de socialisation aussi, la
classe sociale également (même si le concept nʼest plus très tendance...), les
associations, les syndicats, les Eglises, et les communautés locales et nationales
via le discours porté par les médias.
Les agents.
A lʼintérieur de chacun de ces milieux sociaux, on trouve des agents de
socialisation. A lʼécole, lʼinstituteur va être un agent de socialisation. Il relaie,
consciemment ou non un certain discours qui va être plus ou moins représentatif de
lʼautorité. Quelle autorité? La sienne, celle des parents, des ministres qui ont défini
le programme? On sait pas mais en tout cas il représente une autorité. Mais ce
nʼest pas le seul : il est en présence dʼélèves leaders qui vont plus ou moins
contester son discours. On peut aussi citer le rôle des leaders dʼopinion à lʼintérieur
des associations, y compris celles qui nʼont a priori aucune vocation politique. Et à
fortiori dans les partis, qui sont des associations (en France). Dans la famille, il y a
aussi des leaders dʼopinion. Dans la famille «traditionnelle», le père et la mère, ou
juste le père, ou juste la mère. Ou un oncle ou une tante, si on est en relation de
confiance avec lui et quʼil y a des problèmes avec les parents.
Ensemble de croyances et de valeurs qui influences nos comportements individuels :
idéologie et comportements politiques.
3. Le concept dʼidéologie
Il y a autant de concepts dʼidéologie que dʼauteurs. Trois grands types de définitions.
•Dʼabord, les définitions péjoratives ou non basées sur les critères du vrai ou du faux.
On trouve de type dʼapproche chez Marx, le jeune Marx : cʼest la vision déformée,
inversée de la réalité. Lʼidéologie nʼest pas la réalité. Cʼest la camera obscura, qui
donne une image renversée. Marx appelle ça la conscience fausse de la réalité.
Raymond Aron (voir Les étapes de la pensée sociologique) appelle idéologie «les
idées de mon adversaire».
•Deuxièmes définitions : les définitions instrumentales, de sens commun. Lʼidéologie
est dans ce cas lʼensemble des idées, doctrines ,croyances propres à une époque,
une classe, ou à une société. Bref : cʼest un système de croyances (les croyances
sont organisées dans un ensemble cohérent).
•Troisièmes définitions : les définitions savantes. Définition de Raymond Boudon : les
idéologies sont des doctrines plus ou moins cohérentes qui combinent à dose
variable des proposition prescriptives et des propositions descriptives. Ex :

socialisme, libéralisme, écologisme... Exemple de lʼidéologie marxiste. Proposition
descriptive : le capitalisme organise la domination dʼune classe. Proposition
prescriptive : il faut faire la révolution. Autre définition Braud : ensemble structuré de
représentations du monde social qui fonctionne à la croyance politique et à la
violence symbolique (à distinguer de la violence visible ; il sʼagit des rapports de
domination etc...)
4. La notion de culture politique.
Cʼest un terme qui peut prêter à confusion. En science politique, la culture politique ce
nʼest pas la masse de connaissances que lʼon accumule sur la chose politique. Ce nʼest
pas le fait de connaître la liste des présidents de la Ve république, ou les membres du
conseil constitutionnel... Ca, cʼest la dimension cognitive de la culture. Tout le monde
véhicule une certaine culture politique. Nous avons tous, consciemment ou non, un certain
système de représentation qui filtre notre perception du réel, notre rapport au champ
politique.
Par culture politique, les spécialistes entendent généralement «lʼensemble des attitudes,
croyances et sentiments qui donnent un ordre et un sens à un processus politique».
(Lucian Pye). (voir le chapitre sur la culture politique dans le traité de Grawitz et Lecas).
Seconde définition, celle de Philippe Braud. «Lʼhéritage de savoirs, croyances et valeurs
qui donnent sens à lʼexpérience routinière que les individus ont de leurs rapports au
pouvoir qui les régit, et aux groupes qui leur servent de références identitaires». Que
signifie «référence identitaire»? En sociologie, il y a une distinction entre le groupe
dʼappartenance et le groupe de référence. Appartenance : lʼâge, le sexe, la profession, la
religion, la nationalité, lʼethnie. Référence : les jeunes, les seniors, le centre, la droite, la
gauche en politique, travailleur, wasp, afro américain, latino aux Etats Unis. En France, les
classes moyennes.
Pourquoi toutes ces définitions avant de rentrer dans le vif du sujet? Dʼabord parce que la
politique, c'est le domaine des émotions, de la violence, domaine qui rime avec rapport de
force. On peut donc difficilement se comporter, en science politique, comme un géologue
face à ses pierres. Ca nécessite donc de savoir de quoi on parle, et de ne pas confondre
deux logiques : la logique du savant, et la logique du militant (voir Weber, le savant et le
politique). Deux logiques qui sont incompatibles. La logique du savant est le dévoilement
de la vérité, alors que la vocation du militant cʼest le dévouement à la cause. Dans les
deux cas, on retrouve lʼobjet politique, quʼon a tous lʼimpression de connaître plus ou
moins a priori.
5. La notion de politique.
BURDEAU": la politique a cessé dʼêtre un domaine spécialisé car elle englobe toute la vie
humaine.
LECOMTE & DENI": caractère POLYMORPHE de cette notion & POLYSEMIQUE du
terme.
Notion chargée et surchargée sémantiquement.
«"Equivoque et instable, la pol fait partie de ces notions à la fois singulières et familières
qui, saturées de sens, brillent mais nʼéclairent pas."»

Réalités différentes pour «"pol"»
#Etymologie": cité
#Approche aristotélicienne": art de gouverner les hommes en société
#Mais autres significations moins neutres.
#P. Valéry": art dʼempêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde.
#Puis +": art de décider les gens sur ce quʼils nʼentendent pas.
#
Puis conceptions péjoratives de la politique.
#Mensonges
#Débat stérile
#Profit
#Magouille
#Trahisons
#Démagogie
#Corruption «"mains sales"» Sartre
Les professionnels de la politique & leur langage.
#«"Administration, gestion des intérêts de la cité.
#Et ceux qui font de la politique, ce sont les adversaires, car idéologie."»
#= contradiction avec eux-mêmes, antipolitisme
«"un fin politique"»
= stratège, diplomate
= qualité
- LES politiques = acteurs
- Couleur politique, sensibilité,
- La politique «"africaine"» = domaine
- Politique réactionnaire, libérale, = orientation
- Prisonnier politique = x de droit commun, solution politique = x militaire = option
- Politique du gouvernement = stratégie
- Politique de protection de lʼenvironnement = politiques publiques
POLICY": produits de lʼaction gouv.
Càd les programmes, les décisions, les lois, les règlements
Càd différentes politiques publiques
Càd OUT PUT (en analyse systémique) = politiques produites
POLITICS": processus liés à lʼexercice et à la conquête du pouvoir politique.
= LA politique
Pour localiser la sphère politique, les auteurs ont joué sur le genre du mot.
BRAUD":
•Le politique : «champ social de contradictions dʼintérêts (réels ou imaginaires),
matériels ou symboliques. Mais aussi de convergences et dʼagrégations partielles et
régulé par un pouvoir disposant du monopole de la coercition légitime."»
•La politique : «la scène où sʼaffronte les individus et les groupes en compétition pour
conquérir le pouvoir dʼEtat (et ses démembrements) ou pour lʼinfluencer directement."»

Jean LECA :#
•La politique : «ensemble des normes, mécanismes et institutions"attribuant lʼautorité,
désignant les leaders, réglant les conflits qui menacent la cohésion de lʼensemble
intérieur et faisant la guerre à lʼextérieur"; ou encore lʼinstance où sʼarticule depuis le
début les rapports de commandement-obéissance (le droit) et de domination-soumission
(la force)».
•Le politique : «le politique se repère essentiellement par sa fonction qui est la régulation
sociale, fonction elle-même née de la tension entre le conflit et lʼintégration dans une
société.»
>>>>>>>
Monarchomaques ///////
Il y a autant de définition du politique que dʼauteur. Définir cʼest toujours un moyen de
sʼapproprier.
Lagroye (Sociologie politique) définit le politique comme lʼensemble des
phénomènes tenus pour politique. Plus loin, il nous dit quʼest
politique ce que chacun reconnaît comme relevant du
domaine politique. Il donne pour mission à l a
sociologie politique la mission dʼanalyser tout ce qui
est politique. La sociologie politique doit «saisir et
expliquer tous les phénomènes sociaux ayant une
quelconque influence sur le politique».
La politique nʼest pas une essence. Certains auteurs refusent la différenciation la/le
politique. Tous les politistes sont dʼaccord pour dire que la politique nʼest pas une essence,
et quʼemployer cette distinction signifierait quʼil y a le politique, dans sa pureté, et la
politique qui serait un avatar, une forme dégradée et corrompue. Cʼest une vision idéaliste.
Vaste
programme
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%