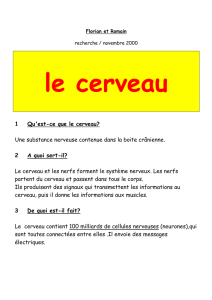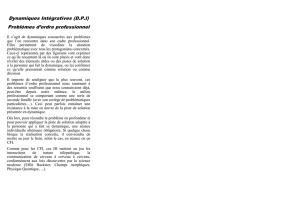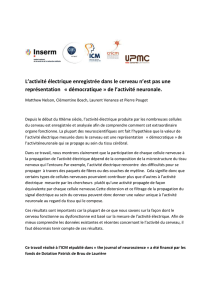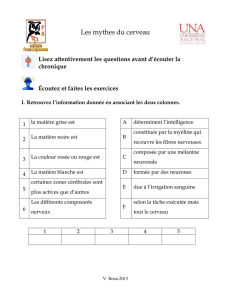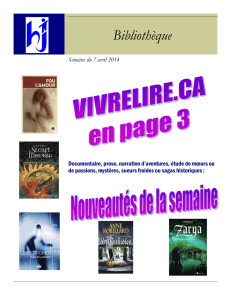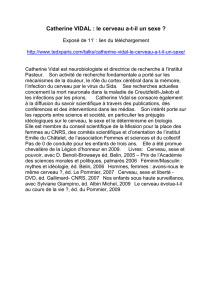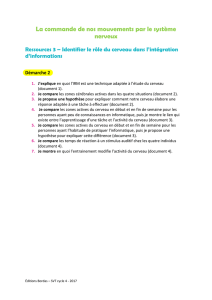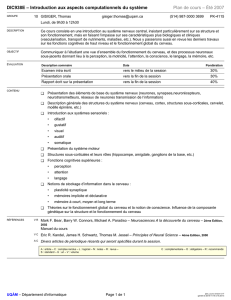Séminaire de l`AEP (Aumônerie de l`Enseignement - ere

Séminaire de l’AEP (Aumônerie de l’Enseignement public)
La construction des intelligences :
neurosciences et conséquences pédagogiques
Paula Jeanbart
paula.jeanba[email protected]r
1. Introduction........................................................................................................................1
2. Repères historiques ............................................................................................................1
3. Différentes facultés intellectuelles.....................................................................................3
4. Epigenèse cérébrale............................................................................................................3
5. Construction de l’intelligence humaine..............................................................................6
5.1. Définition ...................................................................................................................6
5.2. Mesure de l’Intelligence.............................................................................................6
5.3. Le développement intellectuel ...................................................................................7
5.4. Que se passe-t-il dans la tête d’un nourrisson avant qu’il ne parle ? .........................7
6. Conséquences pédagogiques..............................................................................................7
6.1. Epistémologie.............................................................................................................7
6.1.1. Visées et Structure des Savoirs Scientifiques ....................................................8
6.1.2. Démarche d’investigation ..................................................................................8
6.2. Appropriation du savoir .............................................................................................8
6.2.1. Conceptions (représentations ; conceptions conjoncturelles ; représentations
sociales, etc.)......................................................................................................................8
6.2.2. Notions d’obstacles (obstacles épistémologiques ; obstacles didactiques ;
obstacles psychologiques)..................................................................................................8
7. Conclusion..........................................................................................................................9
8. Bibliographie......................................................................................................................9
1. Introduction
D’abord, l’objet des neurosciences – Le cerveau – est un objet hors pair. Jusqu’à une date
récente, l’étude de l’esprit, de la conscience et des sentiments était l’objet de la philosophie et
de la religion, bien loin du territoire des sciences dures. Le développement des recherches sur
le système nerveux s’est toujours heurté, au cours de l’histoire, à de farouches obstacles
idéologiques. Plusieurs travaux de recherche ont porté récemment sur l’identité biologique,
trop souvent associée dans les programmes et les manuels scolaires français à la seule identité
génétique. Ce travail aborde la construction des intelligences vues par les chercheurs et les
neuroscientifiques avec ses deux côtés inné/acquis et le rôle de chaque côté dans ce processus
aboutissant à la fin à en tirer les conséquences pédagogiques de manière à orienter l’apprenant
vers l’appropriation du savoir selon la démarche constructiviste.
2. Repères historiques

Depuis l’Antiquité et au delà, les interprétations sur la nature de l’esprit et de la pensée furent
spiritualistes.
Au XVIIe siècle, le dualisme de Descartes distinguait le corps de l’esprit niant au premier la
capacité d’abriter le second (Fottorino 1998). Consacré siège de la pensée et des émotions, le
cerveau est une entité immatérielle d’une nature autre que celle du corps. Ce siècle, fut
également l’époque du déterminisme religieux (qui persiste jusqu’à nos jours) : toute notre vie
était écrite dans le programme de Dieu ou dans la conjonction astrale, dans la ligne de nos
mains ou même dans la morphologie de notre visage (Clément 2007).
Au XVIIIe siècle et grâce au progrès scientifique, le matérialisme scientifique commença à
rompre avec le spiritualisme jusqu’alors dominant. La Mettrie (1709-1751) dans « l’Homme-
machine » (1734) assume une rupture avec le spiritualisme et le dualisme de Descartes et
attribue au cerveau un rôle essentiel et actif qui lui permet de contrôler le corps entier (Le
cerveau a ses muscles pour penser comme les jambes pour marcher). A cette époque là et ça
continue jusqu’à nos jours Il y a l’astrologie, la chiromancie (caractère ou destinée d’une
personne sont connaissables d’après les lignes de la main), la physiognomonie relayée par la
morphopsychologie (l’apparence physique d’une personne et principalement les traits de son
visage, peut donner un aperçu de son caractère ou de sa personnalité et plus récemment le
déterminisme génétique.
Au XIXe siècle, vers 1802, Gall, médecin et chef de file d’un courant de pensée, la
phrénologie, postulait que le développement des aptitudes mentales correspondait à des
bosses détectable par palpation de la boîte crânienne (ex. la bosse des maths).
Pour Lombroso, c’est la constitution physique du personnage qui le pousse à devenir criminel
ou non.
Avec la craniologie de Broca, c’est le poids et le volume du cerveau qui prédestineraient
chacun à être plus ou moins intelligent (le cerveau des femmes étant nettement moins lourd
que celui des hommes, Broca mit en relation cette infériorité physique avec ce qui était admis
à cette époque : « l’infériorité intellectuelle » des femmes ; tout comme il était convaincu que
le cerveau des Blancs était plus gros que celui des Noirs.). Cent vingt ans après, Stephen J.
Gould (1983) a ré analysé les données originales de Broca, et montré que les différences de
poids de ces cerveaux étaient liées à la taille des individus, à leurs âges, puis à la présence ou
absence de méninges (puisqu’il s’agissait de cadavres), etc. : le paramètre sexe n’intervient
pas ! Dans l’espèce humaine, il n’existe aucune relation entre le poids du cerveau et
l’intelligence (synthèse dans Vidal 2001).
Plus récemment, et selon les héréditaristes, ce sont nos gènes qui contrôlent nos pensées et
notre intelligence. Cette réduction du biologique au génétique est fortement liée au débat
inné/acquis en associant la biologie principalement à l’inné. Comme si toute l’identité d’un
être humain était programmée dans son génome.
A la fin du XXe siècle, les biologistes savent que tout génome ne peut s’exprimer qu’en
interaction avec son environnement. Ils savent aussi que nos comportements et pensées sont
appris et ont un support biologique. L’affrontement entre inné et acquis est dépassé à cause de
cette interaction inné/acquis où les caractères génétiques et environnementaux interagissent
tout au long de la construction de l’organisme.
Or à l’aube de ce XXIe siècle, la complexité du vivant, avec le progrès des sciences et des
découvertes scientifiques, ne peut plus être réduit au déterminisme génétique. D’autres
mécanismes épigénétiques s’imposent pour analyser l’auto-construction du vivant (Varela
1989) grâce à l’épigenèse cérébrale.

Les neurobiologistes savent que le cerveau est façonné par l’environnement en même temps
que par la génétique. D’ailleurs les connaissances actuelles sur l’épigenèse du cerveau humain
montrent l’importance primordiale de l’expérience personnelle dans la mise en place des
réseaux neuronaux (Fottorino 1998, Edelman 2001).
Ajoutons que récemment toutes les recherches neurobiologiques insistent sur la plasticité et
l’épigenèse cérébrale : depuis au moins Changeux 1983, Edelman 1992, Jeannerod 1983,
Rosenfield 1989, Delacour 1998…, jusqu’aux travaux actuels sur le cerveau et sur les
modèles cognitifs. En effet, un large accord existe sur le fait que les réseaux neuronaux se
configurent dans notre cerveau en fonction de notre expérience individuelle, pour être les
supports de notre pensée. Même des philosophes qui sont des chrétiens convaincus comme P.
Ricoeur en conviennent et admettent que « le cerveau est le substrat de la pensée » et que « la
pensée est l’indicateur d’une structure neuronale sous-jacente »( Changeux & Ricoeur 1998).
En d’autres termes, notre cerveau se configure quand il apprend.
Cependant, cette dimension de la biologie, à savoir le remaniement permanent de la
configuration du cerveau par l’expérience individuelle, essentielle notamment parce qu’elle
établit des liens entre le cerveau et l’éducation, n’est enseignée en France (au moins jusqu’à la
dernière réforme) ni dans le secondaire ni dans la formation des maîtres : ce qui contribue
malgré la médiatisation de ces connaissances sur l’épigenèse cérébrale à entretenir une
association forte entre la Biologie et l’héréditarisme. La problématique qui s’impose : nos
enseignants et étudiants réduisent-ils leur identité biologique à leurs gènes (qui sont uniques
sauf chez les monozygotes) ? Notre cerveau est-il pensé comme le support de nos pensées, de
nos mémoires, de notre histoire individuelle et sociale qui a construit notre identité unique ?
Conçoivent-ils que leur identité individuelle et sociale a comme support biologique des
réseaux neuronaux dans notre cerveau : l’épigenèse cérébrale.
3. Différentes facultés intellectuelles
Avec les nouvelles techniques d’imagerie cérébrale qui permettent d’observer le cerveau en
train de fonctionner, les spéculations sur les différences de mode de fonctionnement entre les
sexes n’ont plus cours comme par exemple : les meilleures compétences des hommes en
mathématiques résultent d’un plus grand développement de leur hémisphère droit par rapport
à celui du cerveau de la femme. Or, des expériences utilisant l’IRM fonctionnelle montrent
précisément le contraire : pour résoudre des problèmes de calcul, les régions les plus actives
sont : le cortex frontal gauche et les aires pariétales gauche et droite, et ce quel que soit le
sexe des sujets : Aucune différence significative entre les sexes ne ressort de la grande
majorité des études d’imagerie, qui depuis une dizaine d’années analyse l’activité du cerveau
dans les fonctions cognitives supérieures.
Parallèlement aux travaux des psychologues du développement, les neurologues étudient les
facultés cognitives des bébés. L’imagerie cérébrale révèle le rôle de différentes aires
cérébrales :
Le lobe temporal gauche réagit ainsi préférentiellement au langage parlé. On observe aussi
que la latéralisation ou la prise en charge de certaines fonctions cognitives par les
hémisphères droit ou gauche du cerveau, s’effectue avant même la naissance. Ainsi, in utero,
les futurs gauchers sucent leur pouce gauche, et les droitiers leur pouce droit.
4. Epigenèse cérébrale

L’aspect du cerveau d’un nouveau-né ressemble à celui d’un adulte. Toutefois, si toutes les
structures cérébrales importantes sont présentes et si le nombre de neurones est maximal, le
développement du cerveau est loin d’être achevé : le poids du cerveau triple avant l’âge de 5
ans et continue d’augmenter jusque vers 18 ans. Pendant cette première phase de maturation,
le réseau de connexions entre neurones se densifie. Les neurones « poussent », les synapses se
multiplient à un rythme soutenu. C’est pourquoi le cerveau d’un enfant grandit bien que le
nombre de neurones reste constant.
Après cette phase de prolifération, les synapses inutiles sont éliminées : ainsi le cerveau
produit d’abord un excès de contacts, et choisit ensuite ceux qu’il convient de conserver,
éliminant les autres.
La seconde phase est celle de l’apprentissage : les connexions synaptiques augmentent
rapidement jusqu’à 6 à 8 mois, et l’acuité visuelle est alors identique à celle de l’adulte. C’est
le moment où l’enfant se tient assis et découvre les détails de son environnement. A partir de
six mois, le nombre de synapses diminue, et seuls les réseaux de neurones dont les synapses
sont conservées sont stabilisés. Durant les premiers mois de sa vie, l’enfant passe beaucoup
de temps à la maison. Le changement est saisissant quand il découvre, de nouvelles
perspectives, par exemple, lors d’une promenade en ville ou dans un parc où il découvre les
voitures qui passent, observe et examine avec intérêt les personnes et les animaux qui s’y
trouvent. Ce qu’un enfant voit durant cette période dépend beaucoup de la culture où il
grandit. Ainsi, un bébé qui grandit dans un milieu où il découvre tous les jours des choses
bien différentes de celles qu’observe un enfant qui grandit dans la jungle. Contrairement au
mécanisme de la formation des synapses, qui dépend de la maturation, l’élimination des
synapses surnuméraires dépend de l’expérience : seules les connexions les plus utilisées
persistent. La structuration du cerveau est déterminée. Ce processus est appelé l’épigenèse
cérébrale.
Selon Changeux (2002), l’Epigénétique associe deux significations : c’est « l’idée de
superposition à l’action des gènes, suite à l’apprentissage et à l’expérience, et celle de
développement coordonné et organisé ». En d’autres termes, au cours du développement,
« des régulations épigénétiques ont lieu assemblant les neurones du réseau et façonnant
l’anatomie du cerveau, la topologie des aires corticales et le détail des connexions qui échappe
au pouvoir des gènes ».
Changeux explique que ce qui distingue l’Homme du Chimpanzé, c’est cette différence
génétique qui porte sur à peine 1% de l’ensemble des séquences du génome. Mais c’est grâce
à cette petite différence qu’il y a eu des changements majeurs dans l’organisation anatomique
du cerveau et dans son développement. Ce développement persiste après la naissance,
beaucoup plus longtemps chez l’homme que chez le chimpanzé. Ceci va permettre
« l’apprentissage par épigenèse (non génétique), l’ouverture à l’environnement, le langage,
la culture, bref ce qui scelle la spécificité humaine… ». Certainement, il y a un déterminisme
génétique qui permet à l’homme d’être ouvert socialement et culturellement.
Le cerveau naît immature, il se configure et se complexifie grâce au processus épigénétique
c’est- à- dire en fonction de ce que chaque individu apprend, de son expérience personnelle et
de son environnement (Clément 1999). Les premiers hommes, Homo Sapiens avaient le
même cerveau mais pas la même culture.
Epigenèse cérébrale selon Changeux :

Figure 1: hypothèse de l’épigenèse par stabilisation sélective telle qu’elle a été proposée
par J.P Changeux dans « l’homme neuronal ».
Selon Changeux, dans cette figure, l’épigenèse par stabilisation sélective est exercée par
« l’entrée en activité, spontanée et/ou évoquée, du réseau nerveux en développement et qui
règle l’élimination des synapses surnuméraires mises en place au stade de la redondance
transitoire (Changeux 1983).
croissance
Redondance
transitoire
Stabilisation
sélective
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%