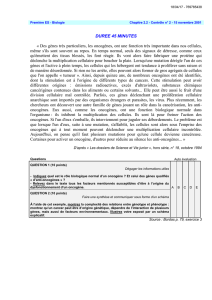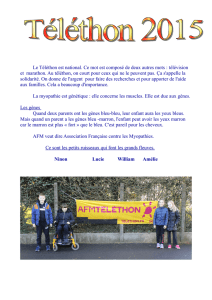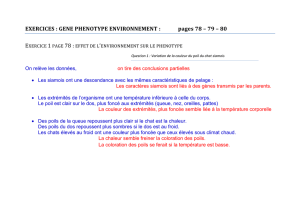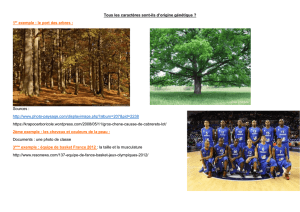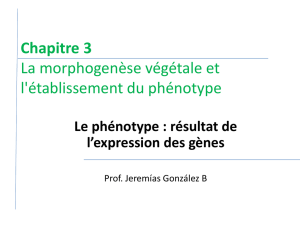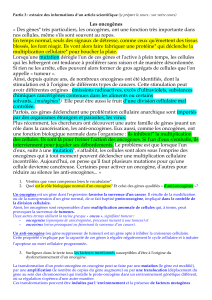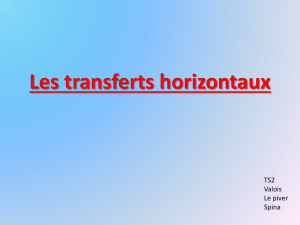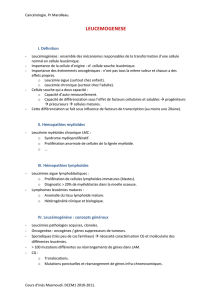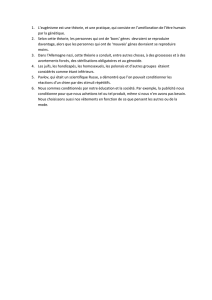Exercices Relations entre gènes phénotypes et environnement

Exercices Relations entre gènes phénotypes et environnement
Exercice 1 :
Les chats siamois possèdent un phénotype très caractéristique : les yeux sont bleus et affectés d'un léger
strabisme, la fourrure très claire sur le corps est de couleur brun foncé sur la queue, les extrémités des pattes, les
oreilles, le museau. On constate cependant d'importantes variations phénotypiques : les chats élevés sous des
climats froids ou bien à l'extérieur sont plus foncés que ceux élevés sous climat chaud ou en intérieur. Plusieurs
données permettent de comprendre l'origine de tels phénotypes :
• Les chats siamois sont obtenus par croisements à partir de parents possédant eux-mêmes ces caractéristiques.
• Les extrémités de l'organisme (queue, pattes, oreilles, museau) ont une température corporelle inférieure à celle
du reste du corps.
• Si des poils sombres sont arrachés de la queue et si le chat est placé à une température plus élevée que la
normale, le nouveau pelage qui repousse est clair.
• Inversement, si on enlève quelques poils clairs situés sur le dos et si l'on refroidit cette zone, les poils qui
repoussent sont foncés.
1. Expliquez les variations de couleur prises par le pelage des chats siamois à la surface du corps ainsi que
les variations phénotypiques souvent constatées.
2. En définitive, à quoi est due la couleur du pelage des chats siamois?
Exercice 2 :
« Des gènes très particuliers, les oncogènes, ont une fonction très importante dans nos cellules, même s'ils sont
souvent au repos. En temps normal, seuls des signaux de détresse, comme ceux qu'émettent des tissus blessés,
les font réagir. Ils vont alors faire fabriquer une protéine qui déclenche la multiplication cellulaire pour boucher la
plaie. Lorsqu'une mutation dérègle l'un de ces gènes et l'active à plein temps, les cellules qui les hébergent ont
tendance à proliférer sans raison et de manière désordonnée. Si rien ne les arrête, elles peuvent alors former de
gros agrégats de cellules que l'on appelle « tumeur ». Ainsi, depuis quinze ans, de nombreux oncogènes ont été
identifiés, dont la stimulation est à l'origine de différents types de cancers. Cette stimulation peut avoir différentes
origines : émissions radioactives, excès d'ultraviolets, substances chimiques cancérigènes contenues dans les
aliments ou certains solvants... Elle peut être aussi le fruit d’une division cellulaire mal contrôlée. Parfois, ces gènes
déclenchant une prolifération cellulaire anarchique sont importés par des organismes étrangers et parasites, les
virus. Plus récemment, les chercheurs ont découvert une autre famille de gènes jouant un rôle dans la
cancérisation, les anti-oncogènes. Eux aussi, comme les oncogènes, ont une fonction biologique normale dans
l'organisme : ils inhibent la multiplication des cellules. Ils sont là pour freiner l'action des oncogènes. Si l'un d'eux
s'emballe, ils interviennent pour juguler ses débordements. Le problème est que lorsque l'un d'eux, suite à une
mutation, s'affaiblit, les cellules sont alors sous l'emprise des oncogènes qui à tout moment peuvent déclencher une
multiplication cellulaire incontrôlée. Aujourd'hui, on pense qu'il faut plusieurs mutations pour qu'une cellule devienne
cancéreuse. Certaines pour activer un oncogène, d'autres pour réduire au silence les anti-oncogènes... »
1. Quel est le rôle biologique normal d'un oncogène? Et celui des gènes qualifiés « d'anti-oncogènes »?
2. Relevez dans le texte tous les facteurs mentionnés susceptibles d'être à l'origine du dysfonctionnement
d'un oncogène.
3. À l'aide de cet exemple, illustrez la complexité des relations entre génotype et phénotype : montrez qu'un
cancer peut être d'origine génétique, dépendre de l'interaction de plusieurs gènes mais aussi de facteurs
environnementaux. Illustrez votre exposé par un schéma explicatif.
Exercice 3 :
« Depuis un siècle, les Français ont gagné 7 bons centimètres et les Françaises 5. Cette irrésistible ascension
aboutit à un couple standard où l'homme mesure 1,74 m et la femme 1,67 m. Mais nous ne sommes pas les seuls à
nous hausser du col. Même les Japonais se sont lancés dans la course. Les garçons nippons nés en 1960
mesurent, en moyenne, 5,2 cm de plus que ceux nés en 1940. Mais, même si d'une façon générale nous
grandissons, nous nous situons (hors maladie) dans une fourchette qui va de 1,50 m à 1,90 m. Il est donc probable
que nous soyons génétiquement programmés pour osciller entre un petit mètre cinquante et un grand mètre quatre-
vingt-dix. Les biologistes connaissent bien la physiologie de la croissance. Ils savent qu'un seul gène serait
incapable d'orchestrer ce travail complexe qui met en jeu une foule d'organes, d'hormones et de substances
diverses : hypophyse, cartilage, hormone de croissance, calcium… à différentes périodes de l'existence. C'est donc
toute une batterie de gènes qui se chargent de cette besogne, en s'activant et en s'éteignant au fil du temps.
Mais à n'en pas douter, la raison majeure de l'augmentation de la taille moyenne des populations est à trouver dans
l'amélioration des conditions de vie. Que survienne une embellie économique, confort, nourriture abondante et la
génération suivante gagne quelques centimètres. Tout ceci montre que l'environnement joue un rôle capital dans
l'expression de nos caractères. Inutile d'avoir les bons gènes de la croissance si l'on ne possède pas les éléments
indispensables à leur expression. Sans acides aminés, calcium et potassium, apportés par une alimentation
suffisamment riche et équilibrée, tout le travail des gènes est sans effet. »
D'après « Les dossiers de Science et Vie Junior », n° 18, octobre 1994.
1. À l'aide de cet exemple, montrez le rôle complémentaire des gènes et de l'environnement dans
l'établissement du phénotype.
2. En raisonnant à partir des explications données par ce texte, indiquez s'il est probable ou non que la taille
moyenne des Français continue de s'accroître.
1
/
1
100%