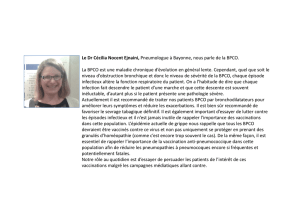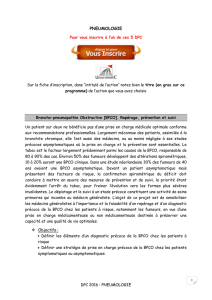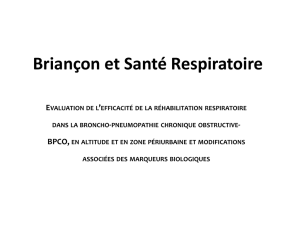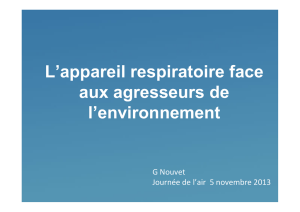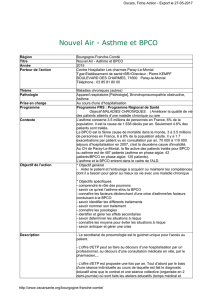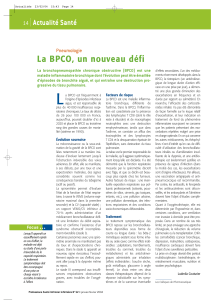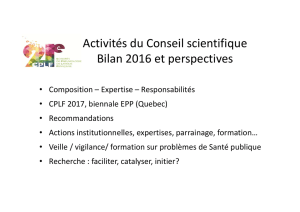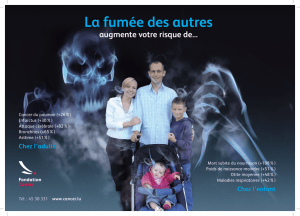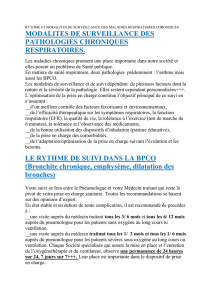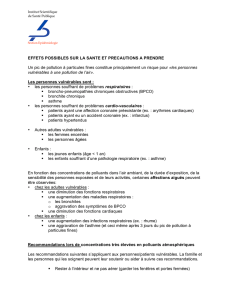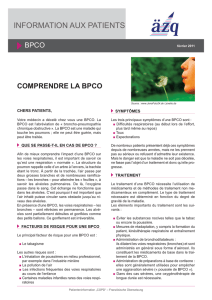bPco - Antadir

Editorial
Sommaire
Congrès de l’ERS - Vienne 2009
Nouvelles perspectives
dans le traitement de
la BPCO
Dr Anne GUILLAUMOT – AGEVIE Lorraine, Nancy
En dépit de moyens thérapeutiques
bien codifiés, la BPCO reste une
maladie sous-traitée de mauvais
pronostic. Les objectifs de la recherche
pharmacologique sont l’amélioration
de l’efficacité des traitements existants
(bronchodilatateurs, corticoïdes),
et le développement de stratégies
thérapeutiques adaptées au
concept systémique de la BPCO
(Fabbri LM. Lancet 2007,370 ; 797-799).
OPTIMISER LA BRONCHODILATATION :
La famille des bronchodilatateurs constitue un arsenal
thérapeutique vaste, dont l’efficacité n’est plus
à démontrer. La recherche se focalise sur le
développement de molécules de plus longue durée
d’action, pour améliorer l’observance, principal facteur
limitant l’impact clinique des traitements de fond.
Plusieurs molécules ont été évaluées en prise unique
quotidienne : (1) : dans la famille des « ultra-LABA »
(Long-Acting Bêta-Agonists), l’indacatérol paraît
supérieur au placebo et au formotérol, mais pas au
tiotropium, en terme de gain sur le VEMS. Comparé
au tiotropium, il semble améliorer la dyspnée
et la qualité de vie, et réduire les exacerbations.
Le congrès 2009 de
l’European Respiratory Society
a été comme chaque année le
temps fort de la pneumologie
Européenne. Il s’est tenu à
Vienne à la mi-septembre
où 18 000 congressistes
étaient présents.
L’ANTADIR a souhaité
communiquer sur ce congrès
par l’entremise d’un groupe
de pneumologues encadré
par le Dr Dan VEALE
Coordonnateur médical
de notre Fédération. Vous
trouverez dans ce numéro
plusieurs articles relatifs
aux progrès réalisés dans
le domaine de la prise
en charge des maladies
respiratoires chroniques.
Que ce groupe soit remercié
de son activité au cours
de ce congrès important
pour notre collectivité.
n°19 - février 2010
1 - BPCO
1.1 - Nouvelles perspectives
dans le traitement
1 - BPCO .............................................................p.1
1.1 - Nouvelles perspectives
dans le traitement ...................................p.1
1.2 - Les comorbidités ....................................p.3
1.3 - La réhabilitation respiratoire ...............p.4
1.4 - Réduction du volume pulmonaire ....p.5
2 - L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE ..........p.7
2.1 - Patient IR et transport aérien ..............p.7
2.2 - La fin de vie du patient IR ...................p.9
2.3 - La kinésithérapie
du patient sous VNI ..............................p.10
3 - ASTHME ET PEDIATRIE ..........................p.11
3.1 - Traitement phénotypique ...................p.11
3.2 - Explorations fonctionnelles ................p.13
4 - AUTRES ENTITES PATHOLOGIQUES . .p.14
4.1 - SAS complexe ........................................p.14
4.2 - HTAP ........................................................p.15
4.3 - DDB ..........................................................p.17
5 - ACTUALITES MEDICALES
ET SCIENTIFIQUES ...................................p.19
5.1 - Ubiopred et Proactive .........................p.19
5.2 - Contrôle du tabac en Europe ...........p.20
5.3 - La grippe ................................................ p.21
Pr Jean-François Muir
Président ANTADIR, Paris

2Inspirer n°19 - février 2010
toutes. En pneumologie, elle est efficace
dans l’asthme allergique, mais inefficace
dans la BPCO, la mucoviscidose, certaines
pneumopathies interstitielles diffuses
et le SDRA, certains asthmes sévères.
La connaissance des mécanismes
cellulaires de la « corticorésistance »,
spécifique de certaines pathologies
inflammatoires, ouvre des voies de
recherches alternatives au développement
de nouveaux anti-inflammatoires.
Dans la BPCO, le stress oxydatif déclenché
par l’exposition à la fumée de tabac
diminue l’expression cellulaire de HDAC2,
une enzyme nécessaire à l’action
intracellulaire des corticoïdes. L’inactivation
de HDAC2 résulte d’une nitration, cible
possible d’agents pharmacologiques.
La théophylline à faible dose restaure l’effet
anti-inflammatoire des corticoïdes chez
la souris exposée à la fumée de cigarettes,
mais aussi chez le patient BPCO, sans
doute via un médiateur intermédiaire entre
les ERO et HDAC2. Des essais cliniques
contrôlés sont nécessaires pour confirmer
l’effet de la théophylline à faibles doses
sur l’efficacité des corticoïdes en pratique
clinique à long terme.
TRAITER LA MALADIE
GENERALE :
La BPCO est associée à de nombreuses
comorbidités cardio-vasculaires,
métaboliques, musculaires, ostéo-
articulaires…. avec lesquelles elle partage
un mécanisme physiopathologique
commun : la réaction inflammatoire,
secondaire au tabagisme. Elle s’intègre
dans une maladie générale, « syndrome
inflammatoire systémique chronique »,
qui nécessite une approche thérapeutique
globale. La réhabilitation respiratoire
répond partiellement à cette exigence,
en proposant à travers ses composantes
pluridisciplinaires, une prise en charge
globale, du facteur causal au
retentissement général de la maladie.
Reste à y intégrer les traitements
médicamenteux, jusqu’à présent
recommandés selon des règles définies
parallèlement par discipline et par organe.
Une révision transversale des
recommandations permettrait d’optimiser
la place et les modalités des médicaments
communs à plusieurs comorbidités,
au premier rang desquels les anti-
inflammatoires.
Le carmotérol est plus efficace que le
salmétérol quelle que soit la dose utilisée,
avec une bonne tolérance. D’autres
molécules sont en cours d’évaluation, avec
des résultats préliminaires encourageants
(GSK 642444, B11744, PF00610355). (2) :
des nouveaux anticholinergiques, le
glycopyronium, l’aclidinium, s’avèrent
plus efficaces que le tiotropium, pour les
mêmes effets indésirables de classe. (3) :
Des molécules « bipotentes », agissant
par les modes d’action bêta-agoniste et
anticholinergique, sont en développement.
Plusieurs travaux testent les associations
de plusieurs molécules de modes d’action
différents : ultra-LABA/corticoïdes inhalés,
formotérol/mometasone, formoterol/
ciclasonide, indacatérol/mometasone,
carmoté-rol/mométasone, voire ultra-
LABA/anticholinergique de longue durée
d’action +/- corticoïdes inhalés, ou
associés à un anti-inflammatoire non
corticoïde …A suivre.
DEVELOPPER DE NOUVEAUX
ANTI-INFLAMMATOIRES :
La réaction inflammatoire bronchique au
cœur de la pathogénèse de la BPCO,
implique plusieurs populations cellulaires
productrices de nombreuses enzymes,
cytokines (CK), espèces réactives de
l’oxygène (ERO)…autant de cibles
thérapeutiques potentielles.
Plusieurs molécules candidates (anti-IL8,
anti-TNF, anti-NF-B, N-acétyl et
carbocystéine), ont été testées, avec des
résultats décevants, expliqués par leur cible
trop limitée par rapport à la multitude de
médiateurs pro-inflammatoires impliqués.
A la différence de celles-ci, les inhibiteurs
des phospho-diestérases (PDI3/4I)
agissent sur plusieurs populations
cellulaires pour bloquer le processus
inflammatoire à plusieurs niveaux
simultanément, avec des effets cliniques
démontrés : augmentation du VEMS,
diminution des exacerbations. Des
molécules plus conventionnelles comme
la théophylline à faible posologie,
et certains macrolides, font l’objet d’un
regain d’intérêt pour leurs propriétés
anti-inflammatoires connues. Leur intérêt
et leur place parmi les molécules en voie
de développement doivent être précisés.
VAINCRE LA
CORTICORESISTANCE :
La corticothérapie est le traitement
de référence de nombreuses maladies
inflammatoires chroniques, mais pas pour

3
Inspirer n°19 - février 2010
Américain, afin d’évaluer le poids de la
comorbidité sur la mortalité lors d’études
longitudinales de cohortes [Charlson ME
et al. A new method of classifying
prognostic comorbidity in longitudinal
studies : Development and validation. J
Chron Dis 1987;40(5):373-383]. Il est
considéré comme un index simple, rapide
(5 min) et valide, bénéficiant d’une bonne
fiabilité interjuges et d’une bonne
reproductibilité au test-retest.
Cet index prend en compte l’âge et
19 comorbidités. Il se calcule en attribuant
des points en fonction de la gravité des
diagnostics secondaires : plus la
comorbidité est lourde, plus grand est
le risque de décès, plus élevé est l’indice.
Cet index étant pondéré par l’âge,
il convient d’ajouter au score total 1 point
par décennie quand l’âge est ≥ 50 ans.
Dans leur article princeps, les auteurs
ont utilisé l’index sur une cohorte de
559 patients et montré que les taux de
mortalité à 1 an étaient de 12 % pour un
score de 0, de 26 % pour un score de
1-2/, de 52 % pour un score 3-4 et de 85
% pour un score ≥ 5.
Pourquoi évaluer les
comorbidités dans la BPCO ?
Différentes études présentées lors de
ce congrès ont clairement montré que
les comorbidités aggravent l’évolution
naturelle de la BPCO, multiplient les
risques d’hospitalisation et de mortalité,
augmentent les coûts de santé et altèrent
profondément la qualité de vie des
patients. Une étude (E 503) a évalué
la qualité de vie (Saint George Respiratory
Questionnaire et Clinical COPD
Questionnaire) et les comorbidités (Index
Le spectre des comorbidités
dans la BPCO :
Il s’étend de l’anémie au cancer
du poumon en passant par l’ensemble
des pathologies cardiovasculaires,
l’ostéoporose, le diabète, le syndrome
métabolique, l’amyotrophie périphérique,
la sédentarité, l’hypertension pulmonaire,
les reflux gastro-oesophagiens,
la dépression, l’anxiété et les troubles
du sommeil. Encore aujourd’hui,
la prévalence de chacune est difficile
à chiffrer en raison de l’hétérogénéité
des études et des populations. A titre
d’exemple, l’une des communications
(E. 446) s’est intéressée à la prévalence
de ces comorbidités, en s’appuyant sur
une base de données constituée par le
Collège Italien des praticiens, représentants
341 329 sujets de plus de 45 ans soit
1,5 % de la population suivie par des
généralistes. Dans cette cohorte,
la prévalence de la BPCO était de 4,4%,
augmentant de façon significative avec
l’âge. Les résultats de cette étude
rétrospective montrent qu’en comparaison
à la population générale (non-BPCO),
les patients BPCO ont un risque
significativement plus important
de développer des pathologies
cardiovasculaires telles que les maladies
cardiaques ischémiques (6,9 % versus
13,6 %), les arythmies cardiaques (6,6 %
versus 15,9 %), l’insuffisance cardiaque
(2% versus 7,9 %) et les autres formes de
pathologies cardiaques (10,7 % versus
23 %). Ils présentent aussi un risque
significativement plus élevé de dépression
(29,1 % versus 41,6), de diabète (10,5 %
versus 18,7 %), d’ostéoporose (10,8 versus
14,8) et de cancer du poumon (0,4 %
versus 1,9 %). D’autres études, basées
elles aussi sur de larges cohortes de
patients, ont rapporté des chiffres différents
avec notamment une prévalence du
cancer du poumon estimée entre 9 et
20 %, celle de la dépression estimée entre
20 et 80 %, celle de l’anémie entre 15
et 30 %, celle du syndrome métabolique
à 38 %, celle de l’ostéoporose entre 9 et
75 %, celle des insuffisances cardiaques
entre 20 et 30 %....
Quel que soit le chiffre rapporté,
ce congrès n’a laissé planer aucun doute
sur le fait que la BPCO était un véritable
facteur de comorbidités ! Récemment,
Bartholome Celli a coécrit une revue
générale de la littérature qui apporte
de véritables éléments de réponse
sur la prévalence et les mécanismes
physiopathologiques de ces comorbidités
et ouvre certaines perspectives
thérapeutiques dans ce domaine (Barnes
et Celli, Systemic manifestations and
comorbidities of COPD, Eur Respir J, 200 ;
33 : 1165-1185).
Comment évaluer les
comorbidités dans la BPCO ?
L’analyse de la sévérité de la maladie
initiale et des comorbidités associées
est indispensable pour réaliser des études
de survie ou comparer des méthodes
de traitement chez des populations très
hétérogènes. La seule présence ou
absence d’une comorbidité ne permet
pas une stratification correcte du risque.
Bien que différents outils d’évaluation
soient disponibles, l’index de Charlson
est actuellement le plus utilisé en pratique
clinique et en recherche. Il a été créé en
1987 par M. Charlson, épidémiologiste
Les comorbidités dans la BPCO
1.2 - Les comorbidités
Aujourd’hui, la communauté scientifique s’accorde sur le paradigme selon lequel la BPCO ne peut
plus être considérée comme une maladie seulement pulmonaire. Lors de ce congrès, l’accent a été mis
sur l’importance des comorbidités associées à cette pathologie. Quel est le spectre et la prévalence
des comorbidités dans la BPCO ? Comment les évaluer ? Quel est leur impact sur l’évolution naturelle
de la maladie ? Ce sont autant de questions auxquelles les experts ont tenté de répondre au travers
de nombreux symposia, posters ou communications.
Annabelle COUILLARD – ANTADIR, Paris

4Inspirer n°19 - février 2010
bidité ! L’avenir nous dira peut-être que
les comorbidités doivent être intégrées
dans l’évaluation de la sévérité de la
BPCO… pourquoi pas dans le BODE
index ! Enfin, il a aussi été souligné que le
recours aux soins (consultations externes,
hospitalisations et prescriptions) est aussi
beaucoup plus fréquent pour les patients
ayant une ou plusieurs comorbidités.
On estime qu’environ 50 % des coûts
en rapport avec la BPCO sont dus aux
comorbidités.
Les comorbidités sont un nouvel enjeu
médical et thérapeutique dans la BPCO.
Elles constituent un élément
incontournable par leur fréquence élevée
et leur impact considérable sur la qualité
de vie et le pronostic vital des patients.
Une prise en charge thérapeutique
intégrant les différentes pathologies
présentes chez un même patient pourrait
améliorer l’histoire naturelle de la BPCO.
En pratique, la présence d’une BPCO
doit faire évoquer, chercher et traiter
les comorbidités… et réciproquement !
de Charlson et Chronic Disease Score)
chez 158 patients BPCO, séparés en 2
groupes selon leur âge (> ou < à 65 ans).
Comparativement au groupe plus jeune,
les patients de plus de 65 ans ont un score
significativement plus important de
comorbidités (Charlson index: 2 ±1,3
versus 2,8 ±1,3; p<0,001) ; de même
qu’une altération significativement plus
importante de la qualité de vie (SGRQ :
59,4±11,6 versus 68,6 ±12,8 ; p<0,001).
Dans cette étude, il existe une relation
étroite entre le nombre de comorbidités
et l’altération de la qualité de vie (r=0,27 ;
p<0,01) chez les patients de plus de 65
ans, qui n’existe pas chez les plus jeunes.
Deux études (E 3292 et P3441) ont
clairement montré que les patients BPCO
qui ont le nombre de comorbidités le plus
élevé sont ceux qui ont les scores de BODE
index les plus élevés, donc le niveau
de sévérité de la maladie « générale ou
systémique » le plus important. Dans une
très belle étude publiée dans l’European
Respiratory Journal en 2008, Mannino D
et al. ont analysé sur 20 296 sujets de plus
de 45 ans la relation entre la sévérité
de l’obstruction bronchique, la présence
de comorbidités (diabète, pathologies
cardiaques ou hypertension), les
hospitalisations et la mortalité à 5 ans. Les
résultats montrent qu’indépendamment
de l’âge, du sexe, du tabagisme, de l’indice
de masse corporelle ou du niveau social,
la présence d’une obstruction bronchique
de stade 3 ou 4 augmente de façon
significative les risques d’avoir du diabète
(odds ratio (OR) : 1,5 ; 95 % intervalle de
confiance (IC) : 1,1-1,9), des pathologies
cardiovasculaires (OR : 2,4; 95 % IC :
1,9- 3) ou de l’hypertension (OR : 1,6 ;
95 % IC : 1,3- 1,9). Dans cette population
BPCO sévère et très sévère, la présence de
l’une ou plusieurs de ces 3 comorbidités
(essentiellement le diabète et/ou les
pathologies cardiaques) multiplie les
risques d’hospitalisation et de décès à
5 ans. Par exemple, un patient BPCO de
stade 3 ou 4 présentant 3 comorbidités a
un risque de décès à 5 ans qui est 20 fois
plus important que celui d’un sujet sans
obstruction bronchique et sans comor-
à partir de questionnaires. L’impact de
8 semaines de réhabilitation respiratoire
sur le niveau d’AE de 15 patients BPCO,
a été comparé à celui observé chez
14 sujets contrôles. Les scores d’AE
s’améliorent de 20 % dans le groupe
réentraîné, en corrélation avec les
bénéfices observés sur la dyspnée,
les indicateurs de qualité de vie
et la distance au test de marche.
Impact psychologique
dans la BPCO :
Dans l’un des posters de cette session,
l’impact de la RR sur différents scores
de dépression et d’anxiété a été comparé
entre deux groupes de patients
différenciés par la sévérité de la BPCO
(stades GOLD I-II vs III-IV). Les scores
s’améliorent dans des proportions
comparables dans les 2 groupes,
confirmant que l’impact psychologique
de la réhabilitation est indépendant
de la sévérité de la maladie à l’état de
base. L’auto-efficacité (AE) est la croyance
d’un sujet dans sa capacité à accomplir
une tâche ou atteindre un but. Le niveau
d’auto-efficacité influence le
comportement du sujet, en particulier
en situation de difficulté ou de stress.
Il peut se mesurer par des scores établis
Elargir le champs d’application
et les bénéfices de la réhabilitation
respiratoire (session posters 65)
1.3 - La réhabilitation respiratoire
La réhabilitation respiratoire (RR) a démontré son intérêt clinique et fonctionnel dans la BPCO.
D’autres bénéfices, en particulier psychologiques, plus difficiles à mesurer, sont évalués. Au-delà
de la BPCO, les équipes explorent d’autres indications et recherchent comment maintenir les acquis.
Dr. Anne GUILLAUMOT – AGEVIE Lorraine, Nancy

5
Inspirer n°19 - février 2010
Elargir le champ d’application :
Dans la BPCO, la RR est bénéfique quel
que soit le stade de sévérité de la maladie.
Les travaux ont montré que le
réentraînement à l’effort, préféren-
tiellement proposé aux patients alléguant
une dyspnée d’effort responsable d’un
handicap et d’une réduction des activités
physiques quotidiennes (stade mMRC 3 et
plus), a le même impact chez les patients
moins sévères (dyspnée d’effort stade
mMRC2), sur la dyspnée, la capacité à
l’effort, l’anxiété et la dépression. Des
bénéfices comparables sont aussi observés
chez des patients plus sévères, insuffisants
respiratoires, (dyspnée, BODE, MRC,
qualité de vie), avec hypertension
pulmonaire (TM6, dyspnée).
Cette session a aussi montré que la RR
peut aussi être appliquée à d’autres
maladies respiratoires chroniques. Chez
18 patients atteints de bronchectasies,
freins les complications de la maladie
(exacerbations), les comorbidités, la peur,
le manque de soutien et l’environnement.
Les facteurs de motivation ont été étudiés
aussi par des « focus groups » de patients
pour définir le patient motivé modèle :
une personne indépendante, positive,
ayant une bonne estime de soi et un
sentiment fort d’auto-efficacité. Des
facteurs extérieurs comme le soutien
des professionnels de santé, les conditions
météorologiques, la confiance dans
la réhabilitation, renforcent la motivation.
Enfin, le maintien de séances régulières
de réentraînement supervisé pendant
l’année qui suit un stage initial de
8 semaines consolide les bénéfices sur
la dyspnée, les scores de qualité de vie
et d’anxiété-dépression, pour 67 patients
vs un groupe contrôle de 53 patients
non revus après la période initiale.
la RR améliore les paramètres fonctionnels,
mais n’a pas démontré d’impact significatif
sur les exacerbations et l’hématose. Seize
patients atteints de sarcoïdose bénéficient
également d’un programme de RR de
8 semaines, avec une amélioration
significative de la distance au test de
marche de 6 minutes, de la force
musculaire des muscles respiratoires
et périphériques, de la dyspnée, de la
fatigue musculaire et de la qualité de vie.
Maintenir les acquis :
6 patients ayant bénéficié de RR réunis en
« focus group » rendent une image positive
de cette expérience, malgré la fatigue
souvent alléguée. Les éléments cités par
les patients comme « facilitateurs » sont les
encouragements, la compagnie, le soutien
professionnel, la formulation d’objectifs,
la diversité des activités physiques.
En revanche, ils identifient comme
Trois techniques
sont en cours d’étude.
Valves endobronchiques.
Elles sont introduites dans les voies
aériennes proximales à travers un
fibroscope ou un bronchoscope grâce
Le premier est composé de matériaux
biocompatibles et de plus en plus
« simples » à mettre en place et à déplacer.
Il possède une armature extérieure
métallique, une partie centrale qui contient
un système anti-reflux (système ZEPHIR).
Il est celui qui a été le plus étudié
à un cathéter ou un fil guide. Elles ont pour
but de bloquer le passage de l’air lors de
l’inspiration tout en permettant sa sortie
lors de l’expiration. Il se produit alors une
atélectasie et ainsi une réduction du
volume pulmonaire emphysémateux.
Deux systèmes sont en cours d’étude.
Réduction du volume pulmonaire
par voie endoscopique
1.4 - Réduction du volume pulmonaire
Dr. Thomas EGENOD – ALAIR & AVD, Limoges
L’enthousiasme pour ces techniques provient des réalités rencontrées face aux techniques chirurgicales
puisque celles-ci sont liées à une comorbidité importante dans 59 % des cas soit par détresse
respiratoire aiguë (22 %), pneumopathie (18 %), arythmies cardiaques (24 %) ou ischémie myocardique
(1 %). Les premières cohortes étudiant cette méthode thérapeutique datent de 1994. Réduire la taille
des lésions emphysémateuses produit de l’espace dans la cavité thoracique afin que le poumon restant
le remplace lors de l’inspiration. Ce principe évoqué pour la première fois dans les années 50 explique
l’intérêt de cette chirurgie afin d’augmenter la fonction respiratoire (VEMS, aptitude à l’exercice) et
donc la qualité de vie de nos patients même si cela n’agit pas sur leur survie. Les techniques
endoscopiques semblent liées à une moindre mortalité puisqu’elle est restée inférieure
à 10 % dans de nombreuses études. Son développement pourrait également présenter des effets
bénéfiques potentiels comme autoriser ce traitement à des patients présentant des contre-indications
opératoires, éviter les complications péridiaphragmatiques source de restriction des mouvements
du diaphragme.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%