vieprofessionnelle - John Libbey Eurotext

DOI : 10.1684/med.2011.0677
VIE PROFESSIONNELLE
Jérôme Porée
Université de Rennes 1
Mots clés :
anthropologie,
santé, sociologie
Médecine et sciences humaines
Dans la première partie de cet article, je faisais du désir –et non du besoin –le principe
premier des attentes de santé et tenais pour obscur l’objet de ce désir. C’est dans le
même sens qu’il sera question, dans cette seconde partie, du lieu caché de la santé.
Or le désir ne s’enracine pas seulement dans l’histoire singulière du patient, il dépend
encore de ses représentations de la maladie et de la santé. Je m’arrêterai donc, dans
un premier temps, sur ces représentations ou plutôt sur les utopies qui orientent, en
la matière, notre horizon d’attente. J’ai évoqué, en commençant, l’utopie de la santé
parfaite. Il en est cependant une autre. On est frappé en effet de l’opposition, au-
jourd’hui, entre deux espèces d'attentes : celle d’une médecine naturelle et atechnique
à laquelle suffirait la connaissance intime, par l’individu, de son propre corps –chacun
pouvant être dans ce cas son propre médecin ; et celle de techniques médicales tou-
jours plus performantes au service d’un corps-machine abandonné entre les mains des
spécialistes. Je supposerai que ces deux attentes, malgré leur opposition, ne sont pas
sans lien entre elles, et correspondent à deux utopies concurrentes mais complices.
C’est contre celles-ci que je parlerai, dans un deuxième temps, du lieu caché de la
santé, et que je poserai à nouveaux frais la question de l’évaluation appliquée à la fois
aux attentes du patient et à l’efficacité du traitement.
L'obscur objet du désir
et le lieu caché de la santé
Deuxième partie : le lieu caché
de la santé
«Grande santé »et «santé
parfaite »: deux utopies
concurrentes
mais complices
L’une est l’utopie nietzschéenne de la « grande santé »,
l’autre l’utopie technicienne de la « santé parfaite ».
«Grande santé », ou la fiction
du «surhomme »
La première utopie se confond avec la fiction du « sur-
homme », développée par Nietzsche dans divers
écrits. La lecture du § 120 du Gai savoir permet de la
ramener à trois thèses complémentaires :
– première thèse : il n’y a pas de santé en soi ; car il
faudrait pour cela qu’il y ait un corps en soi ; or un tel
corps n’existe pas ; il ne serait, en effet, le corps de
personne ; seul existe le corps qu’un individu peut
identifier et s’approprier comme sien ; il n’y a donc
pas une mais d’« innombrables santés du corps » ;
– deuxième thèse : relative à l’individu dans ce qu’il a
de « singulier » et d’« incomparable », la santé l’est
par là même à sa propre puissance d’exister, autre-
ment dit à son désir, au sens général que Spinoza
donne à ce terme ;
– troisième thèse : la santé ainsi définie inclut la ma-
ladie ; elle ne peut donc aller jusqu’à ce qui serait la
santé parfaite ; vouloir celle-ci, c’est là justement, aux
yeux du surhomme, la plus grande maladie ; son atti-
tude à l’égard des pathologies répertoriées par la
science médicale n’est pas autre alors que celle qu’il
136 MÉDECINE mars 2011
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

affirme à l’égard de la souffrance, qui constitue pour lui
l’épreuve décisive.
Trois traits caractérisent cette attitude :
Le premier est la force de la volonté. Devant la souffrance,
en effet, deux attitudes sont possibles, qui consistent, l’une
à s’en plaindre, l’autre à la vouloir « encore plus profonde ».
Or cette volonté seule est accordée à la vie réelle. Cette
attitude seule par conséquent est sage. Elle prouve la vitalité
du vivant et son aptitude à tirer des pires expériences des
forces nouvelles.
Telle est – deuxième trait – la dynamique de l’affirmation.La
souffrance même du surhomme fortifie sa volonté. Souffrir
plus est vouloir plus ; et vouloir plus est vivre plus – c’est-
à-dire « croître », « monter », « gagner en puissance ». La dé-
couverte de la « volonté de puissance » est précisément
celle de cette loi de croissance exponentielle. Il appartient à
chaque vivant de la faire sienne en inventant une manière de
vivre appropriée.
Faut-il ajouter que le surhomme n’a, pour cela, besoin de
personne ? Sa liberté l’exige. Elle se confond pour lui avec –
troisième et dernier trait – l’indépendance. C’est lui seul, en
effet, qui oppose la puissance à l’impuissance, lui seul qui
transforme ses défaites en victoires, lui seul enfin qui se pro-
pulse en avant et se rit de tout.
Tout autre est l'homme de la seconde utopie
Il va de soi, pour lui, que la souffrance est un mal. La vie
bonne, c’est la vie sans souffrance. C’est donc aussi la vie
sans la vieillesse et sans les maladies. Que désirer d’autre,
si la vie est elle-même la seule valeur ? Une chose, pourtant :
la vie sans fin. On est au plus loin alors de l’exigence haute-
ment spirituelle qui anime la doctrine nietzschéenne de la
volonté de puissance. Au rire du surhomme et à la force
intérieure de sa volonté succèdent la peur de mourir et la
hantise des agressions extérieures. Et si c’est symbolique-
ment que le premier, « à l’heure de midi », hume l’air pur des
montagnes [1], c’est réellement que celui dont je parle craint
la pollution, la fumée, les toxines, le cholestérol et les mau-
vais gènes. Bien respirer, bien manger, bien dormir, telles
sont les nouvelles voies du salut. Elles ne portent pas par
hasard le nom de certaines fonctions biologiques. Car le salut
est conçu lui-même alors comme l’optimisation de ces fonc-
tions. Il est le salut du corps préalablement réduit à l’orga-
nisme. Ajoutons cependant qu’à l’optimisation des fonctions
de l’organisme, l’organisme lui-même ne suffit pas. Il a
besoin pour cela d’une médecine plus puissante qu’il ne l’est
lui-même. Telle est justement la nouvelle médecine scienti-
fique et technique. Elle seule dispose de la puissance. Elle
seule donc lui permet de tendre vers sa propre perfection.
L’ouvrage que Lucien Sfez a consacré à cette nouvelle utopie
[2] s’ouvre sur la fiction de Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève fu-
ture, publiée en 1886. Cette fiction raconte la fabrication, par
un certain Edison, du double rêvé d’une femme réduite par
la grâce de la technique à une poupée insensible et parfaite-
ment idiote. Toujours souriante, toujours jeune, toujours
belle, elle ne sait rien du trouble de penser et de la peine de
vivre. La nouvelle Ève suppose, bien sûr, un nouvel Adam.
Elle suppose donc un homme prêt, lui aussi, à échanger sa
liberté contre la sécurité, et son esprit inquiet contre un corps
parfait. Fiction sans doute mais fiction réelle puisque, d’une
part, elle correspond à la conception dominante dans nos
sociétés, et que, d’autre part, elle dispose désormais des
moyens que la science et la technique mettent à notre dis-
position. Voilà précisément l’homme dont nous parlons : un
vivant qui se veut seulement vivant et qui atteint sa propre
perfection grâce à l’artifice de la science et de la technique
biomédicales. On en a un bon exemple avec la médecine
prédictive puisqu’elle a pour but de supprimer, avant même
leur apparition, toutes les maladies susceptibles de contrarier
cet idéal. Sfez évoque à ce propos une femme de la bour-
geoisie intellectuelle de Berkeley qui lui annonce un jour
qu’elle vient, à titre préventif, de se faire enlever les ovaires.
Stupéfaction de notre auteur : « jamais un chirurgien français
n’aurait fait cela ! »1.« Tout de même », réplique-t-elle, «il
m’a fallu négocier avec les médecins : ils m’ont fait promet-
tre que, s’ils m’enlevaient les ovaires, je ne supprimerais pas
ensuite les seins ».
Il est surprenant alors que Sfez, quelques pages plus loin,
assimile la santé parfaite à la « grande santé » du surhomme.
C’est un contresens manifeste. S’il s’agit, justement, de la
prédiction, qui est peut-être le trait le plus caractéristique de
l’utopie de la santé parfaite, il n’est qu’à lire par contraste le
§ 287 du Gai savoir :« mes pensées doivent m’indiquer où
j’en suis : non me révéler où je vais ; j’aime l’ignorance de
l’avenir et ne veux succomber à l’impatience ni à la saveur
anticipée des choses promises ». L’avenir, programmé, n’est
plus l’avenir. Calculable et prévisible, il ressemble au passé.
L’homme qui désire cet avenir est donc plus mort que vif.
1. La scène se passe en 1990, donc il y a plus de vingt ans...
137
mars 2011MÉDECINE
VIE PROFESSIONNELLE
Médecine et sciences humaines
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Ce qu’il désire au fond, c’est la santé sans la maladie, la
jouissance sans la souffrance, la jeunesse sans la vieillesse
et sans la mort. C’est donc une vie préservée de toutes les
contradictions qui réellement la constituent. Comment s’en
étonner, à une époque où la santé est définie officiellement
comme un état complet de bien-être physique, mental et
social ? Cette seule définition eût amené Nietzsche à tenir
l’utopie de la santé parfaite pour la forme achevée du nihi-
lisme.
Aussi peut-on opposer trait pour trait cette nouvelle utopie à
l’utopie nietzschéenne de la grande santé : à la volonté du
surhomme, s’oppose la production technique d’une surna-
ture ; à la dynamique individuelle de l’affirmation, s’opposent
les dispositifs anonymes de la biomédecine ; à l’indépen-
dance enfin s’oppose une dépendance double : à l’égard de
ces mêmes dispositifs d’une part, à l’égard de la société
conçue elle-même comme un grand organisme protecteur
d’autre part.
Et pourtant cette opposition n’empêche pas, je l’ai dit, une
complicité profonde. Ces deux utopies, en effet, conçoivent
un homme invulnérable ; et toutes deux méconnaissent la
dimension intersubjective la vie humaine. Ce sont, ici et là,
un même déni de finitude et un même oubli de l’altérité qui
soutient notre désir d’être.
C’est en un tout autre sens que je dirai un mot pour terminer
du lieu caché de la santé. Il n’y a pas seulement, en effet, la
démesure ; il n’y a pas seulement la pathologie du désir. Il y
a encore, il y a d’abord le désir compris, ainsi qu’il doit l’être,
comme la mesure intérieure d’un homme.
Le lieu caché de la santé
J’emprunte cette expression : « le lieu caché de la santé »,
à Gadamer, l’un des plus importants penseurs contempo-
rains – même s’il reste peu connu du grand public2. La phi-
losophie de la santé de Gadamer se présente comme une
apologie de l’« art médical », par contraste avec les préten-
tions d’une médecine purement scientifique. C’est pour une
telle philosophie que le lieu de la santé reste un « lieu ca-
ché ». La formule signifie d’abord que la santé, à la différence
de la maladie, n’a pas conscience d’elle-même : sa grâce est
de s’oublier. On pense alors à la définition qu’en donne Bi-
chat : « la vie dans le silence des organes ». Mais Gadamer,
grand lecteur des Anciens, cite un fragment d’Héraclite :
« harmonie latente est plus forte qu’apparente »3. Cette har-
monie, en effet, n’est pas seulement enracinée dans les pro-
fondeurs de notre personne, elle est riche encore de poten-
tialités qui fondent notre confiance en l’avenir et que nous
réalisons d’autant mieux que nous n’y pensons pas. Un autre
fragment d’Héraclite ajoute, à la notion d’harmonie, celle
d’équilibre – entendu comme équilibre de forces contraires4.
Or ces deux notions, selon Gadamer, qui rappelle l’impor-
tance qu’elles avaient aussi pour Hippocrate, définissent po-
sitivement la santé5. Aussi formule-t-il à partir d’elles quatre
remarques que je résume grossièrement et qui intéressent
à plusieurs titres notre problème.
Quelle mesure de la santé ?
Première remarque : l’équilibre qui définit la santé est un
équilibre dynamique ; on peut le comparer à l’équilibre qu’on
a sur un vélo6; c’est, par là même, un équilibre qu’il appar-
tient à chacun de trouver ; Nietzsche le dit à sa façon et il y
a ici, même si c’est le seul, un point d’accord : la santé est
individuelle ; elle ne peut être ramenée, sans abstraction, à
une norme établie à partir de valeurs moyennes.
Deuxième remarque : la santé, bien qu’individuelle, englobe
l’ensemble des rapports qui unissent l’individu, envisagé
comme un tout, à la situation dont il fait partie ; l’homme ne
peut atteindre son état d’équilibre que si l’harmonie règne
non seulement dans son corps et dans son âme, mais encore
entre lui-même et le monde qu’il habite7; cela permet de
comprendre, par contraste, l’expérience qu’il fait dans la ma-
ladie : celle non d’une défaillance mais d’une déchéance8;la
perte de l’équilibre n’est pas seulement, en effet, « un fait
biologique » : c’est encore « un événement biographique » ;
le malade, ainsi, « n’est plus l’homme qu’il était » : « il choit,
2. Gadamer est un représentant de la philosophie herméneutique, qui prit son
essor en Allemagne sous l’impulsion de Schleiermacher, de Dilthey puis de
Heidegger. L’herméneutique fut d’abord l’art d’interpréter les textes, au pre-
mier rang desquels les textes juridiques et religieux. En ce sens, elle resta
longtemps une discipline proche de l’exégèse. Mais la vie et le monde hu-
mains peuvent être conçus eux-mêmes, par analogie, comme des textes à
déchiffrer. C’est ce que pense Gadamer, qui oppose en ce sens la méthode
« compréhensive » des sciences de l’homme à la méthode « explicative » des
sciences de la nature. Or, tout texte, nous le savons, s’offre à plusieurs lec-
tures ; et toute compréhension implique un risque de compréhension erro-
née ; de là justement la nécessité de règles d’interprétation bien définies.
L’interprétation s’impose partout où manque la lumière de l’évidence. C’est
elle que j’avais en vue en parlant, après Platon et Freud, de l’obscur objet du
désir. On peut supposer que l’interprétation n’est étrangère à aucune des
disciplines médicales – à l’exception peut-être de la chirurgie, c’est-à-dire de
la plus technique d’entre elles. La médecine, sans doute, occupe une situation
singulière : d’un côté, elle se rattache à la biologie et partage donc quelque
chose de la méthode explicative des sciences de la nature, qui tient tout phé-
nomène pour l’effet d’une causalité extérieure ; d’un autre côté, elle s’adresse
à un être dont la vie n’est pas celle de la plante ou de l’animal, mais d’une
personne dont les états ont une signification interne et demandent à être
compris comme tels. Mais il n’est pas impossible d’intégrer l’explication à la
compréhension. C’est ce que montrent, sur le plan éthique, l’« information »
et la recherche du « consentement éclairé » du patient. Sur ce plan, toutefois,
la compréhension reste étrangère au processus thérapeutique. Or on pourrait
se demander, en faisant un pas de plus, si elle n’a pas part elle-même à ce
processus. Sans doute faudrait-il alors mettre en avant la fonction du récit
– fonction partagée, au cours de la consultation médicale, par le médecin et
par son patient, et qui permet à ce dernier de s’approprier le sens de sa ma-
ladie. C’est ce qu’ont fait, à l’Université de Columbia, les promoteurs de la
narrative-based medicine. Opposée à l’evidence-based medicine, entièrement
fondée sur l’explication, la narrative-based medicine donne la primauté à la
compréhension, à laquelle elle attribue une efficacité propre.
Je n’évoque la narrative-based medicine que parce qu’elle me paraît s’accorder
avec l’esprit de la philosophie de Gadamer, qui subordonne l’explication par
les causes à la compréhension du sens. Il a cependant peu parlé de la méde-
cine. Sa réflexion sur ce thème se résume à quelques articles réunis dans un
ouvrage paru en langue française sous le titre Philosophie de la santé (Paris,
Grasset-Mollat, 1998).
3. Fragment 54 dans l’édition M. Conche. Paris : PUF ; 1986.
4. « Harmonie qui se retourne sur elle-même, comme l’arc et la lyre : équilibre
de forces contraires. »
5. Il faudrait y ajouter la notion de « rythme ».
6. Op. cit., p. 123.
7. Ibid., p. 52. On peut parler en ce sens d’une conception holiste de la santé.
8. Ibid., p. 66-67.
138 MÉDECINE mars 2011
VIE PROFESSIONNELLE
Médecine et sciences humaines
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

il est expulsé de son cadre de vie » habituel ; il reste cepen-
dant, même alors, un homme qui aspire à réintégrer ce cadre
de vie et à retrouver l’équilibre qui y était le sien9. La question
qui se pose alors est de savoir comment mesurer cet équi-
libre.
C’est l’objet de la troisième remarque, qui invite à distinguer
entre deux espèces de mesure. Gadamer se fonde ici sur la
différence que fait Platon, dans un texte à vrai dire margi-
nal10, entre metron et metrion.Metron se dit de la mesure
appliquée de l’extérieur à une chose à l’aide d’outils censés
convenir également à toutes, metrion de la mesure inhérente
à la chose même. Si l’une est « entre les mains de la
science », l’autre est entre nos mains11. Les deux, sans
doute, sont nécessaires, mais le médecin, s’il ne peut se
priver de la première, doit la mettre au service de la seconde :
elle ne peut être qu’un moyen auxiliaire pour permettre au
patient de retrouver lui-même son équilibre perturbé par la
maladie.
D’où une quatrième et dernière remarque, relative justement
à l’art médical : d’abord la médecine, on l’a dit, est un art et
non une science ; ensuite cet art se distingue de tous les
autres par le fait qu’il ne fabrique rien ; le mot tékhnè, qui
désigne toutes les activités qui trouvent leur fin dans la pro-
duction d’une œuvre extérieure, ne lui convient que pour une
part ; dans « l’expérience de l’équilibration » que font ensem-
ble le patient et le médecin, écrit Gadamer, « tout l’effort
tend paradoxalement à [...] laisser l’équilibre se mettre en
place de lui-même »12 : le soin contribue à l’autorégulation
de la vie et le rôle du médecin se borne à aider le patient à
se passer de sa personne. Aussi est-ce là, en général, le
principe de toute action médicale : se supprimer soi-même
en s’accomplissant. Tant que l’on tient l’enfant pour l’empê-
cher de tomber de vélo, il ne sait pas faire du vélo.
Mais en quoi consiste, précisément, l’art médical et
comment peut-il répondre aux attentes du patient ?
Comment surtout peut-il discerner, parmi ces attentes, cel-
les qui correspondent à une nécessité réelle ? Je me
contenterai, pour répondre à ces questions, de citer encore
deux propos de Gadamer. Ils pourront sembler triviaux mais
ils permettent d’échapper, au moins dans le principe, au di-
lemme que j’avais formulé en commençant et que renforce
à sa façon l’opposition platonicienne entre metron et me-
trion :ouune mesure objective mais abstraite, le sens que
le malade donne à son état et les perspectives qu’il exprime
étant exclus alors du savoir médical et des propositions thé-
rapeutiques qui en dérivent ; ou une mesure subjective mais
arbitraire – le patient étant supposé alors détenir seul la vérité
sur la maladie et sur son traitement. Hugues Rousset parle,
eu égard au premier terme du dilemme, d’une « médecine
sans malade » [3]. Mais on ne saurait préférer, à cette mé-
decine sans malade, un malade sans médecine.
Gadamer écrit d’abord que rien ne compte autant que
«l’écoute du patient » et il montre l’importance, à cet égard,
de l’interprétation. Car, si écouter est un art (il faut peut-être
le rappeler à ceux qui croient que n’importe qui le peut sans
formation particulière), cet art consiste bien souvent à cher-
cher le sens caché sous le sens apparent. Rappelons-nous
Héraclite : « harmonie latente est plus forte qu’apparente » :
la loi de la santé est aussi celle de l’écoute.
Or l’écoute implique le dialogue et c’est justement l’objet du
second propos, où ce mot reçoit une signification qui n’est
en vérité ni creuse ni convenue. « Le dialogue », écrit Gada-
mer, « détermine la part décisive de l’acte médical et ce, pas
seulement chez le psychiatre ». Il permet, en outre, « d’hu-
maniser une relation entre deux êtres fondamentalement iné-
gaux », comme le sont justement le médecin et son patient.
On doit donc voir en lui l’instance ultime d’évaluation de ce
qui est réellement nécessaire à ce dernier13. C’est une forme
de communication où l’un (le médecin) aide l’autre (le patient)
à trouver sa propre mesure.
Quelle efficacité thérapeutique ?
Mais le dialogue, pour Gadamer, ne permet pas seulement
d’évaluer les besoins du patient, il contribue encore au trai-
tement lui-même. C’est pourquoi il voit en lui la « part déci-
sive » de l’acte médical. On peut se demander alors – et c’est
la question que je voudrais poser pour finir – s’il ne faut pas
réhabiliter certains traitements dont l’efficacité, pour n’être
pas scientifiquement prouvée, n’en est pas moins réelle.
Qu’est-ce, en effet, qu’un traitement efficace ? Selon les cri-
tères en vigueur dans la recherche biomédicale, la seule ef-
ficacité qui compte est une efficacité moyenne de type pro-
babiliste. Mais il n’est pas dit qu’un traitement inefficace
selon ces critères ne soit pas efficace pour un patient donné.
Une étude récente l’a montré pour l’acupuncture contre la
volonté d’un chercheur qui espérait démontrer son ineffica-
cité et qui avait divisé à cette fin un ensemble de patients
souffrant de douleurs chroniques en trois groupes : dans un
groupe, les patients se voyaient appliquer les points d’acu-
puncture prescrits par la médecine chinoise traditionnelle ;
9. Ibid., p. 52-53.
10. Et apparemment étranger à la médecine. Il s’agit d’un passage du Politi-
que où la question est de savoir comment différencier le véritable homme
d’État du simple fonctionnaire.
11. Ibid., p. 109.
12. Ibid., p. 48-49.
13. Je rejoins à ce point la notion de « dialogue constructif » mobilisée dans
le Livre blanc rédigé sous la responsabilité du président du Comité médical
d’une mutuelle de santé, Antoine Rogier. Le constat de départ est le même :
« on n’investit pas [suffisamment] aujourd’hui sur la relation patient-médecin,
sur sa fonction d’échange et d’éducation à la santé, comme levier de l’amé-
lioration de l’usage des soins » (op. cit., p. 41).
139
mars 2011MÉDECINE
VIE PROFESSIONNELLE
Médecine et sciences humaines
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

dans le deuxième, les aiguilles étaient appliquées au hasard ;
dans le troisième enfin, les patients continuaient de recevoir
leur traitement habituel. Or le résultat fut identique pour les
deux premiers groupes – ce qui confirmait, en un sens, les
soupçons du chercheur – mais dans ces deux groupes, un
patient sur deux se déclara durablement soulagé. Dans le
dernier groupe, en revanche, aucun ne le fut [4].
Un traitement irrationnel selon la mesure de la science, n’est
donc pas forcément déraisonnable selon la mesure de la per-
sonne. Et cela n’est pas, faut-il le dire, une défense de l’acu-
puncture, mais une invitation à interroger à nouveaux frais
les notions d’efficacité et de service médical rendu. Ne
peut-on d’ailleurs étendre cette observation à d’autres mé-
decines alternatives ? On peut se demander, dans tous les
cas, ce qu’il faut préférer : une thérapeutique dont l’efficacité
est démontrée mais faible ou une thérapeutique dont l’effi-
cacité est indémontrée mais forte ? À titre de comparaison,
le taux de satisfaction à moyen terme de quelques uns des
antidépresseurs les plus courants est de 2 pour 54 [4].
Cela ne dispense pas, certes, de s’interroger sur ce qui fait
que « ça marche ». La notion d’« efficacité symbolique »,
chère à Lévi-Strauss [5], trouverait sans doute ici sa place.
Une telle efficacité n’a cependant rien de mécanique. Elle
dépend fondamentalement du désir compris comme désir
de l’autre. Plutôt que d’« effet placebo », il vaut donc mieux
parler à son propos d’effet relation. Cet effet n’a rien d’éton-
nant si l’on admet, avec Gadamer, que la consultation est la
modalité essentielle de l’acte médical. Il n’est pas étonnant
non plus qu’il augmente avec la durée. C’est une fleur dans
le jardin de l’homéopathie, lors même qu’on nierait l’effica-
cité spécifique des traitements qui s’en réclament. C’en est
une aussi, s’il s’agit de santé mentale, dans celui de la psy-
chanalyse.
Mais les choses, ainsi dites, sont encore trop simples. « Sim-
plifiez ! Simplifiez ! », entend-on dire partout. « Compliquez !
Compliquez ! », répondent Gadamer et les philosophes de
son école. C’est ce que j’ai essayé de faire, trop longuement
sans doute, pas assez cependant.
Références :
1. Nietszche F. Ainsi parlait Zarathoustra. Paris: Rééditions Livre de Poche.
2. Sfez L. La santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie. Paris: Seuil; 1995.
3. Rousset H. Communication lors du « colloque « Herméneutique et médecine ». Université de Lyon, 22-24 janvier 2009 .
4. Beaussageon R. Polysémie de la notion d’efficacité thérapeutique. In : Introduction à l’herméneutique médicale. Paris : Le Cercle Herméneutique, 2011: 63-71.
5. Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. Paris: Pocket; 2003.
L'obscur objet du désir et le lieu caché de la santé
La médecine est un art et non une science, art distinct de tous les autres par le fait qu’il ne fabrique rien. Le soin contribue à
l’autorégulation de la vie et le rôle du médecin est d’aider le patient à se passer de sa personne. Cela ne dispense pas de
s’interroger sur la notion d’efficacité, mais celle-ci dépend fondamentalement du désir compris comme désir de l’autre. Plutôt
que d’effet placebo, il vaut donc mieux parler à son propos d’effet relation.
The obscure object of desire and the secret places of Health
Medicine is an art, not a science, an art distinct from all others in that it does not produce anything. Care contributes to the
autoregulation of life and the physician’s role is to assist the patient to live without his person. This should not prevent us from
questioning the concept of efficiency, but fundamentally this relies on understanding the desire as the desire of the other.
Rather than a placebo effect, it is better to talk about it as a relationship effect.
Key words: anthropology, health, sociology
140 MÉDECINE mars 2011
VIE PROFESSIONNELLE
Médecine et sciences humaines
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
1
/
5
100%
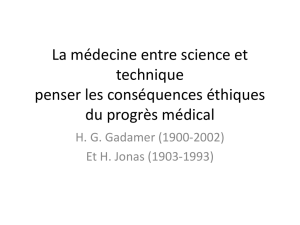
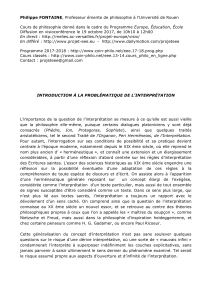
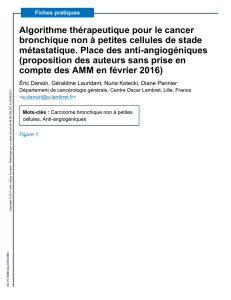

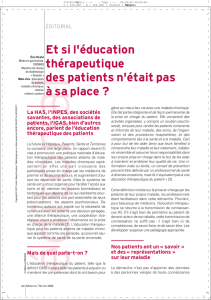
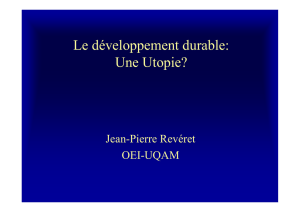

![Un pape philosophe [La Presse, 3 avril 2005] Jean Grondin](http://s1.studylibfr.com/store/data/004602676_1-91381956bcf4047a8f22ff5ea2c9d984-300x300.png)



