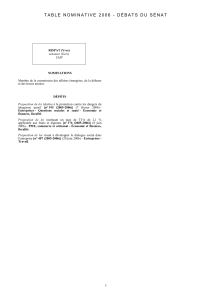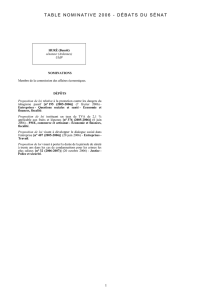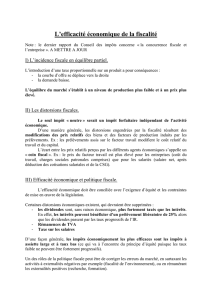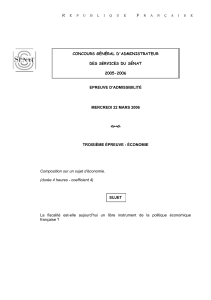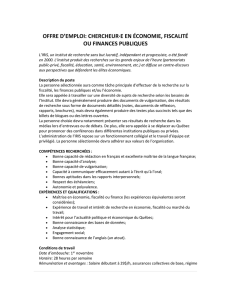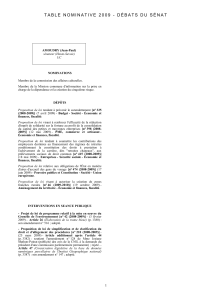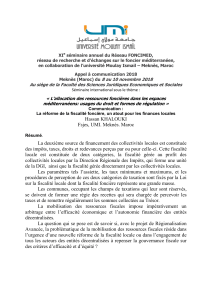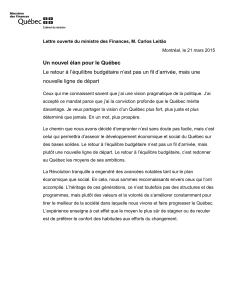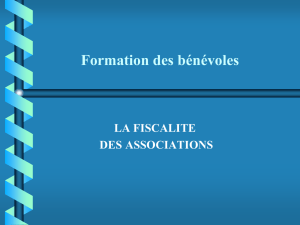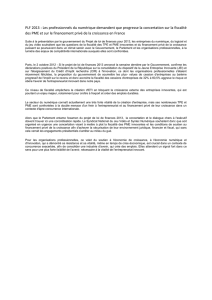POUVOIR D`ACHAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Journée d’échange et de réflexion ConsoFrance du 18 novembre 2010
« Pouvoir d’achat et développement durable »
JOURNÉE D’ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION DU 18 NOVEMBRE 2010
POUVOIR D’ACHAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Valérie GERVAIS, présidente de ConsoFrance et Secrétaire générale de l’AFOC, se félicite au nom des 9
associations de consommateurs qui composent ConsoFrance, d’accueillir les participants à ce colloque consacré
au lien entre développement durable et pouvoir d’achat des ménages.
Pourquoi avoir choisi ce thème ?
ConsoFrance a été créée il y a dix ans pour promouvoir un consumérisme social et environnemental, c'est-à-dire
un consumérisme soucieux à la fois de l’accès de tous les consommateurs à des produits et services de qualité et
de la préservation du cadre de vie commun.
La diversité des champs couverts par les associations membres de ConsoFrance est une grande richesse qui
s’accompagne d’une grande cohérence, s’agissant du modèle de consumérisme social et environnemental
revendiqué au sein de ConsoFrance.
Nos préoccupations ont gagné en pertinence, ces dernières années :
L’environnement : Le développement durable, qui intègre à la fois la dimension sociale et environnementale,
est devenu un sujet majeur pour tous les acteurs. La situation appelle des mesures urgentes concernant le
réchauffement climatique ou encore la biodiversité.
Le social : La société française est devenue de plus en plus inégalitaire. Selon une étude du CREDOC de
mars 2009, une personne sur deux vit en France avec moins de 1 500 € par mois, sachant que les dépenses
incompressibles de l’ensemble des ménages augmentent bien plus vite que leurs revenus. Une personne sur
deux ne part pas en vacances et n’a pas accès à internet à domicile, ce qui creuse le fossé social.
Parallèlement progresse l’idée, selon laquelle, les atteintes à l’environnement doivent être taxées : taxe sur les
billets d’avion, bonus- malus, projet de taxe carbone en constituent quelques illustrations.
Dans un tel contexte économique et social, ConsoFrance souhaite mettre en avant l’enjeu d’un développement
durable pour tous et permettre à chacun de tirer un bénéfice des progrès obtenus.
Mais alors se posent immanquablement des questions :
Comment orienter la production et la consommation de biens et de services pour répondre au défi du
développement durable ?
Comment optimiser du point de vue de l’intérêt collectif la gestion des biens de première nécessité comme
l’eau, l’alimentation, l’énergie, ou le logement ?
Qui va payer les atteintes à l’environnement : les pollueurs, les consommateurs, les contribuables ?
La journée d’aujourd’hui a pour but d’amorcer une réflexion sur cette problématique : en clair, comment aller vers
un développement durable qui profite à tous ?
Pour ce faire, nos travaux vont s’organiser autour de trois tables rondes :
1. De la gestion des déchets à l’éco-conception, comment économiser ?
2. Comment faire bénéficier à tous d’un bien essentiel comme l’énergie ?
3. Fiscalité verte, quel impact sur les inégalités sociales et environnementales ?
Table ronde n°1 : De la gestion des déchets à l’éco-conception, comment économiser ?
Modérateur : Frédéric POLACSEK, membre du CA de ConsoFrance, Cnafal
Intervention de Philippe MOATI, professeur d’économie à l’université de Paris VII, directeur de recherche
Le constat : Le modèle de consommation actuel est basé sur l’aspect quantitatif. Ce modèle est incompatible avec
le long terme. Les ménages sont avides de consommation. La décroissance ne forme pas un mot d’ordre
mobilisateur. Le système économique actuel a pour modèle le capitalisme, la croissance s’impose donc.
Or, l’impératif écologique nous impose aujourd’hui de modifier notre consommation. Le contexte économique de
crise actuel va impliquer une baisse du pouvoir d’achat : politique de rigueur publique et hausse de la fiscalité ;
déprime économique ; augmentation des cotisations sociales sont à prévoir. Les familles les plus modestes seront
les plus touchées.

Page 2/10 Journée d’échange et de réflexion ConsoFrance du 18 novembre 2010
« Pouvoir d’achat et développement durable »
Par ailleurs, les produits vont finir par avoir un seul prix à la suite de l’uniformisation des salaires d’un pays à
l’autre. C’est ce que les économistes désignent par l’égalisation des coûts des facteurs. En France, cette évolution
va conduire à une pression à la baisse des salaires. A cette austérité salariale, s’ajoute le fait que le
développement durable a un coût (traitement des déchets par exemple).
Il faut donc passer d’un modèle basé sur le produit à un modèle basé sur le principe de « l’effet utile ». Quel est
« l’effet utile » attendu de l’eau ? Une eau saine qui ne rende pas malade et qui étanche la soif. Mais quel est son
effet à plus long terme sur la santé ? Fait-elle maigrir ? Quel est son « effet utile » aussi au regard de la société, de
l’environnement ?
La publicité vante déjà « l’effet utile » plutôt que le produit lui-même. Derrière les quantités produites et vendues, il
y a des effets certains qui se répercutent sur les salariés de ces branches d’industrie considérées.
La prime à la casse des voitures se révèle typique de l’économie de la quantité. Pour sortir de ce modèle
économique de la quantité vers la valeur, il y a un passage obligé par la fourniture au consommateur de services.
En termes économiques, on parle de l’économie de la fonctionnalité des biens vers les services. Désormais on
vend un service de mobilité et plus forcément la voiture. Le prestataire reste le propriétaire du produit, il mise sur
sa durabilité. La surconsommation se trouve supprimée, en ligne de mire figure l’économie de ressources. Le
mouvement écologique défend ce modèle avec virulence.
Notre économie est aujourd’hui basée sur la quantité vendue, et donc l’obsolescence des produits est
programmée. Il faut passer, étape par étape, d’un modèle fondé sur la quantité à un modèle fondé sur la qualité.
Pour cela, les consommateurs devront avoir accès à l’information sur la qualité, sur les « effets utiles » et sur ses
conséquences du point de vue sociétal. Mais ces informations n’existent pas aujourd’hui. Il faut donc les produire
et définir des conventions de mesure, d’affichage.
La commission européenne elle-même a inauguré cette voie, en exigeant des informations sur les pneumatiques,
dont on sait maintenant leurs effets attendus sur le freinage ou sur la consommation en carburant de l’automobile.
Dans un système fondé sur l’achat, seul le prix d’achat est affiché à destination du consommateur. Il faudra un
système d’affichage fondé sur le coût d’usage. Ce système devrait prendre en compte la durée de vie du produit. Il
faut faire comprendre au consommateur qu’il convient de réfléchir en termes de coûts sur le long terme. Par
exemple, pour le choix d’une imprimante, le prix d’achat ne doit pas être le seul élément déterminant, il faut aussi
comparer le coût d’usage (électricité, consommables, durée de vie). Aujourd’hui, aucune information sur le coût
d’usage n’est mise à la disposition du consommateur et il est difficile de contrôler la durée de vie des produits.
Il faut instaurer une garantie du fabricant d’une durée de 10 ans. Les fabricants seraient alors poussés à fabriquer
des produits réparables et donc durables. Aujourd’hui la plupart des produits sont conçus pour ne pas être
réparables. On préfère remplacer que réparer. Par ailleurs, il faudrait impliquer les sociétés financières de crédit à
la consommation.
Il faut également agir sur les consommateurs. Aujourd’hui le consommateur se projette socialement par sa
consommation. Des efforts sont à mener pour inverser cela et en commençant par le marketing. Mais il faut être
vigilant et ne pas être moralisateur.
En conclusion : Deux axes de travail sont à envisager
L’information des consommateurs
La durabilité des produits
D
EBAT AVEC LA SALLE
Françoise SIBILLE, DGCCRF, fait part de son expérience de consommatrice de nouvelles ampoules qui n’ont pas
la durabilité promise. Les enseignes réclament les tickets de caisse. Qui conserve les tickets de caisse lors de
menus achats comme les ampoules ? A l’ère de l’informatique, il faudrait être en mesure de créer des fichiers pour
ce type d’incident et réfléchir de façon générale à qui doit apporter la preuve.
Philippe MOATI, intervenant, approuve la proposition que les ordinateurs devraient être capables de garder en
mémoire la date de l’achat. La solution technique est imaginable, le champ de la négociation apparait immense.
Arnaud FAUCON, Indécosa-CGT rappelle que son organisation avait organisé une manifestation à propos de la
durabilité, alors même que les assises de l’industrie préféraient octroyer au patronat des exonérations de charges.
Il évoque que l’Asie et notamment les grandes surfaces de Shangaï forment le terrain de jeu des grandes
entreprises françaises. On ne veut pas déranger l’expansion économique ailleurs. Attention à ne pas rêver une
économie sans industrie, sinon elle périclite. Songeons à l’Irlande.
Le Grenelle de l’environnement n’a pas rendu l’affichage obligatoire. Gare aussi à l’exemple de la filière solaire
allemande, cette filière-là crée toute une industrie. En France, il y a aussi le marché du solaire, mais les produits
viennent d’ailleurs. Le marché français ne va pas au bout de sa logique.

Journée d’échange et de réflexion ConsoFrance du 18 novembre 2010 Page 3/10
« Pouvoir d’achat et développement durable »
Emmanuelle LAMBERT, AFOC Lille, indique qu’il existe encore des articles pour bébés garantis à vie, ce qui
dénote de la part du fabricant une volonté de mener une politique de qualité avec des produits durables.
Philippe MOATI, intervenant, fait part de son inquiétude face au développement des pays émergents, lorsque la
priorité stratégique se déplace sur ce terrain. Dans le monde marketing, on sent la montée de l’aspiration à
consommer autrement. L’avenir c’est l’orientation client. La qualité devient stratégique. Le fabricant d’automobiles
KIA garantit ses modèles 7 ans.
Julien ADDA, Fédération nationale de l’agriculture biologique, s’interroge : comment consommer autrement ?
Le bio est souvent regardé comme une économie nutritionnelle inabordable. La transformation du modèle agricole
ne s’effectue que difficilement, à tel point que celui-ci s’efforce de façonner le bio pour le spécifier et le massifier.
On force le bio à une économie de la quantité pour rentrer dans le rang. Ce serait la jungle que de vouloir définir un
coût d’usage pour les produits alimentaires. Est-ce que le consommateur a conscience de payer deux, trois fois, le
coût de l’agriculture traditionnelle, si on intègre le coût de l’eau, le coût de la dépollution ? La fiscalité inversée
donne le chiffre de 900 euros à l’hectare.
Philippe MOATI, intervenant, confirme cette vue : il y a en effet un coût d’usage collectif.
Marc LAGAE, ALLDC, indique que, concernant le secteur de la recherche et du développement, les
infrastructures et les changements de produits sont incessants. Il cite l’exemple de la TNT. Si nous suivons
l’orientation de la commercialisation du service et non plus du produit, nous dépendons du travail des chercheurs
et de la technologie sans autre choix.
Philippe MOATI, intervenant, considère que l’on ne peut multiplier à l’infini les infrastructures. Il est vrai que les
nouveaux produits chassent les autres. Mais en appliquant le principe de « l’effet utile », on chasse les pseudo-
innovations, on les démasque.
Jean-Michel ROTHMANN, INC, fait remarquer que la notion de qualité est difficilement palpable, elle est liée au
temps. Sur la durabilité des produits, par le comparatif des produits, les ingénieurs s’essaient à la mesurer mais la
tâche est ardue. Quid enfin de l’obsolescence des produits ? Souvent le marketing ne fait que changer l’apparence
des produits. Il n’est pas certain que la notion de service remplace l’automobile.
Philippe MOATI, intervenant, suggère de comparer les évolutions qui affectent les « boxes ADSL », où les
renouvellements s’effectuent assez lentement parce que les fournisseurs d’accès restent propriétaires des boxes,
avec celles concernant les téléphones portables, où les progrès apparaissent sans commune mesure. Il nous faut
alors retenir les qualités du produit, tirées des usages du produit. La qualité aussi par la durabilité, on dépasse le
problème de la mesure par les tests comparatifs, si les fabricants garantissent leurs produits 10 ans.
Emilie SPIESSER, ADEME, observe que le coût induit une meilleure production, plus on avance dans la
technique. Lorsqu’un produit obtient l’éco-label NF, la qualité environnementale de ces produits s’en trouve
améliorée. Parfois, ces produits peuvent présenter un coût à l’achat, mais il peut aussi être en deçà d’un produit de
marque. Certes la gestion des déchets à un coût et le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit.
Pour empêcher la consommation de masse, peut-être que les associations de consommateurs doivent mener des
actions de sensibilisation sur l’interrogation, avant même d’acheter, portée sur le besoin réel ou non de l’achat. De
la même manière que le CNC a rendu un avis sur les allégations environnementales, en s’attachant à définir le
durable, le naturel, il conviendrait de sensibiliser les consommateurs à l’éco-label.
S’agissant de créer de l’emploi, les SAV présentent des pénuries. Il conviendrait d’explorer cette piste de création
d’emplois.
Quant au prix dans l’agriculture, qu’est-ce que le prix juste ? Ne faudrait-il pas sensibiliser les consommateurs à la
qualité dans leurs assiettes ?
Le Grenelle de l’environnement a réussi à imposer l’affichage environnemental a minima d’un produit, depuis sa
fabrication jusqu’à sa fin de vie.
Corine RINALDO, CNL, explique que beaucoup de familles en difficulté n’ont pas le choix. A leurs yeux, la
question cruciale demeure le coût. Comment aider ces familles à aller vers la sensibilisation que vous prônez ?
Léonard COX, MEDEF, mentionne que les produits venant des pays émergents doivent intégrer la dimension
européenne de mise sur le marché communautaire. Il réclame une compétitivité équitable dans un marché
européen au service des consommateurs.
Philippe MOATI, intervenant, note que c’est là l’un des rares domaines où la Commission travaille dans un
espace assez libéral d’emblée à l’échelle communautaire des 27.
Patrice BOUILLON, Indécosa-CGT, cite Socrate pour les notions de juste prix et de valeur d’usage. Il nous faut
en revenir à la source plus qu’à l’apparence. Il cite aussi le sociologue Weber, auteur de la théorie de la projection

Page 4/10 Journée d’échange et de réflexion ConsoFrance du 18 novembre 2010
« Pouvoir d’achat et développement durable »
sociale à travers la consommation. Il faut inverser ce rapport. Le fait-on avec la technologie discriminante de la
voiture électrique où pour brancher sa voiture, il faut être à proximité d’une borne ? Le rapport à la consommation,
c’est embrasser la diversité des consommateurs et cette consommation apparait bien différente si elle s’adresse à
des cadres ou à des ouvriers spécialisés. Ce qui nous amène à nous interroger sur la place du travail dans la
société. Le but est-il vraiment de travailler ?
Alain TOSTAIN, AFOC, remarque que nous sommes en pleine guerre des labels. Ces derniers deviennent des
marchandises et sont incompréhensibles. La grande distribution a-t-elle véritablement créé des emplois ?
Yves GIQUEL, FO Trésor, s’interroge : qui contrôle les labels, dans le contexte de l’affaiblissement de l’Etat ? Les
gens qui ne disposent pas du pouvoir d’achat ne peuvent traiter toutes ces informations.
Philippe MOATI, intervenant, indique que le commerce de détail est créateur d’emploi, quoiqu’il recule
légèrement. Gare à ne pas idéaliser le commerce d’antan et à ne pas s’enfermer dans le modèle de distribution
des années 60 ! Attention aussi à ne pas être moralisateur : il est facile de blâmer ceux qui consomment à tout va.
On peut inciter à consommer si on en a vraiment besoin, mais le quotidien du consommateur c’est d’être
continuellement la cible d’un marketing agressif. La consommation, marqueur social, ou la socio-consommation est
gênante pour l’économiste. Pour s’en sortir en économie, il faut voir la valeur, la qualité, l’immatériel ou les vertus
magiques des ressources de l’économie du luxe qui vend très cher. Au bout, tout le monde est content avec un
minimum de ressources. Ce n’est que du vent, du ressort de la consommation.
Valérie GERVAIS, Présidente de ConsoFrance, pour conclure cette première table ronde, suggère aux
associations de consommateurs de retenir deux axes de travail : l’information qui doit être délivrée aux
consommateurs ainsi que la durée de garantie des biens ou produits. Elle propose d’en discuter avec les
professionnels et les pouvoirs publics.
X……X
X
Table ronde n°2 : Comment faire bénéficier à tous d’un bien essentiel comme l’énergie ?
Modérateur : Marc LAGAE, Vice-président de ConsoFrance, ALLDC
Marc LAGAE anime ce second moment du colloque. La table ronde réunit Violaine LANNEAU, Chef du service
consommation, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), Jean-Pierre
HERVÉ, GDF-Suez (qui a en charge le marché des professionnels), Edouard CAHEN, membre du CCE
d’EDF (représentant FO), et Bernard CASTILLE, EDF.
Marc LAGAE ALLDC, modérateur, indique que l’énergie est vitale. C’est un bien commun dans un espace
mondialisé. Or, elle est confrontée à des défis majeurs puisque c’est une énergie fossile, elle est épuisable. Dans
le même temps la menace des émissions de gaz à effets de serre sévit. Comment être efficient dans un contexte
mondial ? L’énergie serait-elle une marchandise comme une autre ? L’ouverture des marchés s’est-elle montrée
satisfaisante pour les consommateurs ? S’est-elle faite à un juste prix ? La consommation de cette énergie doit-elle
être liée aux investissements ? Est-ce que notre modèle est durable ? Quid de la loi NOME ?
Intervention de Jean-Pierre HERVÉ, GDF-Suez : L’expérience d’une grande entreprise
L’énergie n’est pas une marchandise comme les autres. C’est une marchandise car elle fait appel à une chaîne
(transport, stockage, distribution) qui a un coût et celui-ci doit se retrouver dans les prix. C’est un bien marchand
donc les prix doivent couvrir les coûts. L’énergie est une marchandise très réglementée.
Pour tenir compte de la spécificité de la marchandise énergie, il existe des tarifs spéciaux à destination des
personnes vulnérables : pour GDF-Suez, le TSS (Tarif spécial de solidarité) gaz.
GDF-Suez réalise des investissements de 20 millions d’euros par an. Cette société participe aussi au FSL (fonds
de solidarité logement) et a doublé son apport, soit 6 millions par an.
Par ailleurs, GDF-Suez a mis en place un dispositif de prévention du paiement des factures et travaille en réseau
avec des partenaires de terrain sur l’ensemble du territoire (PIMMS).
L’ouverture à la concurrence de l’énergie a été un « big bang » des processus plus qu’un « big bang » de la
concurrence. Elle a imposé des transformations importantes au sein des entreprises et particulièrement vis-à-vis
des salariés conseillers clientèles. Elle a impliqué la mise en place de nouveaux systèmes d’information propres à
chaque entreprise. La séparation des services entre GDF et EDF a engendré des difficultés humaines.
En 2010, la phase d’ouverture n’est pas terminée. Pour le moment aucun bilan de l’ouverture n’est disponible.
GDF-Suez est en attente du rapport du médiateur national de l’énergie.
Pour GDF-Suez, la qualité est la seule façon de garder ses clients, elle procède à de nombreuses enquêtes de
satisfaction auprès de ses clients et les retours sont positifs en termes de qualité de service.
Un gros travail d’explication reste encore à faire auprès des clients : expliquer, communiquer. Les processus
doivent être encore améliorés, notamment en ce qui concerne le relevé des index. En effet, la facturation sur

Journée d’échange et de réflexion ConsoFrance du 18 novembre 2010 Page 5/10
« Pouvoir d’achat et développement durable »
estimation de la consommation est très mal supportée. Nous attendons beaucoup des compteurs intelligents. De
plus, nous ne sommes pas insensibles au phénomène de la précarité énergétique qui touche trois millions de
familles.
La loi Nome va bientôt être applicable. Elle introduit des éléments positifs pour le consommateur et elle crée les
conditions d’une vraie concurrence.
A l’avenir, il faudra penser à la diversité des énergies, promouvoir les bâtiments à basse consommation et travailler
sur la précarité énergétique.
Intervention de Bernard CASTILLE, EDF : L’expérience d’une autre grande entreprise
EDF commercialise le TPN ou tarif de première nécessité. Il concerne deux millions d’ayants droit et 600 000
bénéficiaires. EDF est favorable à ce que tous les ayants droit puissent en bénéficier. Il faudrait l’automatisation du
dispositif mais pour cela il faut un décret.
EDF contribue également aux FSL à hauteur de 2 millions d’euros. EDF souhaite travailler sur la maîtrise de la
consommation. Pour ce faire, l’entreprise développe des partenariats, notamment avec l’association « Unis-Cité »,
dont le but est d’apprendre aux consommateurs les bons gestes.
Ensuite, il faut s’attaquer à la rénovation des logements. Pour cela, EDF a mis en œuvre un partenariat avec la
fondation Abbé Pierre pour la réhabilitation de 2 000 logements sur trois ans.
Pour EDF, l’ouverture du marché a favorisé la création d’interfaces supplémentaires. Le service clients doit être
amélioré. EDF développe des points de médiation sociale avec des partenaires (notamment les PIMMS).
La péréquation : c’est du domaine du législateur. EDF est favorable à la concurrence et la loi NOME s’impose à
elle.
En ce qui concerne l’avenir énergétique, nous avons mis au point un plan : le 3 fois 20. Il se décompose en :
il faut réduire de 20 % sa consommation ;
il faut des énergies renouvelables pour 20 % ;
il faut une baisse des gaz à effet de serre pour 20 %.
Intervention de Violaine LANNEAU, FNCCR : Le point de vue des collectivités locales
L’énergie, et plus spécifiquement l’électricité, est un produit de première nécessité, un bien essentiel facteur de
cohésion sociale. Il convient donc d’assurer des conditions acceptables d’accès à ce produit au plus grand
nombre en garantissent un véritable « droit à l’énergie ». Or, la FNCCR constate une dégradation de ces
conditions d’accès, qui sont constituées par le niveau de prix et les conditions de commercialisation et ce, malgré
un encadrement par les pouvoirs publics des tarifs et la prise en compte par le législateur européen, dans un
premier temps, puis français de la situation de vulnérabilité des consommateurs d’énergie.
De fait, on constate un phénomène de renchérissement des prix de l’énergie qui entraîne une augmentation des
tarifs réglementés de l’électricité mais également du gaz naturel. Par ailleurs, on ne peut que craindre dans ce
contexte une tendance à la dépolitisation du mode de fixation des tarifs. C’est d’ailleurs une tendance confirmée
par le projet de loi NOME. En outre, les conditions de vente se sont fortement détériorées en raison de :
une complexification des relations entre le fournisseur, le gestionnaire de réseau et le consommateur ;
l’apparition de pratiques commerciales déloyales ;
la perte du lien de proximité entre le consommateur et son fournisseur ;
la déshumanisation du traitement des dossiers de litiges ;
etc.
Dans ce contexte, et face à ces constats, les consommateurs semblent être les laissé-pour-compte de la création
d’un marché européen de l’énergie. La détérioration des conditions d’accès à l’énergie conduit à une augmentation
inquiétante d’une fracture énergétique non seulement en France mais également au sein de l’Union européenne.
On dénombre ainsi en France 3,4 millions de ménages en situation de précarité énergétique, des ménages qui
consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques.
Dans ces conditions, il semble absolument indispensable de garantir un véritable droit à l’énergie, qui suppose une
préservation du service public local de l’électricité et du gaz naturel et une préservation, voire une adaptation, des
dispositifs préventifs et curatifs de traitement des impayés.
La commercialisation du produit énergétique dans le cadre du service public - une commercialisation adossée aux
tarifs réglementés - doit demeurer sous le contrôle d’autorités publiques et non être laissée à la seule mainmise
d’intérêts privés. Par ailleurs, il paraît indispensable de remettre le citoyen-consommateur au cœur du marché, au
risque de voir s’accentuer encore davantage la fracture énergétique et son corolaire : la précarité énergétique.
D
EBAT AVEC LA SALLE
Arnaud FAUCON, Indécosa-CGT souhaite revenir sur la fixation du prix. Est-ce que le ministre de l’écologie
fixera le prix de l’énergie renouvelable ? Est-ce que la CRE donnera le la ? Attention le service réglementé
représente quelque chose de sacré !
Françoise THIEBAULT, ALLDC, rapporte que la loi NOME fixe le tarif réglementé comprenant l’ensemble des
coûts. Cette juste rémunération ne cache-t-elle pas la condamnation précisément de ce tarif réglementé ? Quel
sera le contenu du prochain contrat de service public d’EDF ? La CRE n’est-elle pas un leurre pour compenser les
augmentations liées à la diffusion de ces compteurs évolués qu’on qualifie à tort de compteurs intelligents ? Les
inégalités sont profondes d’autant plus que les profils des consommateurs ne sont pas les mêmes. Nous sommes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%