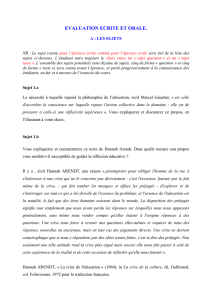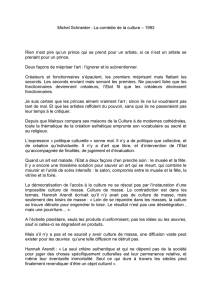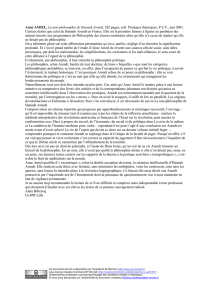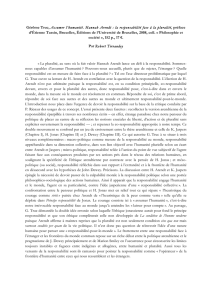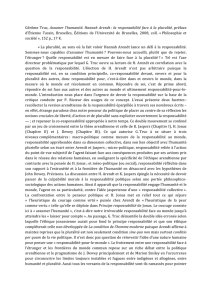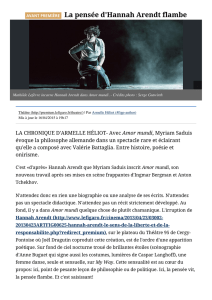Hannah Arendt, The Human Condition Lecture

Dubuis Quentin
Master 1
Philosophie Contemporaine
Semestre 1
Philosophie économique et sociale
Hannah Arendt, The Human Condition
Lecture analytique du chapitre I : « La condition humaine »

Introduction Générale
Hannah Arendt est née en Allemagne, en 1906. Durant ses études de philosophie,
elle a l'occasion de rencontrer Heidegger (à l'université de Marbourg), Husserl (à
Fribourg), et Karl Jasper (à Heidelberg), tout en héritant de l'influence de Max Weber.
Avec l'arrivée du nazisme au pouvoir, Hannah Arendt, née de parents juifs assimilés, doit
se réfugier en France, où elle a l'occasion de rencontrer Sartre, Raymond Arond, Stephane
Zweig, mais surtout Heinrich Büchler, son second mari, qui dit-on, a révélé sa passion pour
la philosophie politique. En 1940 elle est arrêtée par la police française, et doit s'échapper
du camp dans lequel elle est détenue pour rejoindre New York en 1941. En 1951, elle
obtient la nationalité américaine, et la même année publie son premier grand ouvrage,
Les
Origines du Totalitarisme
, qui la fait connaître comme grand penseur de philosophie
politique. A partir de 1953, elle commence à enseigner dans les plus prestigieuses
universités américaines, et ce jusqu'en 1973, un an avant sa mort en 1974.
The Human Condition
, son second ouvrage, est publié en 1958. Certains on pu y voir un
changement de registre, de la philosophie politique à une philosophie plus fondamentale,
plus anthropologique. En réalité, même s'il en sans doute
« l'ouvrage le plus
philosophique »
de la philosophe, il reste aussi et surtout un chef d’œuvre de philosophie
politique, comme le fait remarquer Paul Ricoeur dans sa préface1, né du souci d'Hannah
Arendt pour le monde politique. Un monde politique auquel elle s'est elle-même trouvée
confrontée, et dont elle essaye de déterminer les fondements et les causes de son
« aliénation moderne », dans l'objectif, peut-être, de contribuer à l'élaboration de
« solutions » aux maux politiques contemporains.
En 1956, Hannah Arendt écrivait à son ami Jaspers :
« Mon manuscrit est à peu
près au point, mais loin d’être prêt pour l’impression. Je l’appellerai Vita Activa et je
m’intéresserai essentiellement au travail (labour), à l’œuvre (work) et à l’action, et à leur
implication politique. »
Si le « manuscrit » est publié aux Etats-Unis sous le titre
The
Human Condition
, il est par ailleurs paru en Allemagne sous l’appellation
Vita Activa oder
vom tätiden Lebens,
prouvant si besoin est la centralité du concept dans ce ouvrage. Ce
dernier paraît en France en 1961, sous la traduction
Condition de l'homme moderne
, qui a
le défaut de ne pas rendre compte des fondements historiques de l'analyse de l'auteur. En
effet, si l'objectif de cet essai est bien de dégager la condition de l'être humain dans les
temps « modernes » qui sont les nôtres, c'est au travers d'une analyse historique de la
condition de l'être humain et des notions qui s'y rattachent, de l'Antiquité grecque,
romaine jusqu'à l'après seconde guerre mondiale, en passant par le Moyen-Age chrétien.
1 Édition Calmann-Lévy, Pocket, collection Agora, Paris, 1983.

Introduction au chapitre I : « La Condition Humaine »
Ce chapitre de l’œuvre occupe une place particulière : Il est de loin le plus maigre
des six chapitres de l'ouvrage (18 pages, soit un peu plus de trois fois moins long que les
autres chapitres en moyenne), si bien que l'on pourrait s'interroger sur son degré
d'importance. Et pourtant, ses autres caractéristiques semblent refléter son autorité : Il est
le premier chapitre, placé avant tous les autres, et reçoit le même titre que l'ouvrage. Car,
comme le lecteur s'en rend vite compte, ce chapitre est primordial : L'auteure y expose
l'ensemble de son projet de réhabilitation, dans tout son détail, du concept de
vita activa
et de sa place dans l'analyse de la condition humaine. Ainsi, après avoir exposé ce qu'elle
entend précisément par le concept de
vita activa
et les trois activités humaines qu'il
renferme (
Labour,
Work
,
Action
), la philosophe délivre un travail de généalogie
philosophique du terme de
vita activa
, cherchant à mettre en évidence que la précision du
concept de
vita activa
a souffert de la domination de son concept concurrent de
vita
comtemplativa.
Car cette notion de « vie contemplative » a dominé en importance et en
majesté celui de « vie active », et ce tout au long de la tradition philosophique, établissant
un déséquilibre que même le renversement moderne des valeurs porté par Nietzsche ou
Marx n'aurait su corriger.
En ce sens, l'analyse de ce premier chapitre permet de mieux appréhender les fondements
de l'ouvrage, et ce à deux égards : D'une part, l'auteur y expose une première définition
des concepts au centre de sa réflexion, tels que « vita activa », « labour », « work »,
« action », « condition », et bien d'autres. D'autre part, dès ce chapitre, la philosophe se
fait aussi historienne, en inscrivant sa réflexion dans la perspective de l'histoire de la
pensée occidentale.
Si à l'image de l’œuvre qu'il introduit, ce premier chapitre renferme plusieurs axes de
réflexions, il cherche avant tout à répondre à la problématique suivante : Comment se fait-
il que la
vita activa
, pourtant au centre de nos sociétés contemporaines, soit un concept si
peu pris en charge par la réflexion politique et philosophique ?
Car pour le lecteur français contemporain, il ne fait aucune doute que l'expression de
« vita activa » renvoie à celle de « vie active », expression courante, voire essentielle,
dans l'analyse politique, en ce qu'elle désigne positivement une vie construite autour d'un
travail rémunéré. Le Bureau International du Travail définit ainsi la « population active »,
c'est-à-dire de la population se trouvant dans la « vie active », comme l'ensemble des
personnes qui soit ont un travail rémunéré soit sont à la recherche d'un (autrement dit,
toute personne sur le « marché du travail »).
Pour Hannah Arendt, le faible intérêt que semble manifester la réflexion philosophico-
politique pour ce concept et les subtilités qu'il renferme s'explique l'ombre que lui a
toujours porté, dans l'histoire de la pensée occidentale, son concept opposé : La
vita
contemplativa
. Dès lors, vouloir analyser le concept de « vita activa » suppose non
seulement d'en proposer une définition, voire une partition, comme le fait Hannah Arendt,
mais aussi de prendre en compte l'histoire de ce concept et en particulier son rapport
historique avec la
vita comtemplativa
.
Nous proposons ici une lecture analytique de ce premier chapitre, en respectant autant
que possible le cheminement du développement intellectuel présenté par l'auteur. C'est
pourquoi nous suivrons la tripartition opérée par Hannah Arendt elle-même :
Tout d'abord, nous verrons dans quelles mesure la
vita activa
est lié à la condition
humaine, dans « La vita activa et la condition humaine » (I).

Puis, nous analyserons l'histoire de l'expression que fournit la philosophe et sa relation
avec la
vita comtemplativa
, dans « Le terme vita activa » (II).
Enfin, nous commenterons la distinction entre immortalité et éternité que choisit l'auteur
pour illustrer la fracture entre
vita activa
et
vita comtemplativa
, dans « Éternité contre
Immortalité (III).
I. La vita activa et la condition humaine
[§1] Le terme de vita activa est proposé par Hannah Arendt afin de désigner
« trois
activités humaines fondamentales : Le travail (Labour), l’œuvre (Work), et l'action
(action). »
Avant même de proposer une définition des concepts de travail, œuvre et action, Hannah
Arendt met en avant la fondamentalité de ceux-ci. Ce qui peut paraître précoce pour le
lecteur, et qui fait apercevoir le biais que prend Arendt afin de rétablir l'importance, voire
la dignité, de la vie active, si souvent dédaignée dans le domaine de la philosophie (en
raison, nous le verrons, de son infériorité à la contemplation ou à la réflexion pure), mais
aussi dans la société européenne en général : La distinction faite aujourd'hui en France
dans l’Éducation Nationale entre les bacs « généraux » (Littéraire, Scientifique, et plus
récemment Économique et Social) et « professionnels » peut être une bonne illustration
de la hiérarchisation entre la vie intellectuelle et la vie active, ou professionnelle, que
Arendt dénonce.
Ces trois activités sont fondamentales, donc, parce que « chacune d'elles correspond à
l'une des conditions de base (basic conditions) dans lesquelles la vie sur terre a été
donnée à l'homme. »
Dès ces premières lignes du chapitre, nous nous trouvons confrontés à une difficulté
d'interprétation : Le terme de « condition » employé ici par Hannah Arendt est en effet
hautement équivoque. Arendt elle-même ne manque pas de revenir sur ce terme, et
notamment sur la distinction qu'elle opère entre nature humaine et condition humaine (cf.
II), mais notons déjà ici que les
« conditions de bases »
qu'elle évoque désignent moins
en l’occurrence l'idée de causalité que celle « d'état ». Ainsi, on pourrait dire que les trois
activités de la vita activa sont fondamentales parce que chacune d'entre elles correspond à
l'une des caractéristiques de l'état dans lequel se trouve l'homme sur Terre.
[§2] Cela ne nous dit cependant pas ce que sont précisément ces activités ! Les
précisions que donne la philosophe dans le second paragraphe livrent à ce propos de
premières définitions du travail, de l’œuvre et de l'action. La première « définition », ou
précision, que l'auteur fournit est celle de « labour » :
« L'activité qui correspond au
processus biologique du corps humain, dont la croissance spontanée, le métabolisme et
éventuellement la corruption, sont liées aux productions élémentaires dont le travail
(Labour) nourrit ce processus vital. »
Le travail est ainsi l'activité qui permet au corps
humain de se préserver, ou plus simplement de « continuer à fonctionner ». Sans le
travail, la vie humaine ne saurait perdurer. C'est pourquoi la philosophe ajoute que « la
condition humaine du travail est la vie elle-même ». Le terme de « condition » est ici
encore équivoque : Faut-il comprendre que
la caractéristique dans la condition humaine
qui correspond à l'activité du travail est la vie
, ou bien que
la vie est la condition logique
du travail
? Gageons que les deux interprétations, bien que différentes, soient liées. A
l'aide des précisions que l'auteur apportera dans le reste de son ouvrage, nous pouvons
lever toute ambiguïté : La vie et le travail vont de pair. La vie rend nécessaire le travail, et
le travail en retour permet de continuer à vivre. En ce sens, la vie et le travail sont

inséparables car conditions l'un de l'autre : Sans vie, pas de travail, mais sans travail, pas
de vie durable. Le travail est donc pour Hannah Arendt l'effort fourni par l'être humain
pour simplement rester en vie. En termes spinozistes, on pourrait dire que le travail est
l'expression la plus directe et la plus nécessaire du conatus (latin de « effort ») de l'être
humain. D'où le terme de « Labour », qui renvoie immanquablement à « l'effort ». A ce
propos, la traduction française peut prêter à confusion : Ici «Labour », la « labeur »,
traduit par le « travail », désigne l'activité que les besoins de la vie et du corps rendent
indispensables, alors que la notion de « travail » a généralement une acception plus large.
Si l'on cherchait un équivalent dans la culture française au terme de « Labour », il faudrait
le rapprocher d'une de nos expressions contemporaines : « Le travail alimentaire ».
Cette activité est donc au centre de toute vie humaine, et particulièrement au centre de
nos sociétés occidentales, qu'Hannah Arendt appelle
« sociétés de travailleurs »
. Nous les
appelons aujourd'hui
« sociétés de consommation »
, mais cela ne signifie pas que le
« Labour » perd de la pertinence pour autant, bien au contraire : Le processus imposé à
l'homme par la vie (le processus vital) commence avec le travail, et culmine avec la
consommation de ses produits (cf. chapitre III, « Une société de consommateurs »).
[§3] Quant à « l’œuvre » (« work » dans la version originale), elle est
« l'activité qui
correspond à la non-naturalité de l'existence humaine »
: C'est l'activité qui met en
évidence la capacité de l'être humain à produire quelque chose qui dépasse le naturel, qui
soit proprement « artificiel ».
« L’œuvre » produit un monde artificiel d'objets dans lequel les êtres humains évoluent,
mais qui est voué à durer plus longtemps que chaque vie individuelle, à survivre aux
individus. En ce sens, elle est l'activité qui permet à l'être humain d'imprimer sa marque
sur le monde au-delà de son propre destin mortel.
A nouveau, la traduction française peut être trompeuse. Puisqu'elle elle traduit « Labour »
par « Travail », elle se prive de la possibilité de traduire « Work » par « Travail ». On peut
se demander si une traduction plus littérale de «Labour » en « Labeur » d'une part, et
« Travail » d'autre part n'aurait pas été préférable. Cependant, une telle traduction aurait
pu été contre-intuitive pour le lecteur français, pour lequel le « travail » est fortement lié à
l'effort, à la consommation, en somme à la vie, et peut-être moins à l'idée de création
artificielle. Quoi qu'il en soit, l'important est de retenir cette idée de « fabrication », de
« construction », que l'activité d'« œuvre » véhicule.
La condition humaine qui correspondrait à « l’œuvre » serait la
« worldliness »
,
particulièrement difficile à comprendre pour un lecteur français, traduit par
« appartenance-au-monde »
. Cela signifie que c'est parce que l'homme appartient au
monde matériel qu'il est poussé à fabriquer des objets artificiels qui le transformeront.
Ainsi, par ces objets artificiels qu'il fabrique, l'être humain contribue à modifier le monde,
afin de le rendre plus pratique, plus confortable, plus accueillant, pour lui-même.
Hannah Arendt semble ainsi rappeler, par la description du travail et de l'action, que l'être
humain est d'abord un corps matériel, qui appartient à un monde matériel. Un corps qui
s'efforce de survivre et des mains pour rendre le monde plus facile à vivre. En somme,
pour reprendre la terminologie de la philosophe elle-même (que l'on trouve plus loin dans
l’œuvre), l'être humain est avant tout un
animal laborans
et un
homo faber
.
[§4] La vita activa ne se résume cependant pas à la relation de l'être humain avec la
matière, qu'il s'agisse de son corps ou du monde matériel. La troisième activité de la vita
activa, l'action, est en effet la seule des trois activités de la vita activa à
« mettre en
relation les hommes sans l'intermédiaire de la matière »
. A l'occasion de ce premier
chapitre, Hannah Arendt ne donne pas de définition de l'action, mais esquisse d'ores et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%