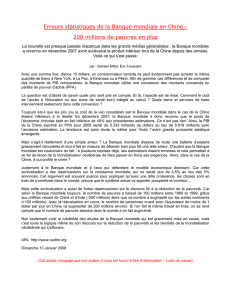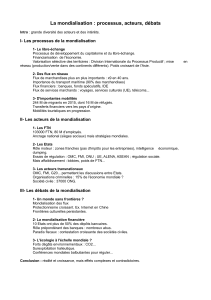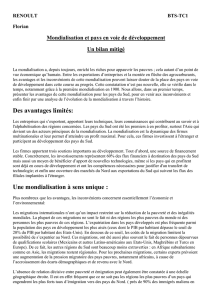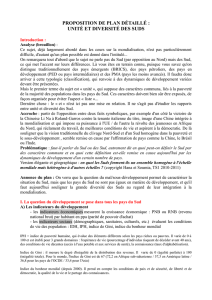Unités et diversité des Sud dans l`intégration à l`économie mondiale

Site académique Aix-Marseille Histoire et Géographie
Unités et diversité des Sud dans l’intégration à l’économie
mondiale
Anne-Marie Drai
Le 1er mars 2005
Professeure en CPGE
(Communication réalisée lors des Cinquièmes Rencontres de la Durance - 2005)
Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur l’Inspecteur, J. Serandour, pour son invitation à ces
journées de la Durance et toute l’équipe d’enseignants qui participent à son organisation et à
son animation.
En tant qu’économiste enseignant en CPGE, le débat sur la décolonisation s’actualise dans les
possibilités qui s’offrent aujourd’hui aux pays les plus pauvres de la planète, de bénéficier des
effets d’une amélioration en matière de niveau de vie, de santé, d’accès au savoir, voire d’une
«expansion de leurs libertés réelles
1
». En ce sens, il s’agit de questionner les modalités
actuelles de leur insertion dans l’économie mondiale.
On a beaucoup commenté, ce qu’A.Nonjon
2
a nommé la « déflagration » de Cancun, en
septembre 2003. Le rejet d’un accord douanier sur les produits agricoles par 22 grands pays
en développement (notamment, le Brésil, Inde, Chine, Egypte, Afrique du Sud) rejoint par le
« Groupe des 4 » pays moins avancés exportateurs de coton, (Burkina Faso, Bénin, Mali,
Tchad), a conduit à certaines concessions des pays développés
3
dans la libéralisation des
échanges. L’UE s’est engagée en juillet 2004, à éliminer les subventions aux exportations
agricoles et les Etats-Unis devraient limiter leurs crédits aux exportations.. Doit-on voir là, dans
un écho au « coup de tonnerre
4
de Bandoeng, les signes d’un renouveau du tiers-
mondisme et d’une capacité d’organisation du Sud?
Certes, la définition géopolitique et idéologique du tiers monde, telle que la voyait Alfred
Sauvy, en 1952, - entre un bloc communiste ayant choisi un programme étatique
d'industrialisation rapide qui devait «dépasser les Etats-Unis d'ici l'an 2000 », comme l’avait
promis Khrouchtchev, et un bloc capitaliste vers lesquels les Etats-Unis concentrèrent leurs
efforts dans l'immédiat après-guerre
5
- a volé en éclat dès les années 1960. Pourtant, le
nombre d’Etats indépendants s’est rapidement accru entre 1945 et 1965, ce sont
environ cinquante quatre Etats qui ont fait leur apparition dans le monde, et, cinquante sept
autres Etats sont nés entre 1965 et la fin du siècle . Mais, d’une part, sur le plan politique, les
conflits régionaux entre pays du Sud ont accompagné l’indépendance nationale (par
exemple, la confrontation Indonésie Malaisie, Inde Pakistan, Irak-Iran). D’autre part, sur le plan
économique, la croissance et le développement n’ont pas été au rendez-vous pour tous.
Dès les années 1970, les économistes ont multiplié les catégories de pays: NPI (selon la
terminologie OCDE) , pays producteurs de pétrole, PMA, petites économies insulaires (selon la
classification CNUCED). 40% des habitants de la planète a encore un revenu moyen
inférieur à 2 euros par jour. Cette part devrait s’accroître dans les dix prochaines années
6
.
La disparition de l’ordre bipolaire entre 1989-1991 et la transition des pays de l’Est vers
1
Selon, A. Sen définit le développement se manifeste par la « faculté d’échapper à la famine, à la malnutrition, à la morbidité
évitable et à la mortalité prématurée, aussi bien que les libertés qui découlent de l’alphabétisation, de la participation politique
ouverte, de la libre expression».
2
A.Nonjon, Un nouveau tiers-mondisme, l’exemple du G20, Espace Prépa, , n°99, décembre 2004.
3
USA, UE, Suisse, Norvège, Japon, Canada
4
en référence à L.S.Shenghor qui qualifiait Bandoeng , comme « Un coup de tonnerre dans un ciel serein ».
5
A l’exception de l’Amérique Latine
6
Selon le rapport du PNUD 2004, la population qui a un revenu par habitant de moins de 735 dollars par habitant en 2001,
s’élevait en 2002 à 2,5 milliards d’habitants sur une population mondiale de 6,22 milliards et ce rapport évoluerait en 2015
respectivement vers 3 milliards d et 7,19 milliards.

l’économie de marché, ont ainsi, créé des clivages plus « flous et mouvants
7
». Chaque
année depuis 1991, au fil des rapports du PNUD, l’ONU a mis l’accent sur de nouveaux
indicateurs qui évaluent les degrés de participation des acteurs du développement : place des
femmes, des pauvres, des minorités culturelles à travers leurs accès à l’éducation, la santé,
aux nouvelles technologie, au pouvoir politique.
Comment appréhender les anciennes et nouvelles lignes de fracture du Sud pour cerner
la « ligne de partage des eaux qui divise le Nord et le Sud
8
» qui sépare et qui réunit, comme
l’évoquait Monsieur l’Inspecteur Jean Serandour dans son intervention 2002 sur la
Méditerranée, Quel poids accorder aux variables économique et aux variables politiques au
regard de la possibilité d’une certaine convergence Nord Sud ? C’est un survol rapide des
débats sur le poids de ces deux dimensions que je vous propose dans le temps qui
nous est imparti.
De nouvelles formes d’exclusion et d’intégration à l’économie mondiale
Ouverture aux échanges, intégration à l’économie mondiale et pauvreté
Alors que dans la période post-coloniale, et jusqu’aux années 1980, les Etats récemment
indépendants tentaient de protéger les industries de consommation pour développer des
industries de substitution aux importations, avec en quelque sorte, comme le souligne Laurence
Tubiana, un marché faible et un Etat fort
9
, l’adhésion aux principes du libre échange et de
l’économie de marché a gagné depuis, beaucoup de terrain. Les commentaires
d’inspiration libérale avaient mis particulièrement l’accent sur une logique exportatrice des pays
asiatiques, respectueuse de la sanction des marchés, favorisant une remontée dynamique à
partir du textile et la création d’emplois peu qualifiés - ce que les théoriciens de l'ajustement
structurel ont appelé, « stratégie d'industrialisation par l'exportation ». Cependant, si on exclut
l’Inde et la Chine, l’ouverture des économies imposée par le Consensus de Washington - la
Banque Mondiale et le FMI- pour faire face aux problèmes d’endettement des pays du Sud, n’a
pas fait diminué les écarts de richesse. La comparaison avec la situation d’il y a 40 ans,
montre qu’en termes de niveaux de revenu par tête, la plupart des pays pauvres d’une
part, des riches de l'autre, le sont restés
10
. Le groupe des pays intermédiaires s'est réduit,
certains pays ont réussi un rattrapage (Chine) ou sont en bonne voie (Inde), d’autres s’enlisent
voire régressent (Cote d’Ivoire..).
Comme le note de le rapport de la CNUCED 2004, les pays pauvres sont en fait, plus ouverts au
commerce international que les pays les plus riches du monde
11
:, mais pour la plupart, la
mondialisation reste une attente, une promesse d’avenir meilleur. Durant les années
1990, « ce sont les pays qui s'étaient ouverts modérément et non ceux qui
s'étaient le plus ouverts qui ont connu les plus grands progrès en termes de
croissance des exportations et de la consommation ».
De nouvelles formes de domination du Nord ?
Pourtant, au sein de l'OMC, quoiqu’il n’y ait pas de définition officielle
12
, les pays en
développement sont majoritaires : sur 148 pays membres, plus de 100 - soit les trois quarts -
sont considérés comme sous développés. Certes, on différencie le « Groupe des 22 » déjà
évoqué, un «Groupe des 90» où se retrouvent pays africains, pays ACP (Afrique -Caraïbes-
7
Elsa Assidon, « L’émergence d’un nouveau domaine : l’économie du développement, in Nouvelle histoire de la pensée
économique, La Découverte, 2000, PP.487-515.
8
Terme de Th. Fabre repris par J. Serandour, in « Journées de la Durance », 2002
9
On peut citer le cas du Brésil, après la mise en place spontanée de cette politique dans les années 1930 par le gouvernement
Vargas
9
la marche forcée de l'industrialisation est devenue plus volontaire. Le gouvernement populiste de Kubitschek lança en
1956, un plan quinquennal ambitieux, financé par emprunt auprès de banques américaines (150 millions de dollars) et une
réforme agraire. Le transfert de la capitale vers Brasilia traduisait l’affirmation de cette politique, rapidement tempérée par la chute
des prix mondiaux du café. Malgré coup d’Etat des militaires (1964) et l’appel au capital étranger, le miracle 1968-1973, résista
mal aux chocs pétroliers et à la misère de près de la moitié de la population.
10
I.Bensidoun et A.Chevallier, « Ouverture du Sud : priorité au développement» , in « L’économie mondiale » 2003, CEPII, la
Découverte2002.
11
Selon le rapport de la CNUCED 2004, le ratio entre exportations et importations et le PIB est de 51% pour les PMA alors qu'il
n'atteint que 43 % pour les pays de l'OCDE.
12
Les pays en développement sont désignés comme tels, par auto sélection, et ce procédé n’est pas accepté de façon automatique,
par tous les organes de l'OMC.

Pacifique) et la plupart des pays moins avancés (sur les 50 pays membres de l’OMC, 32 en font
partie et 8 autres sont en voie d’accession). L’OMC vit-elle sur un modèle dépassé, en ne
reconnaissant que trois catégories de pays : pays développés, pays en développement et pays
les moins avancés ? Sa structure est-elle trop peu démocratique? « Cancun marque
certainement un tournant dans la gouvernance de l’organisation car les rapports de force
nouvellement établis resteront dans les mémoires, sinon dans la forme des nouvelles
alliances.
13
». L’intégration à l’économie mondiale semble être une tendance lourde,
avec des seuils d’irréversibilité, mais, depuis l’échec de la Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA ou ALCA), de l'Alaska à la Terre de Feu que voulait le président Bush, ce
sont les négociations bilatérales qui semblent être activées pour favoriser l’accès au
marché américain : on observe par exemple, des accords bilatéraux entre les USA et certains
pays d’Amérique centrale, ou plus récemment avec le Maroc (2005). Dans son rapport annuel
présenté fin 2004, le directeur général de l’OMC Supachai Panitchpakdi constate qu’il y a 206
accords préférentiels, et qu’une large partie de ces traités a été signée depuis 2003
(21 de ces traités ont été conclus entre janvier et août 2003, 30 autres ont été signés entre
2003 et 2004 et 60 sont en cours de négociations). Il y aurait un risque que «les relations
commerciales préférentielles et discriminatoires ne deviennent une caractéristique toujours plus
présente, et peut-être irréversible, du système commercial international.» Sans doute cela va
davantage dans le sens d’une gouvernance
14
mondiale , c’est-à-dire l’émergence de règles sans
gouvernement multinational.
Dans une lecture marxiste, les formes d’intégration à l’économie mondiale sont articulées
aux modalités de domination des pays plus avancés. Depuis le XIXe siècle, l’écart des revenus
moyens des pays les plus riches et les plus pauvres, s’est amplifié : il aurait évolué de 9 pour 1 à la
fin du XIXe siècle, à 60 pour 1 en 2000
15
. Le cas de l’Inde qui devrait corroborer les bienfaits du
commerce international, avec son intégration officielle à l’Empire en 1877, illustrerait plutôt la thèse
d’une évolution divergente : les écarts de richesse avec l’Angleterre qui étaient de 1 à 2 au début du
siècle sont passés de 1à 10, à la fin du XIXe. L’asymétrie de la spécialisation de l’Inde, impulsée
par les biens que l’Angleterre ne produisait pas, tels que le coton ou l’opium, a été largement
commentée depuis Marx.. Paul Baran n’écrivait-il pas que la pénétration capitaliste a « perpétué la
stagnation de l’économie de ces pays, le maintien de techniques archaïques et de rapports sociaux
rétrogrades »
16
. Cette spécialisation entre produits manufacturés au Nord, et matières premières au
Sud, est restée encore dominante jusque dans les années 1950. Le débat sur les termes de
l’échange lancé par la première génération des économistes de la Commission des nations unies
pour l’Amérique Latine (la CEPAL) concerne toujours des pays pauvres exportateurs d’un ou deux
produits, mais le thème de la dépendance tend à se déplacer vers l’enjeu d’une économie de la
connaissance
17
.
Le poids des mutations technologiques dans les écarts Nord Sud
Dans une optique plus libérale, notre prospérité ne se nourrit pas de la misère ou de
l’exploitation des autres pays. Selon Daniel Cohen[2004]
18
, les pays développés échangent
surtout entre eux et n’ont malheureusement, pas besoin du Tiers-Monde. La dynamique des
échanges dans les deux phases de la mondialisation (celle de la fin du XIXe siècle, et de la fin
du XXe siècle), a été impulsée par la baisse des coûts de transport et de communication,
conduisant à une certaine convergence des prix des produits échangés internationalement.
Mais, pour Paul Krugman ou Daniel Cohen, ce sont les nouvelles technologies qui favorisent
et/ou bloquent le développement. D.Cohen [1997] attribue aux spécificités du progrès
technique porté par la 'troisième révolution industrielle'), les causes des inégalités
croissantes sur le plan interne (que ce soit en termes de salaire, comme aux Etats-Unis, ou
d'accès à l'emploi, comme en Europe) et sur le plan externe (en amplifiant les inégalités
entre les pays). La première mondialisation avait progressivement conduit, selon Daniel Cohen
13
JM. PAUGAM, « Pour une relance du cycle de développement : refonder le consensus multilatéral après Cancun », IFRI,
dec.2003.
14
Par gouvernance mondiale on peut entendre, avec Pascal Lamy « l’ensemble des transactions par lesquelles des règles
collectives sont élaborées, décidées, légitimées, mises en œuvre et contrôlées ».
15
Selon l’étude de Branco Milanovitch dans l’Economic Journal 2002
16
« Economie politique de la croissance », ed américaine , 1957, Maspero, 1967, p.285.
17
El Mouhoub Mohoud, Division internationale du travail et économie de la connaissance », in « Sommes sortis du capitalisme
industriel ? » La Dispute 2004, sous la dir de C.Vercellone121-136
18
La mondialisation et ses ennemis, Grasset, 2004.

[2004], à la disparition des paysans en France, la seconde conduirait à une diminution drastique
des ouvriers dans les usines des pays développés (ils ne sont plus que 10% aux USA contre 30
ou 40% dans les années 50), avec le déplacement de la création de valeur vers les deux bouts
de la chaîne de production, c’est-à-dire vers la conception et la commercialisation (en quelque
sorte, une généralisation des modalités de la production de la paire de chaussure Nike des
années 1990).
La géographie jouerait un rôle déterminant. Pour un secteur ou sur un territoire, les
effets d’agglomération
19
(effet de cluster) seraient très puissants avec l’installation des
meilleurs talents et des firmes dynamiques. Le courant très hétérogène, de la nouvelle
géographie économique
20
met l’accent sur de nouvelles opportunités et de nouveaux
désavantages du déplacement des lieux de fabrication vers des nouvelles régions. La
recherche, la formation, les infrastructures productives, créées notamment par les services
d’intermédiation, (comme la banque, le transport les communications, la distribution),
renforceraient l’accès à l’information sur les produits et les procédés. Des effets d’apprentissage
par le faire (learning by doing) et par l’usage (learning by using) sont susceptibles de créer une
dynamique cumulative. Par exemple, sur la côte est de la Chine, les industries électriques et
électroniques ont émergé dans les années 1990, soutenues par les investisseurs étrangers qui
réalisaient plus de la moitié de la valeur ajoutée du secteur en 2001. Les pièces et composants
incorporés sont essentiellement importés des pays voisins, comme ce fut, dans une moindre
mesure, le cas en Thaïlande, en Indonésie ou en Malaisie quand les entreprises japonaises
commencèrent à y implanter des usines. Mais, les régions côtières de la Chine sont venues
concurrencer les NPI de la « première génération » avec les délocalisations d’activité des
dragons vers des tigres et bébé tigres. Les firmes de Hongkong et de Taiwan ont fait de
l’économie continentale leur plate-forme d’exportation des produits de haute technologie vers
l’Amérique (38%) l’Asie-Océanie (36%) vers l’Eurafrique (26%.).
D’un côté, la CNUCED 2002, constate que le niveau technologique des exportations des
PED s’élève, sous le seul effet du contenu en importation. En d’autres termes, ces pays
sont devenus d’importants exportateurs de produits manufacturés, parce qu’ils importent des
composants à plus forte valeur ajoutée (même les pays figurant en 1980, dans la catégorie à
faible revenu, exportent plus de 80% de produits manufacturés contre 20% en 1980). Dès
1994, Paul Krugman soulignait que la croissance élevée des pays du Sud Est asiatique n'était
imputable qu’à une croissance extensive, « grâce à leur transpiration et non grâce à leur
inspiration », en d’autres termes, grâce au faible niveau des salaires rapporté à la qualification.
Mais, de l’autre côté, dans le cadre de la nouvelle géographie économique, le même Paul
Krugman reconnaît que la segmentation internationale des processus productifs favorise
des effets d’apprentissage. Comme pour les fabricants de composants électroniques en
Ecosse, ou les entreprises de haute technologie dans la Silicon Valley, une partie des régions
chinoises a pu tirer parti de ces processus cumulatifs. La Chine est devenue une puissance
industrielle de premier plan, premier producteur mondial pour des produits aussi divers que
l’acier, le charbon, le ciment, les textiles et vêtements, les chaussures, les jouets, les
télévisions, les ordinateurs portables, aspirant une quantité impressionnante d‘énergie et de
matières premières (zinc, cuivre, caoutchouc, coton..). Son poids dans la production mondiale
de biens et services, a doublé depuis 1991, (13% de la production mondiale en parité de
pouvoir d’achat, en 2003, contre 15,7% pour l’UE et 21% pour les Etats-Unis). Sa croissance a
atteint un record depuis une quinzaine d’années (+9% entre 1990 et 2003, +9,7% en 2004 et
+ 17% pour les exportations). Le revenu par tête s’est élevé rapidement, alors qu’il ne
représentait que 4% de celui des pays riches en 1980, il en représentait 17% en 2000.
Les pays qui se trouvent dans un environnement régional moins porteur évoluent
différemment. La Chine, l’Inde ou la Turquie qui disposent de vastes marchés intérieurs,
étaient initialement similaires du point de vue de la structure de leurs échanges, dans les
années 1990, mais ces pays ont connu des évolutions divergentes. La Turquie, plus liée à l’UE,
19
Ces effets d’agglomération ont déjà été abordés par les théoriciens de l’économie du développement dès les années 1930, effets
de seuil pour Rosenstein Rodan, effets cumulatifs pour Myrdal, Perroux, Hirschman.
20
La géographie économique, regroupe un ensemble d’approches assez hétérogènes mais qui acceptent un certain nombre
d’hypothèses de base communes (Martin et Sunley, 2000, Krugman, Beaumont, Combes, Derycke et Jayet, 2000) :La concurrence
imparfaite, de nature oligopolistique, les interactions entre producteurs, entre producteurs et consommateurs, entre entrepreneurs et
travailleurs au sein d’un marché local sont à la base du renforcement du processus d’agglomération et/ou de la spécialisation.

pour les flux d’investissement directs
21
et pour les débouchés des exportations, reste surtout
exportatrice de textile comme l’Inde qui elle est, relativement éloignée des grands pôles du
commerce mondial. Ces deux pays ont développé des industries modernes qu’ils n’exportent
pas ( avions de combat. pour la Turquie, industrie pharmaceutique et des services
informatiques de qualité en Inde).
Pour les pays qui sont à l’écart de cette dynamique, la fracture technologique se
creuse. Si les meilleurs exemples de réussite en matière de développement sont des ports,
comme Shanghai, tournés vers les marchés mondiaux, les échecs les plus flagrants concernent
des zones rurales éloignées de la côte, ou les communautés des régions montagneuses - dans
les Andes, en Asie centrale ou les hauts plateaux d'Afrique de l'Est. L'isolement géographique
est plus fort encore, pour les pays dépourvus de littoral, comme la Bolivie, l'Afghanistan,
l'Ethiopie et le Burkina. La mondialisation comme le dit Krugman n’est pas coupable
22
, c’est
également ce que dit Cohen, ce serait au contraire, pour certains pays, leur exclusion de la
mondialisation qui serait la source de la pauvreté. Une partie des pays en développement serait
exclue des bénéfices potentiels de cette seconde mondialisation.
Ainsi, selon cette approche optimiste, on assisterait à une complexification des relations Nord-
SUD et SUD-SUD, mais, par un jeu de vases communicants, avec un siècle de retard, la
seconde mondialisation conduirait à une possibilité de multiplication par cinq des revenus des
pays en développement. Toutefois, la mondialisation actuelle est trois fois plus immobile que la
première pendant laquelle la migration des hommes représentait en 1913, près de 10 % de la
population mondiale selon D. Cohen, avec des flux de travailleurs vers les USA, l’Australie, la
Nouvelle Zélande.
La montée des inégalités, une nouvelle contrainte du développement ?
La réévaluation du rôle de l’Etat et l’intégration à l’économie mondiale par le haut
Pierre-Noël Giraud
23
a critiqué la vision étroite de la mondialisation de D. Cohen qui reste
limitée au commerce international. La globalisation est un phénomène à double tranchant sur
le plan international, elle permet à certains pays d’entrer dans un processus rapide de
rattrapage, grâce à leur faible coût de main d’œuvre, ce qui constitue son côté positif. Sur le
plan interne, elle génère un creusement des inégalités entre ceux qui sont capables de
profiter de cette globalisation en restant parmi les plus compétitifs et ceux qui sont écartés en
chemin. Certains pays peuvent, grâce au décloisonnement des frontières et des échanges,
connaître une croissance plus rapide que s’ils avaient, par exemple, fait le choix d’un
développement autocentré, mais, ils sont dans le même temps, confrontés au fait qu’une partie
seulement de leur population en profite, alors que l’autre est frappée par le chômage et subit
une pression permanente sur ses revenus. Les richesses peuvent s’afficher sur les écrans, mais,
les attentes et les impatiences se modifient.
« Mirages et miracles » éphémères, comme l’écrivait Lipietz il y a 20 ans, peuvent être
réinterprétés. Un miracle, au sens théologique, c’est un phénomène sans cause, à tout le
moins, sans cause explicable. On peut seulement constater la diversité de la combinaison
de l’ouverture et l’intervention économique de l’Etat. Le modèle japonais de Kaname
Akamatsu, défini en 1935-1937, montrait pour l’observateur au sol, un cycle du développement
industriel, superposant comme les ailes des oies en formation de vol, un renouvellement des
biens importés et des biens produits et exportés avec l’insertion dans les échanges
internationaux
24
. Mais, ce modèle négligeait d’autres dimensions du développement, par
exemple, la réforme des structures agraires qui agissent dans la réduction des
tensions inégalitaires. Si, à la demande du Japon, en 1993, la Banque mondiale a reconnu le
rôle de l’Etat dans la réussite asiatique, la qualité des institutions et leur capacité à résister à un
environnement déstabilisant (résilience), n’apparaissent que beaucoup plus récemment, comme
21
En 2001, 66% du stock d’IDE est européen, 85% des exportations turques sont destinés à l’Europe dont 58% à l’Europe
occidentale
22
Titre de l’ouvrage de P.Krugman, La découverte, 2000.
23
Pierre-Noël Giraud, "L'inégalité du monde .Economie du monde contemporain", Folio - Actuel, Gallimard, 1996
24
Un pays commençait par exporter des matières premières et échangeait peu les pays voisins dont les structures économiques
étaient comparables. Il évoluait progressivement vers la production nationale de biens de consommation éventuellement
découragée par des mesures protectionnistes, puis les producteurs locaux s’attaquaient aux marchés des pays voisins et aux biens
d’équipement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%