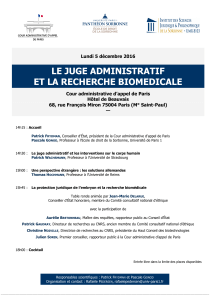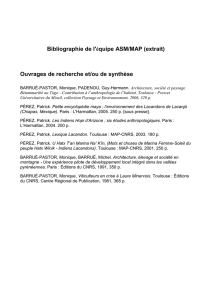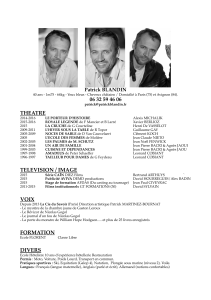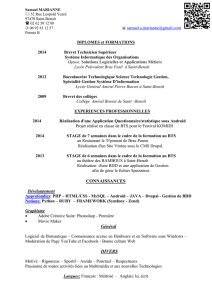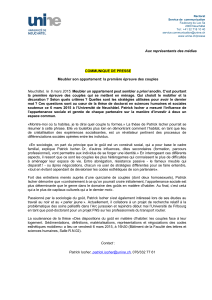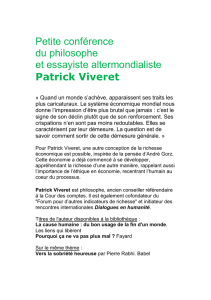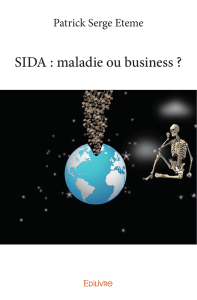Voir le dossier pédagogique

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Canons
de Patrick Bouvet
projet et mise en scène de
Constance Larrieu et Richard Dubelski
du mardi 27 au vendredi 30 mars 2011
Création
Dossier pédagogique réalisé par Rénilde Gérardin, professeur du service éducatif :
[email protected], sur des conseils de Constance Larrieu
Contacts relations publiques : Margot Linard : m.linard@lacomediedereims.fr
Jérôme Pique : j.pique@lacomediedereims.fr

2
de Patrick Bouvet
projet et mise en scène Constance Larrieu et Richard Dubelski
avec
Fanny Fezans
Stéfany Ganachaud
Constance Larrieu
vidéo Jonathan Michel
musique Richard Dubelski
production Comédie de Reims
sommaire
LE PROJET ARTISTIQUE
Notes d’intention
Entretien avec Constance Larrieu
Photographies des répétitions
Pour aborder les trois « femmes-personnages »
La femme contemporaine lectrice de magazines
La jeune actrice
La performeuse
page 3
page 5
page 11
page 9
page 12
page 15
page 15
CANONS
de Patrick Bouvet
Biographie de Patrick Bouvet par Patrick Bouvet
Entretien avec Patrick Bouvet
Extraits de
Canons
Histoire des arts L’Art performance
Marina Abramovic
Matthew Barney
page 17
page 18
page 23
page 25
page 25
page 26
L’EQUIPE ARTISTIQUE
page 27
Bibliographie, Vidéographie, Sitographie, Discographie
page 31

3
LE PROJET ARTISTIQUE
Notes d’intention
Ce qui nous intéresse chez Patrick Bouvet c’est cette langue musicale, particulièrement rythmique,
construite comme une succession de séquences sonores qui seraient entendues une première fois
dans le bon ordre, et ensuite coupées et montées différemment afin de créer des sens nouveaux.
Ensuite au-delà de la langue, il y a bien sûr les figures contemporaines qu’elle expose, à travers
lesquelles les medias jouent un rôle important en mettant en scène le présent, comme pour
radiographier notre temps.
Notre projet s’articulera autour du recueil
Canons
, dans lequel on trouve trois femmes aux prises
avec les canons de la beauté, se demandant comment s’y prendre pour exister. Soumises ou
rebelles ? Elles savent que l’apparence a toujours le dernier mot.
La femme contemporaine, lectrice de magazines, est confrontée au paraître de notre temps, aux
méthodes de développement personnel et à la construction de soi-même par les autres. Elle se
construit une identité par procuration sans réaliser qu’elle ne parle pas réellement et singulièrement,
mais que ça parle à travers elle, puisqu’elle régurgite sans cesse des slogans publicitaires et des
conseils de coaching inadaptés à son propre corps.
La jeune actrice se raconte de l’intérieur et nous confesse ses difficultés à vivre en étant toujours
exposée aux yeux du monde. Malgré son discours fortement nourri des clichés du métier et de ce
qu’il peut avoir de superficiel et de rebutant, nous souhaiterions la prendre au sérieux et lui trouver
également une vraie crédibilité, aussi pour transmettre un point de vue critique sur notre propre
métier, qui n’a souvent rien à voir dans la réalité avec l’image qu’en donnent les médias !
La performeuse, troisième femme de Canons, utilise son corps comme matériau, comme champ de
bataille parfois, mais aussi comme toile reflétant sa vision du monde. Elle donne à voir des vidéos
d’elle-même dans lesquelles son corps devient un objet qu’elle expose, manipule, met en scène afin
de transmettre des messages politiques, placarder des informations et clamer son identité. Elle joue
également avec sa présence sur le plateau en temps réel puisque tout l’intérêt de ses interventions
réside dans l’importance d’exploiter divers modes d’expression pour atteindre, déranger et
questionner le public. Nous travaillerons donc à partir de propositions qui seront parfois liées à ses
propres vidéos projetées au dessus d’elle sur un écran vertical prolongeant son corps, parfois
différentes et constitutives d’autres performances réalisées dans l’instant du spectacle et pour le
public. Nous ne sommes pas sans ignorer l’histoire de la performance au sens large du terme,

4
Patrick Bouvet non plus et conscients de tous les clichés que cela peut véhiculer au théâtre, nous
nous nourrirons donc - avec distance et humour - d’images, de références éventuelles (Marina
Abramovic, Matthew Barney, La Ribot…) pour mieux comprendre cet archétype de femme moderne
que représente la performeuse.
Ces trois récits de femmes aux prises avec leur être et leur corps ne s’alterneront pas comme trois
monologues, mais « dialogueront » entre eux. Le dispositif sera frontal et assez simple : un espace
pour chaque femme, mais qui constituera une sorte d’à plat à première vue, (comme une double
page de magazine), pour le public qui sera directement confronté à ces femmes puisqu’il n’y aura
pas de quatrième mur. Ceci permettra donc au spectateur d’avoir une vision linéaire (un monologue,
un espace sur lequel focaliser) mais également une vision parallèle qui mettra en relation chaque
femme l’une par rapport à l’autre. Nous chercherons, par exemple, comment l’actrice peut être dans
une action corporelle liée à son parcours pendant que la lectrice de magazines se livre, afin de
trouver ce dialogue des corps et des mots sans pour autant se priver de mettre également du corps
dans les mots.
Ainsi les thèmes inhérents à chaque femme seront développés et exploités au plateau de façon à
créer du lien avec les autres discours, à inventer du jeu dans un espace défini et isolé pour chacune,
mais permettant une polyphonie de gestes, une sorte de hors-champ mais à vue pour celle qui ne
parle pas, mettant en relief le discours de l’autre, cherchant à lui faire écho.
Nous envisagerons les corps des comédiennes comme un seul corps musical, par un travail gestuel
de réponses possible entre elles, de motifs repris, de postures communes mais réalisées dans des
temps différents ou bien encore de répétitions. Nous pensons qu’il peut être intéressant de travailler
sur une forme qui suit celle de l’écriture dans ce qu’elle explore de la contamination : d’une phrase à
l’autre, d’un motif à l’autre, d’un corps à l’autre et donc d’une femme à l’autre.
Nous poserons alors comme point de départ les questions suivantes : qu’est-ce qui se répond d’un
archétype de femme à l’autre ? Quelles similitudes entre ces femmes ? Ont-elles des aspirations
communes dictées par la société moderne ? Quel est leur lien à leur identité propre ? Se construit-on
à partir des autres ? Peut-on prendre un modèle pour exister ? C’est là encore l’idée du cliché, des
phrases toutes faites et extérieures qu’elles reprennent à leur compte pour tenter de se les approprier
et de devenir quelqu’un, soi-même ou une autre prise pour modèle. À partir de la construction
musicale de la langue de Patrick Bouvet nous souhaiterions de surcroît composer un contrepoint
musical qui serait joué sur des objets quotidiens – journaux, accessoires de maquillage, accessoires
sportifs, costumes… - faisant partie de l’environnement sonore réaliste de chacune des trois femmes
de façon à déterminer des espaces sonores différents qui ensuite pourraient coexister, voire
s’affronter. Chaque monde essaierait ainsi de cohabiter jusqu’à un éventuel « chaos sonore »
évoquant la multiplicité des informations, des voix médiatiques ou des slogans, impression que le

5
lecteur peut avoir à la lecture des textes de Patrick Bouvet. Ainsi, cette construction rythmique se
superposant au texte fera naître une musique jouée sur ces objets utilisés comme des instruments
dans laquelle l’interprète « soliste » sera son propre accompagnateur. En parallèle de cette partie
musicale plutôt « artisanale », nous souhaitons ajouter des sons concrets extérieurs à des moments
bien précis et surtout pour le personnage de la performeuse, qui créeront un effet de réel, un
environnement concret mais détaché de ce qui se passe sur le plateau, ou encore une vraie chanson
mélodique pour le personnage de l’actrice qui tente de se raconter musicalement comme cela se fait
beaucoup actuellement (nous pensons à Scarlett Johansson, Charlotte Gainsbourg …).
Pour certains moments, nous souhaiterions éventuellement aussi explorer les voix des actrices
enregistrées au préalable. Nous voudrions enfin tenter divers traitements possibles de la vidéo, qui
jouerait, en plus des séquences filmées de la performeuse comme un contrepoint, cette fois-ci visuel,
à ces trois personnages, […].
Richard Dubelski et Constance Larrieu, janvier 2011
Entretien avec Constance Larrieu
Maxime Contrepoix :
Comment as-tu découvert l’œuvre de Patrick Bouvet ?
Constance Larrieu : J’avais lu ses premiers textes :
In situ
,
Shot
et puis
Direct
qui traite du 11
septembre et qui est l’un des plus marquants. J’ai rencontré Patrick Bouvet il y à deux ans à
l’occasion d’une performance réalisée à la Comédie en partenariat avec le FRAC Champagne-
Ardenne. C’est après avoir assisté à la lecture de
Direct
que je suis allée lui parler. Je lui ai très
simplement exposé mon envie de travailler à la mise en scène d’un de ses textes:
Canons
, que
j’avais découvert par hasard deux ans plus tôt et sur lequel j’avais immédiatement eu envie de
travailler. À la suite de quoi j’ai lu toute l’œuvre de Patrick Bouvet.
Et puis j’ai décidé de lui écrire, et de fil en aiguille nous nous sommes mis à dialoguer autour de son
travail. Il a donc été très vite d’accord pour que je m’attèle à l’adaptation scénique de
Canons
.
M. C. : Qu’est-ce qui t’a donné aujourd’hui l’envie de monter ce texte ?
C. L. : C’est tout d’abord la question du rapport à la femme qui m’intéressait et l’importance qu’elle
doit attacher à son apparence, malgré elle, dans la société actuelle. C’est une chose omniprésente
dans notre vie quotidienne et dans notre métier. Comment est-il possible de ne pas rentrer dans des
rapports de séduction ou des rapports faussés par l’image que l’on a de soi, que les autres ont de
nous, que l’on a des autres ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%