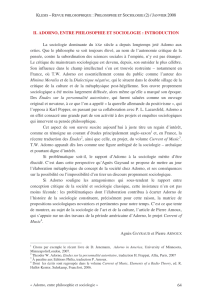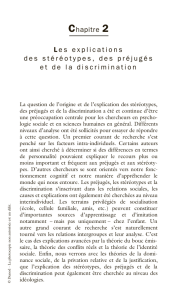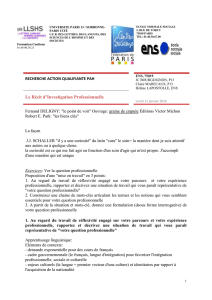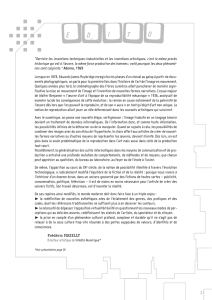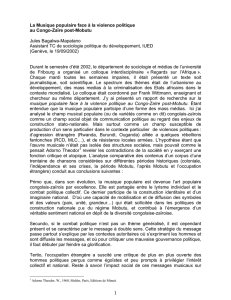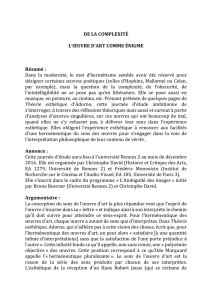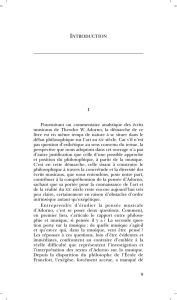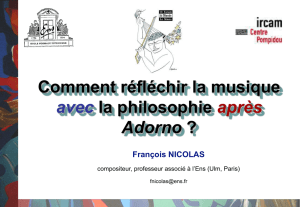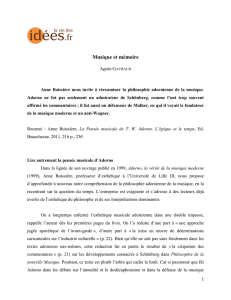Position de thèse - Université Paris

Julia Christ, Position de thèse :
Jeu et critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de Th. W. Adorno
1
Position de thèse
Titre de la thèse : Jeu et critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de Th.
W. Adorno.
Résumé : Ce travail réinterroge la philosophie sociale critique d’Adorno à partir des concepts de
règle et de jeu. Il a pour objectif d’exposer la théorie de la société d’Adorno et d’en questionner
les fondements. Ces fondements, telle est notre thèse, peuvent être conceptualisés dans un
langage propre à la sociologie de l’action si on les reformule en termes de « règles », de « suivi des
règles » et de « jeu » – concepts qu’Adorno lui-même utilise afin de décrire le social, plus
précisément la société capitaliste dans laquelle il vivait. Le fameux tout « non-vrai », qu’est la
société selon Adorno, peut ainsi être compris comme un jeu réglé par lui-même,
indépendamment de l’intentionnalité des acteurs. Cette reformulation de la philosophie sociale
d’Adorno nous permet de la faire dialoguer avec d’autres conceptions du social (Weber,
Habermas, Descombes, Searle et le structuralisme) et de montrer à quel point l’objet d’Adorno
diffère de celui de Weber, de Habermas et de Searle alors qu’il est commensurable à celui du
structuralisme. La méthode pour saisir cet objet, à savoir les règles non intentionnelles qui
structurent le jeu social, est celle de Freud (interprétation, lecture symptômale). Adorno,
toutefois, se distingue du structuralisme et aussi de Freud en ce qu’il pense pouvoir établir un lien
entre société capitaliste et le social réglé comme un jeu inaccessible aux acteurs : ce jeu est non
seulement l’objet de recherche d’Adorno mais aussi l’objet de sa critique. Notre travail s’emploie à
étayer la possibilité de cette critique qui ne vise rien de moins que les conditions de possibilité du
vivre en commun telles qu’elles ont été établies par la philosophie sociale structuraliste ainsi que
par Freud : des règles à effet inconscient qui font en sorte que tous les acteurs ne réalisent ou ne
disent pas les mêmes significations font l’objet de la critique adornienne. Critiquer ces règles
implique de montrer qu’une critique de l’institution verticale des sujets est possible sans détruire
ni poser comme absolu la subjectivité elle-même. Cette critique devient envisageable à partir du
moment où l’on examine la pratique qui est incluse dans le suivi aveugle de la règle : au sein de
cette « fausse » pratique – qu’Adorno appelle la pratique d’identification – se dégage une pratique
autre qui met en question la soumission aveugle à la règle. Cette pratique critique est également
appelée « jeu ». Notre travail se conclut sur l’exposition de cette pratique et de son potentiel
critique au sein du jeu qu’est la société capitaliste.

Julia Christ, Position de thèse :
Jeu et critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de Th. W. Adorno
2
Exposition des chapitres : Le travail présenté commence, dans le premier chapitre, par exposer la
problématique propre à la philosophie d’Adorno: selon lui, la philosophie est avant tout une
philosophie du social. La raison en est que la philosophie, si elle ne veut pas être métaphysique,
doit parler du réel et le réel auquel elle a accès est le réel symboliquement structuré, donc le social.
Même si la philosophie ne peut plus être que philosophie sociale et connaît ainsi une restriction,
elle a affaire, selon Adorno, à un objet autre que celui des sciences particulières. Cet objet est le
social compris comme totalité. Par opposition à d’autres philosophies sociales, le social n’est
donc pas compris comme un ensemble de sphères (Habermas, Honneth) ou comme un
assemblage d’actions individuelles (individualisme méthodologique).
Cette position radicale à l’égard de la complexion du social nous amène dans un premier
temps à interroger la théorie de la connaissance d’Adorno : quel est le « sujet » qui garantit l’unité
de cette totalité ? En excluant les hypothèses philosophiques traditionnelles sur le « constituant »
du tout, nous essayons de montrer que la théorie de la connaissance d’Adorno n’est nullement
idéaliste, mais matérialiste. Ceci signifie qu’il défend la thèse forte selon laquelle le social est en
lui-même une totalité : ce n’est pas la philosophie qui, de par son angle d’attaque spécifique, fait
du social un objet particulier qui constitue le « tout », c’est le social qui forme de lui-même ce
tout. Afin d’appuyer cette lecture matérialiste de la théorie adornienne, nous discutons dans ce
chapitre les possibles constituants philosophiques que la tradition philosophique a mobilisés pour
justifier la prétention de la philosophie à parler d’un tout. Il faut tout d’abord exclure un premier
constituant de ce tout si l’on veut défendre la thèse du matérialisme d’Adorno : le constituant
métaphysique, à savoir l’absolu ou Dieu. Adorno, en parlant du tout, ne présuppose pas un tel
constituant car il prédique de ce tout sa « non-vérité », alors que l’absolu, dans la tradition
philosophique, est nécessairement vrai, et ne peut donc pas constituer un tout « non-vrai ». Le
deuxième constituant qu’Adorno exclut est le sujet de connaissance : selon son analyse, le sujet
de connaissance, jusque dans ses opérations logiques, est lui-même constitué par les pratiques
sociales, si bien que ni le sujet catégoriel transcendantal (Kant) ni le cogito logique (Husserl) ne
peuvent être mobilisés afin de justifier le discours philosophique sur le tout ; ce dernier est
objectivement là, et n’est pas le résultat des opérations inévitables d’un quelconque sujet de
connaissance transcendantalisé. A partir de ce constat nous discutons une troisième possibilité de
penser un tout structuré : la théorie d’action dans sa variante wébérienne. Pour Weber l’objet de
la sociologie est une totalité, bien qu’il ne défende pas la thèse que cette totalité corresponde au
tout réel. Toutefois l’approche wébérienne est importante parce qu’elle explicite les présupposés

Julia Christ, Position de thèse :
Jeu et critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de Th. W. Adorno
3
de toute théorie de l’action. Weber ne peut parler d’une entité structurée – donc de ce social qui
est l’objet de sa sociologie – qu’en présupposant que les acteurs sociaux ont conscience des règles
qu’ils suivent dans leur agir social et qui ont pour effet que le social est une entité particulière que
la sociologie peut saisir. Or, dans la théorie wébérienne, les règles constitutives de l’objet de la
sociologie sont poursuivies de manière intentionnelle par les acteurs. Adorno récuse cette thèse
sur les règles constitutives : s’il y a structuration objective du social, cette structure ne peut pas
être expliquée à partir des intentions des acteurs. Par la suite nous montrons que Habermas, qui
reprend la méthode et, ce faisant, l’objet wébérien, tout en spécifiant le concept de règle – la règle
devient chez Habermas une « raison » de l’agir – n’a précisément pas le même objet qu’Adorno,
ce qui nous permet d’émettre l’hypothèse que les divergences entre la première et la deuxième
École de Francfort se situent à ce niveau basique : les deux générations ne parlent pas du même
objet.
Il s’agit pour nous dans la suite de notre thèse de montrer que l’objet d’Adorno
correspond au réel social et n’est pas, comme le prétend Habermas en particulier, un objet
métaphysique. A cette fin, il faut d’abord spécifier comment l’objet d’Adorno est constitué. Après
avoir exclu quatre concepts pouvant le spécifier (l’absolu, le sujet de connaissance, l’acteur social
intentionnel et l’acteur social intentionnel rationnel), nous parvenons à la définition suivante de
cet objet : en parlant du social comme d’un tout, Adorno se réfère à des structures non-
intentionnelles du réel. Ces structures constituent l’objet « tout » qui est le sien.
Dans le deuxième chapitre de notre travail, nous essayons de montrer que le concept d’un
réel constitué par des règles non-intentionnelles, donc inaccessibles aux acteurs eux-mêmes, n’a
pas nécessairement besoin de faire appel à une conception métaphysique pour se justifier. Cette
conceptualisation du réel se retrouve dans deux autres types de philosophie. Elle apparaît
également, d’une part, dans la philosophie sociale analytique (Searle, Descombes, Brandom) qui
analyse les règles du langage comme étant ce qui structure de manière non-intentionnelle l’agir
des individus et fait en sorte que le social soit un tout. D’autre part, il ne semble pas
problématique de parler de règles non-intentionnelles structurant le social si l’on adopte la
perspective du structuralisme : ce dernier s’appuie également sur la thèse selon laquelle la
normativité propre au social, soit cette normativité qui fait en sorte qu’on puisse parler du social
comme d’une entité, s’effectue de manière non-intentionnelle dans le dire et faire des acteurs.
Prétendre que de telles règles existent implique dans les deux cas que la normativité du social
n’est pas le fait des acteurs (le produit d’un consensus entre eux) mais précède tout consensus

Julia Christ, Position de thèse :
Jeu et critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de Th. W. Adorno
4
normatif et moral conscient. Voilà qui devient particulièrement évident si l’on se concentre sur le
phénomène « langage » : le langage précède sans aucun doute les actes de parole des individus : ce
ne sont pas les individus qui, par la discussion entre eux, établissent les règles du langage ; tout
simplement parce qu’ils ont besoin d’un langage commun pour s’entendre sur l’établissement de
n’importe quelle règle. Les deux courants de pensée susmentionnés, notamment par leurs
analyses du langage comme « fait social total » (Mauss), parviennent ainsi à montrer que ce qui
fait du social un tout, ce sont des règles que les acteurs suivent toujours déjà sans s’en apercevoir.
Par là, ils n’émettent pas seulement une hypothèse méthodologique justifiant comment – en ce
temps post-métaphysique qui est le nôtre – on peut encore parler du social comme d’un tout ;
mais ils montrent surtout que le social n’est compréhensible que si on le conçoit d’abord comme
un tout à partir duquel dérive l’individu. On ne pourrait parler de social si les individus ne
faisaient pas, avant toute concertation, déjà la même chose ; s’ils ne suivaient pas les mêmes règles
« grammaticales ».
Ainsi il devient possible de déplacer la question de savoir qui ou quoi constitue le tout
vers la question de savoir quelle est la grammaire du social que les acteurs effectuent toujours
déjà. Ce déplacement nous semble d’autant plus justifié qu’Adorno lui-même détermine son objet
propre, donc le tout, comme étant un texte ; la tâche de la philosophe serait, encore selon
Adorno, de lire ce texte. Sachant que ce texte existe lui-même seulement de manière fragmentaire,
la tâche de la philosophie est donc de reconstruire les règles qui font en sorte que ce texte, malgré
son éclatement manifeste, fait sens. Si l’on prend au sérieux la thèse du caractère fragmentaire du
texte, il devient évident que la philosophie d’Adorno non seulement parle d’une totalité que serait
le social, mais considère aussi les actions et actes de paroles des acteurs comme des propositions
simples qui réalisent, chacune pour soi mais en connexion avec les autres « fragments », la
grammaire du social : dans ces actes se manifestent donc à chaque fois en partie les règles que la
philosophie doit reconstruire. La question est désormais de savoir par quelle méthode elle peut
les reconstruire.
Le troisième chapitre affronte cette question de la méthode. Il porte sur Freud dont la
méthode d’interprétation est le modèle de la méthode de lecture adornienne. Nous explicitons
dans un premier temps cette méthode, qui, afin de reconstruire les règles du social, s’appuie sur
ce qui est interdit dans le réel. La méthode freudienne ne fonctionne, en effet, qu’à partir de
l’hypothèse que les règles du social ne prescrivent pas ce qu’il faut faire, mais ce qu’il ne faut pas
faire. Le matériau de Freud est formé des lacunes du réel, de ces moments où un individu ne fait

Julia Christ, Position de thèse :
Jeu et critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de Th. W. Adorno
5
pas ou ne dit pas quelque chose. Comme Adorno se sert de cette méthode, nous parvenons à
déterminer plus clairement la figure exacte des règles dont il parle : grâce à l’étude de Freud nous
pouvons affirmer que les règles qu’Adorno cherche à reconstruire sont des règles qui déterminent
ce que les individus ne peuvent pas dire et faire. Ce sont les lacunes que l’on remarque dans les
discours et les actions des individus qui nous renseignent sur les règles structurant le social.
Ce déplacement vers la manifestation négative de l’universel nous permet également de
dégager l’espace de jeu dont disposent les individus dans le social : des règles qui ne prescrivent
pas ce qui est à faire, mais interdisent seulement certaines actions et significations, donnent en
effet un espace de jeu assez considérable aux individus ; Adorno, en se servant de Freud, échappe
ainsi au reproche d’avoir une conception déterministe du social et de l’agir individuel : les règles
n’obligent pas les individus à faire des choses, mais uniquement à éviter de réaliser, par leurs actes
ou leurs paroles, certaines significations. L’agir social peut ainsi être défini comme régi par une
finalité sans fin : comme un jeu dont les règles ne sont pas accessible aux individus, mais un jeu
qui ne prédétermine pas les possibles actions.
Après avoir constaté cette complexion très spécifique de l’universel dont parle Adorno
nous passons à la théorie freudienne de la socialisation qui explique comment ces règles
universelles s’installent dans les individus. Puisqu’Adorno se sert de la méthode freudienne
d’interprétation pour reconstruire la structuration du réel, il doit également adopter la théorie de
la socialisation de Freud qui seule peut justifier une méthode d’interprétation étudiant les faits et
les gestes des acteurs dans ce qu’ils évitent comme étant des manifestations des règles du social.
Après avoir retracé la théorie freudienne de la socialisation qui explique comment les individus
adoptent des règles par crainte d’être exclus du réel s’ils ne suivent pas ces règles, nous examinons
la position d’Adorno à l’égard de cette théorie de la socialisation. Cette dernière, en effet,
présuppose que l’individu ne peut pas ne pas suivre aveuglément les règles de l’interdit sous peine
d’être exclu du réel. Pour Adorno, Freud sert à montrer que la non-intentionnalité qui règne dans
la production et la reproduction du tout est le résultat d’une socialisation spécifique des individus :
une socialisation qui les rend coupables s’ils ne suivent pas les règles. Adorno, en qualifiant un tel
tout de non-vrai, le transforme en l’objet de sa critique. Or, cela pose un problème important, car
vouloir critiquer la théorie de la socialisation de Freud suppose de critiquer l’institution verticale
de la subjectivité. La théorie critique d’Adorno devient ainsi une critique de l’assujettissement des
individus et doit présupposer qu’une autre formation de la subjectivité que celle qui passe par
l’identification aveugle avec la règle est possible.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%