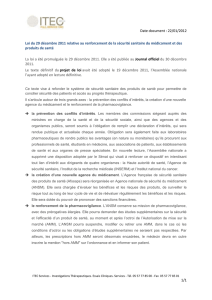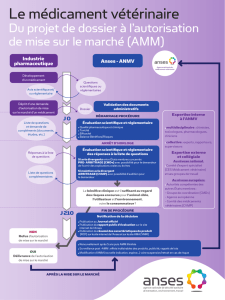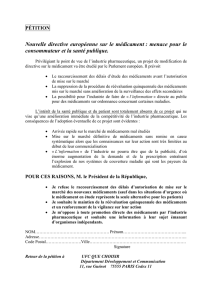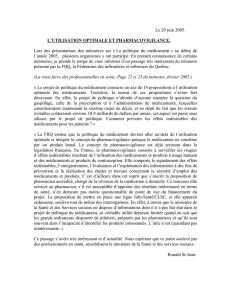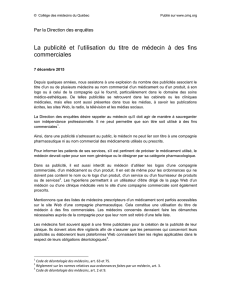Rapport bénéfi ce-risque : plus facile à défi nir qu`à estimer !

Éditorial
Éditorial
Directeur de la publication
Claudie Damour-Terrasson
Rédacteur en chef
M. Komajda
Rédacteur en chef adjoint
C. Bauters
Rédactrice en chef adjointe (congrès)
N. Baubion
Comité de rédaction
C. Adams - M.C. Aumont - J.P. Batisse
N. Danchin - B. Gallet - X. Girerd
G. Helft - P. Jauffrion - S. Kownator - C. Leclercq
C. Le Feuvre - J.P. Metzger - D. Thomas
Conseiller scientifique : Pr A. Vacheron
Conseil de rédaction
É. Bruckert - J.P. Charliaguet - A. Cohen-Solal
F. Delahaye - P. Gibelin - T. Lavergne
G. Montalescot - R. Roudaut - C. Sebag
Comité de lecture
Prs J.P. Bassand (Besançon) - M. Bertrand (Lille)
M. Bory (Marseille) - M. Brochier (Tours) - J.C. Daubert (Rennes)
J. Delaye (Lyon) - Y. Grosgogeat (Paris)
L. Guize (Paris) - P.G. Hugenholtz (Oosterbeek - Pays-Bas)
H. Kulbertus (Liège) - R. Leighton (Savannah - États-Unis)
J. Lekieffre (Lille) - S. Levy (Marseille) - A. Maseri (Londres)
G. Nicolas (Nantes) - M. Salvador (Toulouse)
Fondateur : Alexandre Blondeau
Société éditrice : EDIMARK SAS
Président-directeur général
Claudie Damour-Terrasson
Rédaction
Directeur délégué de la rédaction : Béatrice Hacquard-Siourd
Secrétaire générale de rédaction : Magali Pelleau
Secrétaire de rédaction : Lauriane Noury
Rédactrices-réviseuses : Cécile Clerc, Sylvie Duverger,
Muriel Lejeune, Catherine Mathis, Odile Prébin
Infographie
Premier rédacteur graphiste : Didier Arnoult
Responsable technique : Virginie Malicot
Rédactrices graphistes : Mathilde Aimée,
Christine Brianchon, Cécile Chassériau, Catherine Rousset
Dessinateurs d'exécution : Stéphanie Dairain,
Antoine Palacio
Commercial
Directeur du développement commercial :
Sophia Huleux-Netchevitch
Directeur des ventes : Chantal Géribi
Directeur d’unité : Nathalie Bastide
Régie publicitaire et annonces professionnelles
Vincent Le Divenach
Tél. : 01 46 67 62 92 – Fax : 01 46 67 63 10
Abonnements
Lorraine Figuière - Tél. : 01 46 67 62 74
2, rue Sainte-Marie, 92418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 10
E-mail : [email protected]
Site Internet : www.vivactis-media.com
Photos : © Elio Zoppi, © fotko, © Cameron Collingwood
Ns s d s p ité s
r p it
Ns s d s p ité s
r p it
La Lettre du Cardiologue
3
La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006
Rapport béné ce-risque :
plus facile à dé nir qu’à estimer !
Bene t-risk ratio: more easy to de ne
than to estimate !
© La Lettre du Pneumologue - Volume IX - n° 2 - mars-avril 2006
#P. Devillier*
* Hôpital Foch, UPRES EA220, Suresnes.
Le rapport bénéfi ce-risque est littéralement l’évaluation du rapport entre
l’amélioration de santé que peut apporter un médicament et les risques
d’eff ets indésirables liés à son mécanisme d’action, ou plus rarement, d’ef-
fets toxiques directs ou indirects indépendants de son activité (hépatotoxicité, aller-
gie à l’un des constituants, etc.). La sécurité d’utilisation eff ective du médicament ne
dépend pas uniquement d’un équilibre bénéfi ce-risque correctement évalué, mais
résulte aussi de la manière dont il est prescrit et utilisé. En eff et, ce rapport initiale-
ment établi par l’industrie pharmaceutique lors des diff érentes phases du dévelop-
pement du médicament a été évalué comme favorable par les autorités de santé
lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le contexte
précis du respect des indications, des précautions d’emploi, des contre-indications
et des interactions médicamenteuses.
M L’évaluation du rapport bénéfice-risque global d’un traitement médicamenteux
doit prendre en compte le rapport bénéfice-risque de chacun des médicaments
prescrits, parfois pour des pathologies différentes, les éventuelles interactions
positives ou négatives entre ces médicaments, sans oublier les facteurs liés au patient
lui-même : âge, sévérité de sa ou ses pathologie(s), observance et, dans un avenir
pas si lointain, marqueurs génétiques de réponse ou de risques médicamenteux.
M L’évaluation du rapport bénéfice-risque ne se limite pas aux traitements
médicamenteux. Elle doit s’appliquer à tout acte thérapeutique, aussi bien pour des
dispositifs médicaux (pose de stents, etc.) que pour des gestes invasifs diagnostiques
ou thérapeutiques (endoscopie, etc.). Le rapport bénéfice-risque de toute prise en
charge thérapeutique dépend en bonne partie de la gravité et du pronostic de la
maladie à traiter. Il doit être d’autant plus élevé que la maladie est bénigne.
La notion de risque lié à une prise en charge thérapeutique implique une information
du patient en l’état des connaissances afin qu’il puisse accepter le risque en regard
de l’amélioration de santé qu’il peut escompter. On voit bien que le rapport
bénéfice-risque n’est pas apprécié dans le même contexte, ni sur les mêmes bases,
par l’industrie pharmaceutique, les autorités de santé, le médecin et le patient.
RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
M Le rapport bénéfice-risque est le crédo des responsables du développement, aussi
bien préclinique que clinique. Les différentes étapes du développement ont été
structurées pour s’assurer, dans l’état actuel des connaissances, que les avantages
procurés par le médicament candidat à l’AMM l’emportent sur les inconvénients
liés à ses effets indésirables. L’évaluation du risque d’effet indésirable est l’un des
éléments clés des décisions de sélection, mais aussi d’arrêt du développement

Éditorial
Éditorial
4
>>>
La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006
d’une molécule. La mission des chercheurs et des développeurs
industriels n’est pas tant de supprimer les risques que d’en
prendre la mesure. En effet, le risque ne pouvant être, par nature,
totalement éliminé, la quête du risque zéro est non seulement
illusoire, mais susceptible de freiner l’innovation.
M Les études cliniques multiples conduites en vue de l’obtention de
l’AMM doivent démontrer un rapport bénéfice-risque supérieur
à celui du placebo, au moins non inférieur à un médicament de
référence dans l’indication revendiquée et, au mieux, meilleur
que ce dernier. Elles doivent suivre les recommandations publiées
par les agences d’enregistrement des médicaments (Food
and Drug Administration [FDA], European Agency for the
Evaluation of Medicinal products [EMEA]), même si les critères
indiqués par ces agences n’apparaissent pas toujours comme
les plus pertinents. L’expérience acquise lors de ces études reste
limitée à une population sélectionnée sur des critères d’inclusion
et d’exclusion rigoureux et caractérisée par la bonne observance
du traitement testé et, pour ce qui concerne les médicaments
inhalés, par une technique d’inhalation appropriée. Cette
population homogène représente une part relativement faible
des malades ciblés par l’indication thérapeutique. Ainsi, seuls
5 % des patients asthmatiques et 7 % des patients BPCO
répondent aux critères d’inclusion et d’exclusion des études
cliniques réalisées par l’industrie pharmaceutique (1). Ces
critères de sélection nécessaires à une évaluation rigoureuse
et réglementaire du rapport bénéfice-risque reflètent mal
les conditions habituelles de prescription et d’usage des
médicaments et soulignent les limites méthodologiques et les
sources de distorsion de son évaluation au moment de l’AMM.
En outre, les études comparatives du rapport bénéfice-risque vis-
à-vis de médicaments concurrents sont, à ce stade, en nombre
limité, souvent fondées sur des critères intermédiaires d’efficacité
et de tolérance dont les sensibilités respectives peuvent influer
sur le résultat et dont la pertinence clinique est naturellement
discutable. Enfin, l’amplitude de variation de ces critères peut
être sensiblement modifiée par la sévérité de la maladie. En
effet, le rapport bénéfice-risque n’est pas constant sur l’échelle
de sévérité de la pathologie concernée. Il apparaît clairement
qu’au moment de l’AMM, il est évalué dans le strict respect du
bon usage du médicament, de façon certes rigoureuse, mais sur
un nombre relativement restreint de patients sélectionnés.
M En termes de logique d’entreprise, la gestion du risque doit
conduire à protéger et à améliorer la valeur de l’entreprise de
manière rentable et durable. Le retrait du marché pour effet
indésirable rare, parfois lié à une susceptibilité individuelle ou à
des interactions médicamenteuses, montre que tous les risques
ne peuvent être connus ou correctement appréciés au moment
de l’octroi de l’AMM. Une telle décision prise par le fabricant
ou par les autorités de santé peut mettre en péril la pérennité
de l’entreprise, non seulement du fait de la diminution parfois
importante du chiffre d’affaires mais aussi en raison du coût
croissant de la judiciarisation des affaires d’indemnisation des
dommages liés aux effets indésirables graves médicamenteux.
On comprend aisément que les laboratoires pharmaceutiques
essayent de se prémunir au mieux contre de telles éventualités,
dont certaines ont été largement médiatisées, mais restent fort
heureusement exceptionnelles : isoméride (HTAP), Tasmar
®
(hépatite fulminante), Staltor
®
(rhabdomyolyse), Vioxx
®
(accidents cardiovasculaires), Bextra
®
(syndrome de Stevens-
Johnson) et, tout récemment, Exanta
®
(hépatite fulminante).
C’est la pharmacovigilance, à laquelle participent les entreprises
du médicament et les autorités sanitaires, qui assure la gestion
du risque après commercialisation par le recueil et l’analyse des
effets indésirables, en conditions réelles d’utilisation.
RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE VU
PAR LES AUTORITÉS DE SANTÉ
M Les trois missions principales de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de Santé (Afssaps) définies par son
directeur général (Monsieur Marimbert) consistent à évaluer
si le produit découvert par un laboratoire pharmaceutique a
plus d’avantages que d’inconvénients avant de le mettre sur le
marché, à accompagner la mise sur le marché d’informations
susceptibles d’aider les professionnels de santé dans le meilleur
usage possible du médicament et d’éclairer les consommateurs
(notice, boîte) et, bien sûr, à contrôler que la sécurité d’emploi
des produits, supposée pendant la phase d’évaluation, se vérifie
bien en pratique. Pour atteindre ces objectifs, les autorités
de santé françaises prennent l’avis consultatif d’un certain
nombre d’experts réunis en commissions : Commission d’AMM
des médicaments à usage humain, Commission nationale
de pharmacovigilance, Commission de la transparence et
Commission de contrôle de la publicité et du bon usage du
médicament. Ces commissions procèdent à des évaluations
réglementaires qui précèdent, encadrent et suivent la mise
sur le marché des médicaments. Après l’évaluation initiale
favorable de son rapport bénéfice-risque ayant conduit à sa
commercialisation sous certaines conditions, le médicament
fait ainsi l’objet de constantes réévaluations du rapport
bénéfice-risque.
M La rigueur et la technicité de l’évaluation du médicament, qui
confinent parfois à la rigidité, limitent la capacité à estimer un
rapport bénéfice-risque transposable à la pratique médicale et,
à tout le moins, la population cible de malades pour laquelle
ce rapport serait optimal lors de l’examen du dossier d’AMM.
Ces difficultés impactent non seulement la décision d’octroi
d’une AMM mais aussi le remboursement et le niveau de prise
en charge. Les effets d’un médicament doivent être évalués en
permanence puisqu’ils ne sont pas cernés une fois pour toutes
lors de l’AMM. La découverte d’un risque supplémentaire ou

Éditorial
Éditorial
6
>>>
La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006
la réévaluation d’un risque connu sur la base de l’expérience
de l’utilisation dans la “vie réelle” ne traduisent pas, dans la
majorité des cas, une “faute” dans le dispositif d’évaluation du
médicament. En revanche, la connaissance et le respect des
règles de bon usage du médicament sont indispensables pour
assurer au patient un niveau de sécurité et d’efficacité le plus
proche de celui ayant conduit à sa commercialisation.
M Par ailleurs, la mise en place de plans de gestion des risques
post-AMM, une pharmacovigilance renforcée et enrichie par des
études pharmaco-épidémiologiques, le contrôle de la publicité,
pour limiter toute dérive d’utilisation du médicament vers un
élargissement des cibles thérapeutiques pouvant exacerber
des risques ou mener à des usages sans garantie solide,
sont autant de moyens gérés conjointement par l’industrie
pharmaceutique et les autorités de santé pour s’assurer,
surtout pendant les premières années de commercialisation,
que le rapport bénéfice-risque reste favorable.
RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE VU PAR LES MÉDECINS
M Le mot “médecin” vient certes de “mederi” qui signifie “soigner,
donner des soins”, mais aussi de “med”, racine indo-européenne
qui a le sens non seulement de “prendre avec autorité des
mesures appropriées”, mais également de “juger, méditer,
réfléchir” (2). Cette réflexion consiste à peser les bénéfices
mais aussi les risques qu’une décision thérapeutique peut faire
encourir au patient. La première maxime d’un médecin doit
rester : primum non nocere.
M Il n’y a pas de pratique médicale sans prise de décision qui
confronte le médecin à des choix pour son patient. Certains
auteurs soulignent à juste titre que l’innocuité des nouveaux
médicaments ne peut être connue avec certitude qu’une fois ceux-
ci mis sur le marché depuis plusieurs années, et recommandent
aux médecins d’éviter de prescrire des médicaments
nouveaux lorsque des médicaments plus anciens, dotés d’une
efficacité similaire, sont passés par les fourches caudines de
la pharmacovigilance, et que d’éventuels risques rares ont été
débusqués par le volume de prescription (3). Cette attitude relève
du bon sens pour les patients chez lesquels l’efficacité obtenue
avec ces médicaments anciens est satisfaisante. Compte tenu de
la faible fréquence des effets indésirables graves non prévisibles,
cette position doit être nuancée si un meilleur rapport bénéfice-
risque peut être escompté avec ces nouveaux médicaments, du
fait notamment des spécificités du patient (4). Il est important
de souligner que cette estimation ne peut être raisonnablement
effectuée que dans le respect de l’indication, avec pour corollaire,
une démarche diagnostique appropriée.
M Les situations sont parfois complexes et rendent l’évaluation
du rapport bénéfice-risque aléatoire. Ainsi, la consommation
moyenne journalière en France s’établit à 3,6 médicaments par
personne âgée de 65 ans et plus. Or, du fait des polyinsuffisances
liées à l’âge et de l’augmentation des possibilités d’interaction
médicamenteuse liée à la multiplicité des traitements, les effets
indésirables induits par les médicaments sont deux à trois fois
plus fréquents et plus sévères chez les plus de 65 ans. Tous ne
sont pas évitables et peuvent survenir sans erreur commise
par le médecin, le pharmacien ou le malade, mais une bonne
part d’entre eux pourraient être prévenus (5). Si la formation
continue des médecins doit être assurée pour qu’ils disposent
d’une compétence actualisée sur les médicaments, il est bien
évident que cette dernière ne sera jamais exhaustive et qu’une
part d’incertitude, donc de risque, persistera, non seulement
du fait de la multiplicité des combinaisons de médicaments
qui peuvent être prescrits pour une même pathologie ou des
pathologies associées, mais aussi des susceptibilités individuelles
tant du point de vue de l’efficacité que de la tolérance, qui vont
influer sur le rapport bénéfice-risque (6-8). À cette complexité
s’en ajoute une autre, qui relève de l’organisation des soins.
Le patient souffrant de pathologies multiples est pris en
charge par son médecin omnipraticien et par les médecins
spécialistes requis par son état de santé. La multiplication des
intervenants devenue nécessaire par l’amélioration rapide
des connaissances et des techniques rend plus difficile encore
l’évaluation globale du rapport bénéfice-risque. La diffusion à
l’ensemble des acteurs médicaux d’un dossier médical actualisé
comportant au moins les informations relatives aux risques
d’interaction, aux précautions et aux contre-indications liées
aux différents traitements administrés au patient, pourrait
contribuer à préserver un rapport bénéfice-risque favorable
en évitant les erreurs découlant du manque d’information,
pour ne pas dire de l’ignorance ou de la surabondance d’une
information (info-pollution) peu exploitable. Les moyens de
communication en réseau sont de plus en plus performants et
pourraient certainement mieux s’organiser autour du malade,
en n’oubliant jamais que l’information n’est valable que si elle
est actualisée et sa source identifiée. Dans un futur proche, on
peut espérer que le développement de la pharmacogénomique
(7) et de logiciels d’aide à la prescription facilitera la démarche
du prescripteur, mais force est de constater qu’aujourd’hui il se
trouve face au patient qui attend de lui la prescription la plus
adaptée à son état de santé et une information sur les bénéfices
et les risques liés aux traitements dans l’“espace-temps” réduit
d’une consultation. La réponse apportée par le médecin relève
d’une appréciation globale du rapport bénéfice-risque qui, pour
les raisons précédemment citées, peut ne pas s’appliquer à son
patient. Si les consensus et les recommandations internationales
constituent des guides de bonne pratique, il ne faut pas
oublier qu’ils s’appuient en bonne partie sur le concept de
la médecine fondée sur les preuves, preuves apportées par
les études cliniques rigoureuses conduites en grande majorité

Éditorial
Éditorial
7
La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006
par l’industrie pharmaceutique dans le cadre réglementaire,
donc réducteur, des études à visée AMM…
RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE VU PAR LES PATIENTS
M Lors d’un débat récent sur l’avenir de la santé, les patients
ont clairement déclaré accepter les risques sous réserve d’une
information appropriée devant éviter deux écueils : l’absence
de transparence et l’excès d’information. En effet, le manque
d’information ou une mauvaise information peuvent être à
l’origine d’un mauvais usage du médicament. À ce titre, la
finalité des notices d’information sur les médicaments ne
doit pas être de protéger juridiquement le laboratoire, mais
d’offrir une information permettant son meilleur usage par
le patient. Au-delà d’une information sur le bon usage, les
patients doivent être avertis des risques d’effets indésirables
des médicaments qui leur sont proposés, mais aussi des
risques liés à l’évolution de la pathologie en l’absence de
traitement adapté. Cette information, en permanence
actualisée, doit être fournie ou rendue facilement accessible
au patient par l’industrie pharmaceutique, les autorités
de santé, et bien sûr, le médecin traitant dépositaire de la
confiance du malade. Les associations de malades doivent
aussi participer à cet effort d’information. La connaissance
des risques en regard du bénéfice de santé escompté est
un élément fondamental de la liberté de choix du patient.
Cette liberté peut s’exercer pleinement si l’information est
de qualité, donc indépendante. Il est essentiel que cette
information soit issue d’un partenariat équitable et contrôlé
entre les différents acteurs afin de limiter les conséquences
des efforts de lobbying que pourrait développer l’industrie
pharmaceutique auprès des médecins, et surtout auprès des
associations de malades (9).
M Le processus d’individualisation de la société tend à
faire passer le refus du risque personnel avant le bénéfice
collectif des avancées thérapeutiques. La victime d’un
effet indésirable grave n’est plus en mesure d’apprécier
le bénéfice du traitement et va naturellement considérer
que le seul bénéficiaire de son traitement étant l’industrie
pharmaceutique, celle-ci doit endosser le rôle du coupable.
Cette situation est évidente si le patient découvre, lors de la
survenue de l’effet indésirable, que ce dernier étant connu,
il n’en a pas été informé, ou, a fortiori, si le fabricant en
ayant connaissance avait choisi d’en différer la divulgation.
Cependant, la difficulté d’explication pour le grand public est
réelle et facilement compréhensible. Les risques sont exprimés
en termes de probabilité ou de fréquence de survenue mais,
pour le malade victime d’un effet indésirable grave, le
risque perçu est de 100 %. Les deux mots ont en effet une
connotation différente : la fréquence concerne la population,
tandis que le risque s’attache surtout à l’individu.
M Le médicament est tout sauf un produit de consommation
banal, même si, la promotion grand public de certains
médicaments ciblant des pathologies bénignes fréquentes,
l’omniprésence du médicament dans le quotidien familial et le
développement de l’automédication contribuent à estomper
ce particularisme et à occulter les risques d’effet indésirable.
L’acceptation de la prise de risque évolue selon l’histoire
personnelle de chaque malade, son vécu de la maladie et
le pronostic. Il ne serait pas éthique de refuser de mettre à
disposition des malades souffrant de maladies engageant le
pronostic vital ou de maladies rares et orphelines un nouveau
médicament ayant fait la preuve de son efficacité au seul
motif que l’on n’en mesure pas suffisamment les risques.
Globalement, les bénéfices sur la santé n’ont jamais été
plus grands pour des risques qui n’ont jamais été si petits.
Certes, notre vigilance ne doit jamais se relâcher, mais il
ne fait pas de doute que nous profitons tous aujourd’hui
des avancées majeures des cinquante dernières années
en matière de médicament. Individuellement, ces derniers
sont aujourd’hui plus sûrs qu’ils ne l’étaient hier. La
polymédication fréquente des patients après 65 ans est l’une
des causes principales d’effets indésirables par interaction
médicamenteuse. C’est probablement aujourd’hui le tribut
à payer pour l’allongement de l’espérance de vie, tribut dont
on peut raisonnablement espérer qu’il se réduira grâce à
une amélioration des connaissances et à un renforcement
de l’information des médecins et des patients. L’idéal vers
lequel nous devrions tendre est l’acceptation d’une part de
risque liée à l’ignorance proche de zéro afin que le malade ne
soit plus confronté qu’au risque lié au hasard, risque que l’on
devrait alors appeler “danger”. O
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Herland K, Akselsen JP, Skjonsberg OH, Bjermer L. How representative are
clinical study patients with asthma or COPD for a larger real life population of
patients with obstructive lung diseases? Respir Med 2005;99:11-9.
2. Devictor D. Le poids de la décision médicale. Plein Sud. Paroles de Campus.
www.u.psud.fr/Plein-Sud.nsf.
3. Lasser K, Allen PD, Woolhanler SJ, Himmelstein DU, Wolfe SM, Bor DH.
Timing of new black box warnings and withdrawals for prescription medica-
tions. JAMA 2002;287:2215-20.
4. Temple RJ, Himmel MH. Safety of newly approved drugs. Implications for
prescribing. JAMA 2002;287:2273-5.
5. Classen D. Medication safety. Moving from illusion to reality. JAMA
2003;289:1154-6.
6. Lima JJ, Zhang S, Grant A et al. Infl uence of leukotriene pathway polymor-
phisms on response to montelukast. Am J Respir Crit Care Med 2006;173:379-85.
7. Evans WE, McLeod HL. Pharmacogenomics. Drug disposition, drug targets
and side eff ects. N Engl J Med 2003;348:538-49.
8. Tantisira KG, Weiss ST. e pharmacogenetics of asthm: an update. Curr
Opin Mol er 2005;7:209-17.
9. Bégaud B. Proof, fi t and profi t. La Lettre du Pharmacologue 2000;14:172.
1
/
4
100%