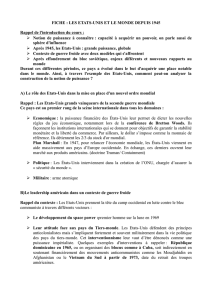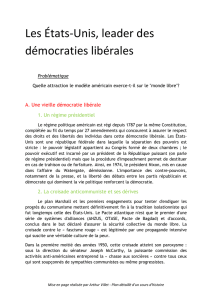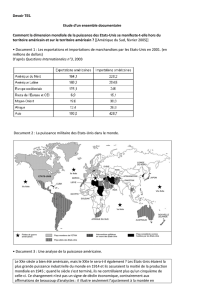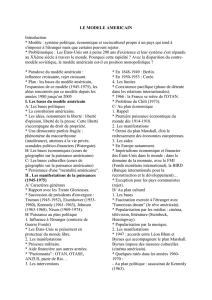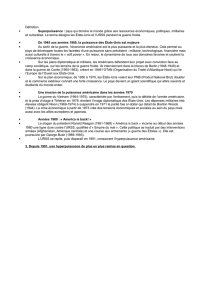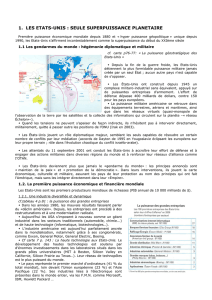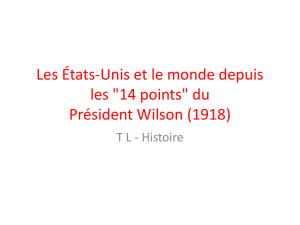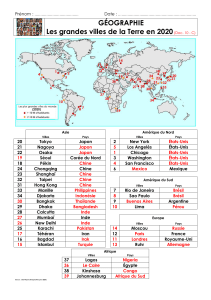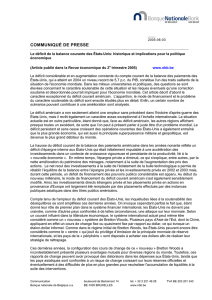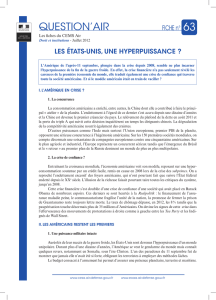CONTRE-CROISADE

CONTRE-CROISADE
Le 11 Septembre
et le retournement du monde


Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou
CONTRE-CROISADE
Le 11 Septembre
et le retournement du monde
Seconde édition, mise à jour et augmentée
Préface inédite de l’auteur

Du même auteur
Societal Transition to Democracy, Ibn Khaldoun Center for
Development Studies, Le Caire, 1995.
Iraq and the Second Gulf War – State-Building and Regime
Security, Austin and Winfield, San Francisco, 1998, seconde
édition 2002.
Understanding Al Qaeda – Changing War and Global Politics,
Pluto Press, Londres, 2011.
© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
ISBN : 978-2-296-55399-6
EAN : 9782296553996

Notre magie à nous est blanche, plus
d’hérésie possible dans l’abondance.
Nous attendons les irruptions brutales
et les désagrégations soudaines qui, de
façon…imprévisible, mais certaine…
viendront briser cette messe blanche.
Jean Baudrillard,
La Société de Consommation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%