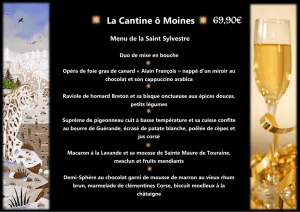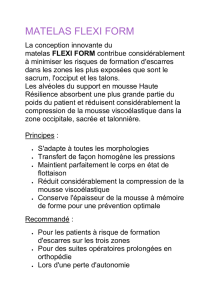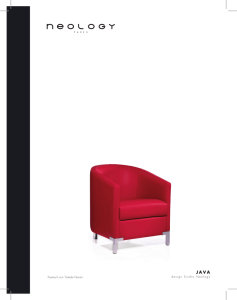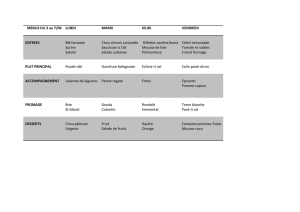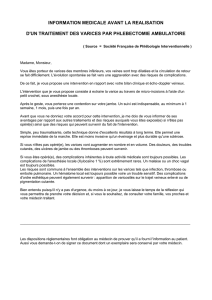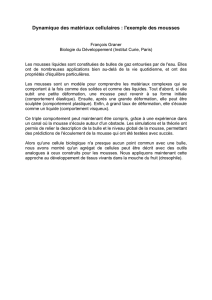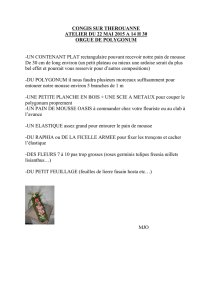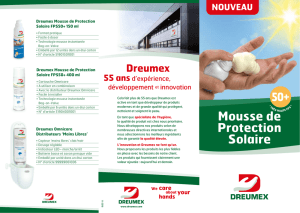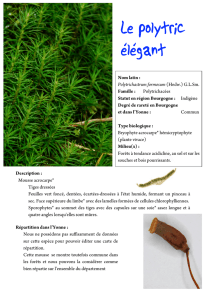Leitlinien fÌr die endovaskulÀre Behandlung von

Référentielsur le traitement endovasculaire des
varices par injections écho-guidéesdemousses
fibrosantes*
Le consensus d’expertsdeGrenoble (Version 2007)
G. Gachet1,L.Spini2
1Voiron, 2Pont de Beauvoisin, France
Mots clés
Référentiel,consensus,Grenoble,traitementsendoveineux,
mousse fibrosantes, injections échoguidées,varices
Résumé
Longtemps, la chirurgie aété le pilierdutraitement des
varicessaphènes mais l’essor destraitements endovascu-
lairesavecnotamment l’utilisation de moussesfibrosantes
aprofondémentchangé la donneenphlébologie.Face àce
bouleversement despratiques, il nous estapparu in-
dispensable d’élaborer un référentiel,définissantuncadre
scientifique et médico-légal opposable àl'HAS, L'AFSSPS,
la CNAM, l'ONM, aux associationsdemalades, assureurs,
etc.Ilfournira, pour lesconfrères désireux de se formeràla
méthode, un document de référence issudel’expérience
cumulée desauteurs et desdonnées scientifiques actual-
isées.Enfin, il permettrad’établir desréférentielsd’évalu-
ation despratiquesprofessionnelles(EPP).
Ce guide de bonnes pratiquesest le fruit du travailcollectif
d’un groupe de médecinsvasculaires pratiquantlaphlébo-
logie,issus majoritairement du club mousse de la région
Rhône-Alpesqui en estdonclepromoteur. Ce consensus a
été conçu sur le modeformalisé selon lescritères de
l’HAS.
Leschapitrestraitent de la formation,dumatériel, de la
confection de la mousse,des indications/contre-indi-
cations, desexamens écho-Döppler, desinjections, des
contrôlesaprèstraitement, de la sécurité,des comptes-ren-
dus et aspectsréglementairesnotamment de l'information
et du consentement du patient.
Phlebologie2008; 37: 149–158
Schlüsselwörter
Leitlinien, Konsens,Grenoble,endovenöse Behandlungs-
verfahren, sklerosierendeSchäume, ultraschallgeführte
Injektionen, Varizen
Zusammenfassung
Lange Zeit wardie Chirurgie das tragende Elementbei derBe-
handlungvon Saphena-Varizen, doch derAufschwung endo-
vaskulärerBehandlungsverfahreninsbesondere unterVerwen-
dungvon sklerosierenden Schaumstoffen hatdie Situation in
derPhlebologiegrundlegendverändert.Angesichtsdertiefgrei-
fendenVeränderungender Praxiserschienesunsunbedingter-
forderlich,Leitlinienzuerarbeiten,die einen wissenschaftlichen
undmedizinrechtlichen Rahmen definieren, derder oberenGe-
sundheitsbehörde HAS, derfranzösischenArzneimittelbehörde
AFSSPS,dernationalenKrankenkasseCNAM,derfranzösischen
Ärztekammer ONM, Patientenorganisationen, Versicherungs-
gesellschaften usw.entgegengestellt werdenkann. DieLeitlini-
enstellenfürdieKollegen,diesichinderMethodebildenmöch-
ten, einBezugsdokument dar, das aus derkumuliertenErfah-
rungderAutorenunddenaktualisiertenwissenschaftlichenDa-
tenresultiert.Schließlich erlauben sie, Leitlinien fürdie Evalua-
tionderprofessionellenPraxis (évaluationdespratiquesprofes-
sionnelles–EPP) zu erstellen.
Dieser Leitfadender Guten Praxis ist das Ergebnis derge-
meinsamenArbeit einer Gruppe von Gefäßmedizinern, die
auf demGebietder Phlebologietätig sindund mehrheitlich
aus demVereinMousse [Schaum] derRegion Rhône-Alpes
stammen, dersomit dessenInitiator ist.
Dieser Konsensus wurde auf systematischeArt nach denKrite-
riender oberenGesundheitsbehörde HASerstellt.Die Kapitel
behandelnAusbildung,Material,ZubereitungdesSchaums,In-
dikationen/Kontraindikationen, Ultraschall-Doppler-Unter-
suchungen, Injektionen, Kontrollennach derBehandlung, Si-
cherheit, Protokolle undregulatorischeAspekte,insbesondere
bezüglich Information undEinwilligungdes Patienten.
Leitlinien fürdie endovaskuläreBehandlung von
Varizen mittels ultraschallgeführter Injektionen
sklerosierender Schäume
Der Expertenkonsensvon Grenoble (Version 2007)
Keywords
Recommendations, consensus, Grenoble,endovenous
treatment, sclerosingfoams, echo-guidedinjections,
varicose veins
Summary
For alongtime,the basic treatment of saphenous varices
hasbeen surgicalbut the developmentofendovascular
techniquesinphlebological practice,particuliarly with the
use of sclerosingfoam, hasprofoundly changedthe situ-
ation. In theface of this radical change in practice,it
seemed essential to elucidaterecommendationsdefining
thescientificandmedicolegal backgroundofthistechnique
in response to theHAS (Haute AutoritédeSanté =Higher
HealthAuthority],the AFSSPS (Agence Française de Sécu-
rité Sanitairedes Produits de Santé =FrenchAgencyfor
Sanitary Security of HealthProducts), the CNAM (Caisse
Nationale d'Assurance Maladie =National Fundfor
HealthInsurance), the ONM(Ordre Nationaldes Médecins
=GeneralMedicalCouncil),thepatients'associations,the
insurance companies, etc.Tocolleagueswishingtolearn
this method,itprovidesatextofreferenceborn of the
cumulated experience of theauthors andofuptodate
scientificfacts.Furthermore,itwill form the basisofAssess-
mentofProfessionalPractice (APP).
Thisguideofgood practiceisthe result of the collective
work of agroup of vascularphysicians experiencedin
phlebology, mostlymembers of the FoamClub of the
Rhône-Alpes region which is thus its promoter.This con-
sensus documenthas been formulated in accordance
with the criteria used by theHAS.
Thedifferentchaptersdealwiththetraining,theequipment,the
manufacture of the foam, the indications/contra-indications,
the echo-dopplerinvestigations, theinjections, the follow-up,
the safety precautions, the reportsand the legal aspects, par-
ticularly concerninginformation andpatient consent.
Recommendations on the endovascular treatment
of varicose veins by echo-guided injections of
sclerosing foam
Grenoble consensus of experts(2007 version)
*Nachdruck aus der Phlébologie 2008 entspre-
chend der Zusammenarbeit der Deutschen,
Schweizerischen
und Französischen Gesellschaf-
ten fürPhlebologie
149
©2008 Schattauer GmbH
VerantwortlichewissenschaftlicheSchriftleiter dieserRubrik: E. Rabe,W.Blättler Phlebologie 3/2008
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2017-05-25 | IP: 88.99.165.207

Phlebologie3/2008
150
Gachet, Spini
Avant propos
Pourquoiétablir un référentiel?
Longtemps,lachirurgie aété le pilierdu
traitement desvarices saphènesmaisl’essor
destraitements endovasculairesavecno-
tamment l’utilisation de mousses fibrosan-
tes aprofondémentchangé la donne en
phlébologie. Face àcebouleversementdes
pratiques, il nous est apparu indispensable
d’élaborerunréférentiel, définissantunca-
dre médical scientifiqueimposant une vali-
dation parles instances de tutelles:HAS,
AFSSAPSetuniversité puis médico-admi-
nistratif :CNAM, …Danslemêmeordre
d’idée, il nous aégalement semblénécessai-
re de donner,par l’élaboration d’un consen-
sus, un cadre médico-légalopposable aux
instances judiciairesetjuridiques :Ordre
desmédecins,associationsdemalades, as-
sureurs,etc.Ilfournira, pour les confrères
désireux de se formeràla méthode,undo-
cument de référenceissu de l’expérience cu-
muléedes auteursetdes données scientifi-
ques actualisées. Enfin, il permettra d’étab-
lir desréférentiels d’évaluation desprati-
quesprofessionnelles (EPP).
Méthodologie
Ce guide de bonnes pratiquesest le fruit du
travail collectif d’un groupe de médecins
vasculairespratiquant la phlébologie,issus
majoritairement du club moussedelarégi-
on Rhône-Alpes qui en est donc le pro-
moteur. Ce consensusaété conçusur le mo-
de formalisé selon les critèresdel’HAS (1).
Il est basé surdenombreuxétudes et travaux
internationaux qui démontrent l’efficacité
et la sécurité de ce traitement (2–22). Il aété
soumisàdes lecteurs :universitaires, chirur-
giens vasculaires, médecins généralistes,
patients réunis en associationsetréactualisé
selon l’évolution de la technique et lesrésul-
tats desétudes scientifiques en cours. Il aété
réalisésanssourcedefinancementextérieu-
re.Les membres du groupe de pilotage ont
participé bénévolement àcetravail et décla-
rent ne pasavoir de lienfinancieravecles
industriesdudomaine.
Glossairedes abréviations
●
GVS, grande veine saphène.
●
PVS, petite veine saphène.
●
TVP, thromboseveineuseprofonde.
●
HBPM, héparine de bas-poids molécu-
laire.
●
AVK, anti-vitamine K.
CEAP,classification clinique,étiologi-
que, anatomique et physiopathologique
de la maladie veineuse.
●
CHIVA, cure conservatriceethémody-
namique de l'insuffisance veineuseen
ambulatoire.
●
IPS, index de pressions systoliques.
●
G, gauge.
●
F, french.
●
AINS, anti-inflammatoirenon stéroïdien
Historique (23)
Lespremièresinjections sclérosantes sem-
blentavoir étéréalisées àLyonpar Pravaz
dans les années 1840. En 1939, MacAus-
land prélèvel’écume d’un flacondemor-
rhuate secouéetl’injecte:c’est l’ancêtre de
la mousse. En 1946 Reiner sclérose une va-
ricepour la premièrefois avec un détergent,
le tetradecylsulfatedesodium.Cette même
année, Orbach décrivaitl’air-block, techni-
que visant àséparer le liquide sclérosant du
sang veineux pardel’air.Danscette péri-
ode, Tournay établit le schémafrançaisde
traitement desreflux de haut en bas.Apartir
desannées 80, le Döpplercontinu, l’écho-
graphie en modeB,l’écho-Döpplernoir et
blancpuis couleur révolutionnentl’explora-
tion desvarices dans un premier temps puis
le traitement dans un deuxième avec l’intro-
duction de la sclérose échoguidée parVin et
Knight en 88. En 86, Grigg confectionne
de la mousse en connectant2seringuesavec
une tubulure. Dansles années 90 Cabrera,
Monfreux,Tessari…développent et popu-
larisent les procéduresendoveineuses àla
mousse. Le conceptcommel’utilisation cli-
nique de la sclérose àlamousse ne sont donc
pasrécents.
Mode d’actionetintérêtsdela
mousse
Elle est confectionnée avec des détergents
ou tensio-actifs quivont dissoudreles phos-
pholipides de la paroi veineuse. Contraire-
mentauliquide sclérosantqui se dilue, im-
posant des injections étagées avec de fortes
concentrations, la mousse reste pure car elle
ne se mélange pas au sang et chasselacolon-
ne sanguine puisadhèreàlaparoi veineuse
en provoquant un spasmeintense. Il devient
donc possible de traiter l'intégralité d'une va-
rice en une seuleinjectionetavecune faible
concentration. Desvalves veineuses peuvent
redevenir compétentes lorsquel'hémodyna-
mique locale redevientnormale par suppres-
sion des effets siphons et surpressions lors
du traitement. Cestronçons redevenusconti-
nentsnesont donc plus àtraiter.
1/ La formation
Le maniement de la mousseest délicat et né-
cessite la connaissance de l’anatomie, de la
pratique de l’écho-Doppler(thrombose, re-
flux, cartographie, repérage desartérioles,
échomarquage,etc.),des indicationsetcon-
tre-indicationsdutraitement, du matérielà
utiliser,des conditions de sécurité àre-
specter,des méthodesdeconfection de la
mousse, desdifférentesprocéduresd’in-
jection,des contrôles àdistance, de la ges-
tion descomplications et de l’élaboration
descomptes-rendus (24).
Prérequis :maîtrisedel’écho-Doppleret
de la sclérothérapie,participation àdes ate-
liers de pratique, compagnonnage.
Comment acquériraujourd’hui cette for-
mation ?
●
la formation universitaire :capacité na-
tionaled’angiologie,DESCdemédecine
vasculaire,éventuellement complété par
un DIUdephlébologie.
●
le compagnonnage nécessitant de lister
lesmédecins expérimentésetdisposés à
accueillirles confrèresdésirant se for-
merouseperfectionner.
●
la fréquentation desateliers permet d’ap-
préhenderlatechnique et d’établirdes
contacts pour se perfectionnerensuite.
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2017-05-25 | IP: 88.99.165.207

151
Traitement endovasculaire desvarices
Phlebologie3/2008
●
la fréquentation descongrès, la consulta-
tion de bibliographie, la FMC.
En conclusion :une formation de qualité est
indispensable pour éviterles incidents et ac-
cidents qui pourraient nuireaupatient, àla
reconnaissance de la technique, àsanotorié-
té et auxmédecins la pratiquant.
2/ Materiel
Leslistesdematériels sont données àtitre
indicatif mais ne sont pasexhaustives. Elles
sont parailleurssusceptiblesd’être modi-
fiées en fonctions desinnovationstech-
niques.
A/ pour la fabricationdela
mousse :
●
un sclérosant liquide détergent:polido-
canol (lauromacrogol) à0.25%, 0.5%,
2% et 3% ou tétradécylsulfatedesodium
à1et 3% (pour information, la glycérine
chroméenemousse pas).
●
desampoulesdeNaClà0.9%.
●
de l’air, du gazcarbonique ou de l’oxy-
gène stérile.
●
desseringuesàusage unique (les serin-
gues en verresont proscrites)de2ml, 2.5
ml, 3ml, 5ml, 10 ml et 20 ml à3corps
(Térumo
®
,BD
®
ou Braun
®
)ouà2
corps(Discardit
®
).
●
un connecteurLuerLockfemelle-femel-
le Didactic
®
ou Vygon
®
).
●
un robinet3voies (Vygon
®
).
●
un filtre àair stérile 0.2micron(Stérifix
BBraun
®
).
●
matérielpour la méthode DSS(Turbo-
foam
®
):filtre 0.2micron(stérifixB
Braun
®
), robinet3voies (Vygon
®
),
seringues2corps.
●
un dispositif Easyfoam
®
.
●
un dispositifStérivein
®
.
B/ pour l’injectiondelamousseen
ambulatoire:
●
desaiguilles21G,22G,23G,30mmou
25 mm voire 26 Gà30G.
●
desprolongateurs flexibles20cm
Vygon
®
,cathéter 18 G(Intrasyte
®
ou
Abbocath
®
)40mm. desmicroper-
fuseurs (épicrânienne ou butterfly)
(Microflex
®
,Vygon
®
).
●
un écho-Döpplerpulsé couleur avec au
minimumune sonde de 7.5à10 MHz
(idéal :5à15 Mhz).
●
du gelstérile ou chlorhexidine en spray.
●
deslingettesousprays désinfectants
pour sondesd’échographie (sansaldéhy-
de pour ne pasles détériorer).
C/ pour l’injectionaublocopératoi-
re desgrandes saphènespar cathé-
terlongéchoguidé sur veine vide :
●
de la xylocaïne 1% tamponnéeauBicar-
bonate 1.4%.
●
un introducteur 5F(Vygon
®
).
●
un cathéter Cook RoyalFlush
®
droit 5F
pour angiographie.
●
une bande d’Esmarch souple.
●
une bande Velpeau.
D/ pour d’autres techniques
d’injection:
●
despetits cathlons 20 G(OptivaMedex
Medical
®
).
●
cathéter long de type angiocath 4F
(SuperTorque
®
,Johnson &Johnson
Company
®
,CordisEuropa
®
).
●
descathéters d’anesthésiepéridurale de
1mmdediamètre extérieur (Vygon
®
).
E/ pour la contention/compression:
●
il n’existe pasdeconsensuspour la com-
pression, les différentes attitudes obser-
vées sont :
●
pour la grande saphène :des bas-cuisses
ou collants de classe 2(15 à20mmHg)
ou 3(20 à36mmHg) (soit 1ou2enclas-
sification internationale) ou superpositi-
on de 2classes 2(soit 1+1enclassifica-
tion internationale) ou superposition
élastomousse
®
/élastoplaste
®
.
●
pour la petite saphène :chaussette classe
2ou3norme française (soit 1ou 2en
classification européenne)ousuperposi-
tion élastomousse
®
/élastoplaste
®
.
●
ou autresdispositifs visantàcomprimer
électivementles segments traités.
3/ Confectiondelamousse
A/ Matériel
Seuls lessclérosants tensio-actifs ou déter-
gents (tétradécylsulfatedesodium et poli-
docanol ou lauromacrogol) ont la possibilité
de se transformer en mousse. La concentra-
tion varie de 3%pour les gros troncsà0,20
%pour les petites varices (elle est encore
plus faible pour lestélangiectasies). Une
micromoussedoit avoir un ratiogaz/liquide
entre 4et8(en dessous,lamousse est trop
liquide et se lyse rapidement et au dessus, sa
stabilité est faible). Le ratio le plusemployé
est de 80/20 %c'est-à-dire 4volumes de gaz
pour 1volumedesclérosantliquide.Cette
proportion optimale est inhérente àl’agent
moussant (elle est identique pour les2sclé-
rosants disponibles) et non àlaconcentrati-
on de sclérosant.Ilnefautdonc pasdiminu-
er la proportion de gazdansles concentrati-
onsfaibles (25).
Lesseringuesenplastiqueetàusageuni-
que assurent la meilleure sécurité.Les non
siliconées permettent la fabrication de
mousses de meilleure qualitécar la silicone,
lubrifiant gras, fragilise la mousse et réduit
sa stabilité dans la seringue puis dans la va-
rice. Il est possibled’obtenir avec ces serin-
gues desmousses stablesà0.10%.Ilest im-
portantdepouvoir faire varierles concen-
trationsdes mousses car lesvarices, lesré-
seauxvariqueuxetles sensibilités auxsclé-
rosants diffèrent d’un patient àunautre.
Toutefois, l’utilisation de ces seringuesà
double-corps rend l’injection àl’aiguilledi-
recteplus délicateetdoit faire privilégier
l’indirecte(microperfuseur ou cathéter). La
mousse doit être préparéejuste avantl’in-
jection,quelles que soient ses méthodesde
confection ou d’injection.
L'hygiène du localmédical doit être ex-
cellente
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2017-05-25 | IP: 88.99.165.207

Phlebologie3/2008
152
Gachet, Spini
B/ Méthodes
Il existe au moins10méthodespour con-
fectionnerdelamousse :industrielle :Ca-
brera (26) ou bien artisanale:Monfreux
(27), Tessari,Sadoun (28), Garcia Mingo
(29), Gachet (30), Onorati (31)…
L’ artisanalelaplus employéeest le tour-
billon de Tessari (technique IRVINE), il né-
cessite 2seringues, un raccord femelle/fe-
melle ou un robinet3voies et un filtre àair
stérile.Lepassagealternatif du mélangeair/
liquide d’uneseringue àune autre parunro-
binet 3voies ou un raccord femelle/femelle
génère une émulsion. Il faut au moinsdix al-
lers et retours dont lesderniers sont réalisés
en hyperpression pour confectionnerune
micromoussehomogène,stableetcompacte
assurant ainsilemeilleur résultat.
L’ emploi d’un appareil automatique
(Turbofoam
®
)permetd’obtenir une
mousse stérile standardisée. Leskits adap-
tés(Easyfoam
®
,Stérivein
®
)permettent
égalementdeconfectionnerune moussesté-
rile.
4/ Indications/
contre-indications
Indicationsetcontre-indicationssont fon-
dées surlaclinique et l’écho-Döppler, indis-
pensable avanttoute procédure.
A/ Indications
Ellessont clairement établiespar l’ANAES.
Tous les patients auxdiversstadesdelama-
ladie veineusechronique (classées de C2 à
C6 selon la CEAP)peuvent bénéficier de la
technique (Un ulcère variqueux ne contre-
indiquepas le traitement mais la ponction/
injection doit être réalisée en peau saine).
De même,toutes les varices, ycompris de
diamètresupérieure à10mm(32), troncs
saphènes, accessoiresdes saphènes, pel-
viennes, perforantes(parinjections indi-
rectes),réticulaires, télangiectasies, veino-
dysplasies et récidivesaprèsstrippings,
phlébectomies, curesCHIVA ,VNUS closu-
re,lasersetsclérothérapies.
B/ Contre-indications absolues(33)
Allergie àunproduit sclérosant,affections
généralesgraves, thromboseveineusepro-
fonde aigue,syndromeobstructifpost-
thrombotique, artériopathie sévèredes
membres inférieurs(stade III et IV), infecti-
onscutanées locales et,uniquement pour le
LAUROMACROGOL quicontientdel'al-
cool, un traitement au DISULFIRAM qui
est utilisé pour le sevrage éthylique.
C/ Contre-indications relatives.
Thrombophilies (nécessitant uneanticoagu-
lation temporairepar HBPM, FONDAPA -
RINUX ou AV K),foramen ovalepersistant
symptomatique, anévrisme du septum inter-
auriculaire,maladie de Rendu-Osler, mal-
formationsartério-veineuses et expositions
solaires. En l’absence d’études suffisantes
excluant l’absence de risque,ilconvient
d’êtreprudent en cas de grossesse confir-
méeetdanslapérioded’allaitement, en dis-
cutant le bénéfice /risqued’une indication
précise et exceptionnelle en accord avec le
patient. Les3premiersmois du post-partum
ne sont égalementpas propices au traite-
ment desvarices àlamousse. Il est préféra-
bledenepas programmerune chirurgie ou
un longvoyagedansles 2mois qui suiventla
procédure.
D/ Remarques
Lestraitements anticoagulants et antiag-
régants ne représentent pasdes contre-indi-
cations(34)
La présence d’un reflux veineux profond
n’est pasune contre-indication mais doit
faire rechercher une maladie post-thrombo-
tique qui pourrait nécessiterune anticoagu-
lation transitoire.
Lesvarices de taille, de forme et de loca-
lisationsinhabituelles doivent faire recher-
cher d'éventuellesfistulesartério-veineuses
et maladiespost-thrombotiques avec desré-
seauxvicariants.
Le grand-âge ne contre-indiquepas la
méthode mais lesvolumes de moussein-
jectés doivent être diminués.
5/ Examens echo-Doppler
3sont indispensables:
A/ Bilan initiald’évaluationde
l’indication
Devant un patientporteur d’une maladie
veineusesuperficielle, l’examenécho-
Döppler, en complément de l’examenclini-
que, se doit d'étudier les réseaux artériel,
veineux profondetsuperficielainsique les
veinesperforantesdes membres inférieurs
dans le butde:
●
rechercher et quantifier une artériopathie
(IPS).
●
rechercher une thrombose veineuseai-
guëouséquellaire,
●
décrire la pathologie du patient,
●
classifier selon la CEAP,avecd’éventu-
elscompléments
●
élaboreruncompte-rendu généraldétail-
lé de la pathologie variqueuse.
Lesdonnéesdel’examen ultra-sonique per-
mettentd’orienter les modalités thérapeuti-
ques en fonctiondes objectifs:traitement
médical, chirurgieconventionnelle ou mini-
maliste ou traitementendoveineux(endola-
ser,radiofréquence ou mousse). Le patientet
son médecintraitant en sont alorsinformés
puisundélai de réflexionest alors observé.
B/ Echomarquage (35, 36, 37)
Dans le cas où le patientopte pour un traite-
ment àlamousse après l'observation du dé-
laideréflexion, l’examenécho-Döpplervi-
se en particulierà:
●
élaborerune cartographie veineusesu-
perficielleprécise et adaptéeàlatechni-
que choisie parlepatient.
●
définir le mode d’injection le plus appro-
prié:ponction directe, cathéter long ou
court,
●
repérerlepoint de ponction idéalen
fonction de la faisabilité (calibredela
veine,tortuosité, présence d’artérioles
de voisinage…),
●
définir les réseaux veineux àtraiter et à
respecter (y compris ceuxque l’on espè-
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2017-05-25 | IP: 88.99.165.207

153
Traitement endovasculaire desvarices
Phlebologie3/2008
re voir redevenir continent aprèsunpre-
mier traitement (38, 39) puis lesdessiner
surlemembre,
●
définir le volume théorique(Scm2 xL
cm)qui sera diminué parlespasme,
●
choisir la concentration optimale de
l’agent sclérosant en fonction :delana-
ture(taille et profondeur), du calibredes
veinesàtraiter,d’une éventuelle expéri-
ence antérieure(àaugmenterencas
d’échec initial, àdiminuer en cas de for-
te réaction inflammatoireoudepigmen-
tation antérieure).
C/ Echoguidage
Il est fondamentalpour la précision et la sé-
curité de la procédure.Ilcomprend:
●
le guidage de la ponction en coupe trans-
versaleoulongitudinale selon les habitu-
desdechacun; la pointedel’aiguilledoit
être visualiséedanslalumièremaisl’ob-
tention d’un reflux sanguin est indispen-
sable
●
l’analyse échographique de la progressi-
on de la mousseéchogènepermetde
stopperl’injection en cas d’extravasati-
on,d’adapterlevolumeàinjecter,deréa-
liser desmanœuvresposturales et d'ef-
fectuerdes compressions alternatives et
sélectives.
●
la vérification de l’efficacité immédiate
de la procédure,avant l’ablation de la
voie veineuse, parleremplissage de
mousseetl’obtention d’un spasmevei-
neux surtoutes les portions que l’on dé-
sirait traiter (la mousse ne doit pasflotter
àlasurface de la veine mais occupertou-
te sa lumière).
6/ Injections
A/ Site
Il faut éviterdeponctionnerl’aine ou la fos-
se poplitée afin d’éviterlacomplication ma-
jeure de la procédure qui est l’injection in-
tra-artérielle.
Pour la GVS, saufcas particuliers,ilest
préférabled’injecter le tronc saphène plutôt
qu’une saphène accessoire sus-fasciale.
Pour la PVS, il est impératif de recher-
cher trèsattentivement la présence de l’artè-
re PS afin d’en éloigner le site d’injection.
Pour une veine perforante,ilest préféra-
bled’injecter àdistanceduchenal, en raison
de la présence constanted’une artériole per-
forante.
La ponction/injection se fait toujours,
aprèséchomarquage,depréférences, en dé-
cubitus latéralpour la GVSetdécubitus
ventral ou àgenoux pour la PVS (la flexion
du genou décomprime la PVS).Ledécubi-
tus assure l’immobilité et la décontraction
du patient. L’ orthostatismeest àproscrire en
raisondemouvements intempestifs et de
malaisesvagauxpotentiels.
B/ Ponction/injectiondirecte (40)
Positionnement de l’opérateur :
●
la main quiinjecte doit être et rester en
appui surlemembre du patientafindene
pasbougerlors de l’injection,
●
la deuxième main doit maintenir la sonde
pendant l’injection et l’opérateur doit se
positionner de manière àgarderdansson
champdevision :laseringue et l’écran
de l’échographe.Unbrasporte-sonde
peut éventuellement maintenir la sonde
et ainsilibérerladeuxième main (41).
Choix desaiguilles:il n’est pasrecomman-
dé d’utiliser desaiguillesdegros diamètre
(type IM,21G). La longueur de l’aiguille
doit être suffisante pour permettre un appui
de la seringue surlapeau et pour obtenir un
abord de la veine tangentielafindelimiterle
risque d’extravasation lorsduspasme. Les
aiguilles utilisées majoritairement sont de
25G, 0,5x16 (orange), 23G, 0,6x25 ou 30
(bleue)et22G, 0,7x30 (noire).
C/ Ponctions/injectionsindirectes
3procéduresseront décrites, cathéter court
(cathlon et microperfuseur)(42) et cathéter
long (43). Lessitesdeponctions les plus
adaptésaux cathéters courts sont les tiers
moyens de la GVSetdelaPVS.
Cathéter court
La surélévation du membreaprèslaponcti-
on permet de diminuer le volume sanguin de
la variceetdelimiterlamigration de la
mousse parl'ostium, favorisant ainsison
contactétroit avec l’endoveine.Levolume
de moussenécessaire pour remplir totale-
ment la saphène fémorale jusqu’à la joncti-
on, est injecté(volume de remplissage habi-
tuellement de 5à10 ml de mousse).L’ab-
sence de spasmejustifiel’injection d’un vo-
lume complémentaire (volume de renouvel-
lement habituellement de 2à3mlde
mousse). L’ utilisation de garrots vise àlimi-
terladilutionduproduit en diminuant le
passage de mousseconcentréedansles ac-
cessoiressus-fasciales qui seront traitées ul-
térieurement avec desconcentrationsplus
faiblesàl’aide d’un microperfuseur. Le ris-
que de pigmentation sembleainsiréduit.
Microperfuseur(épicrânienneoubutterfly)
Lessitesd’injection lesplus adaptéssont
égalementles tiers moyens de la GVSetde
la PVS. 2méthodessont pratiquées.
Le microperfuseur peut être introduit
dans la varice, le refluxsanguin dans le pro-
longateurpermetalorsdelepurgerdeson
air(il peut égalementêtre purgéavec2ml de
sérum physiologique) avantlebranchement
de la seringue de mousseetl’injection lente
sous contrôle échographique.
Le microperfuseurpeutégalement être
d’abord connectéàlaseringue et la poncti-
on veineuseréalisée aprèslapurge du pro-
longateuraveclamousse. Là encore,lavéri-
fication du refluxveineux dans le prolonga-
teur et l’injection lente sous contrôle écho-
graphique sont indispensables.
Cathéter long
Pour la GVS, le patient est allongé sans sé-
dation. L’ abord veineux se fait soit parvoie
percutanée:introducteur 5F Vygon®, ou
pardénudation sous anesthésielocaleàla
xylocaïne 1%. Le niveau d’introduction est
choisi en fonction du niveau de reflux, en
distalité au coudepiedousous le genou le
plus souvent. Un cathéterCook RoyalFlush
droit F5
®
pour angiographie est monté jus-
qu’à 2cmsous la jonction saphéno-fémora-
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2017-05-25 | IP: 88.99.165.207
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%